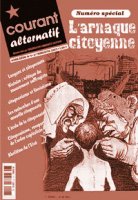
Courant Alternatif H.S.n° 9
L’ARNAQUE CITOYENNE
avril 2003
mardi 3 novembre 2009, par
Aujourd’hui on nous sert du citoyen à toutes les sauces, du tri des déchets aux merdes de chiens en passant par toutes les normes de comportement individuel. Il faut participer, dans des cadres bien précis, à la société telle qu’elle est afin que celle-ci ne dérive pas trop ! Fini les idées de Révolution, de société communiste. Place à la participation/gestion, à l’intégration/assimilation, au contrôle des excès... de toutes les formes de domination !
Édito
Langue et citoyenneté
Historique critique du mouvement suffragiste en France
Quelques caractéristiques du suffragisme aux États-Unis
Emma Goldman l’anarcha-féministe et le suffrage des femmes.
Suffragisme... citoyenneté et républicanisme
Comment le citoyennisme traverse le mouvement féministe ?
Les recherches d’une nouvelle citoyenneté
Citoyenneté, droits et devoirs : mais de quel droit !
L’école de la citoyenneté et vice versa !
Antiglobalisation et citoyennisme
Sans la revendication de l’abolition de l’État, l’anticapitalisme,
c’est du pipeau !
Le citoyennisme comme rempart de l’ordre capitaliste
Attac
ÉDITORIAL
Aujourd’hui on nous sert du citoyen à toutes les sauces, du tri des déchets aux merdes de chiens en passant par toutes les normes de comportement individuel. Il faut participer, dans des cadres bien précis, à la société telle qu’elle est afin que celle-ci ne dérive pas trop ! Fini les idées de Révolution, de société communiste. Place à la participation/gestion, à l’intégration/assimilation, au contrôle des excès... de toutes les formes de domination !
“Les vaches sont bien gardées”
A l’origine être citoyen signifiait appartenir à une collectivité dont on était membre agissant en instituant la loi par des pratiques politiques : le débat (les palabres) puis le vote. Dès le départ, il y a eu ceux qui étaient citoyens (une infime minorité) et toute une masse d’exclus. Comme ce sont les citoyens titulaires qui décident des critères d’accès à la citoyenneté, son extension fut l’occasion de longues et difficiles luttes.
Sur le papier, cela apparaissait comme un projet émancipateur pour tous ceux et toutes celles qui étaient exclus de ces droits civiques qui déterminaient la vie d’une collectivité sous tous ses aspects. En France les hommes de nationalité française ont attendu 1848 pour avoir ces droits, les femmes de nationalité française attendront 1945, quant aux immigrés résidant en France ils et elles attendent toujours...
Et alors ? Cela ne change rien au “Schmilblic” ! “Les vaches sont bien gardées” ! Le suffrage universel, basé sur une délégation de pouvoir totale a été dans l’Histoire une “victoire” démobilisatrice pour les mâles non possédants, puis pour les femmes. Il demeure l’instrument de la domination économique et sociale d’une petite minorité sur la grande majorité. Aucune réelle libération n’a pu s’obtenir par les urnes car cette libération implique en fait à la fois la destruction des structures économiques et de l’organisation sociale et politique leur correspondant. Le peuple dit “souverain” peut élire autant de prolétaires, autant de femmes qu’il veut, ces élus ne peuvent que gérer toutes les formes de domination existantes (économique, patriarcale, culturelle,...) et si éventuellement ils et elles dérogeaient à leur fonction de reproduction de cette société en refusant leur intégration/assimilation, ce système a prévu légalement et en dernier ressort de les détruire (pouvoirs spéciaux militaires inscrits dans toutes les constitutions d’États démocratiques) car comme chacun et chacune devrait savoir “l’armée est le dernier rempart de la démocratie “ ! Bien sûr on peut toujours rêver d’une démocratie participative dans le cadre d’une commune, d’un quartier et même prôner un “municipalisme libertaire”. A part l’aménagement des chemins communaux, le tri des déchets, l’organisation de fêtes et rencontres culturelles, les moyens matériels de l’école communale quand l’État n’a pas imposé sa fermeture... le “Small is beautiful” a ses limites définies par l’État qui contrôle, via les préfectures, toutes les décisions prises par n’importe quelle commune de France. C’est ainsi qu’un maire, qu’un conseil municipal peut être puni et même démis de ses fonctions, et si par “bonheur” une collectivité locale quelconque entrave la bonne marche de l’État et du capital concernant par exemple l’aménagement du territoire, c’est en toute légalité républicaine que le Préfet peut passer outre en imposant par la force de ses flics et militaires les décisions du pouvoir central.
Le renouveau actuel
Le citoyennisme n’est pas une idée nouvelle car on la retrouve sur le devant de la scène dans toutes les périodes importantes de la société française depuis de révolution française de 1789.
Aujourd’hui nous assistons à un renouveau du citoyennisme. Ce renouveau a correspondu avec l’arrivée et le maintien au pouvoir de la gauche et il a été en grande partie porté, revendiqué par des mouvements de contestation, d’identités particulières (liés à l’immigration, femmes, régionalistes, homo,...) qui se sont constitués (de 1975 à 1995) doucement, insidieusement, progressivement en mettant de côté jusqu’à les combattre les analyses de classe de la société. Le bicentenaire de 89 a d’ailleurs été le temps fort de la réponse du pouvoir pour finir d’intégrer ces mouvements. Ce renouveau est lié aussi à l’abandon de l’idée de révolution dans l’extrême gauche et chez certains libertaires. La pratique actuelle est une démarche protestataire à l’intérieur du système qu’on veut finalement intégrer.
De « citoyen » à « citoyen », il y a d’ailleurs eu un glissement sémantique où on est passé du nom à l’adjectif jusqu’à des caricatures. On est passé, d’une appartenance collective à un corps politique et social pouvant agir dans des périodes données pour transformer fondamentalement la société, à un processus individuel de personnes isolées qui vont éventuellement exercer, par des mouvements d’opinion, un simili contrôle sous forme de protestation (qui peut avoir des formes radicales), pétition, pratiques de lobbying, sur les travers les plus choquants ou impossible à vivre. A aucun moment il ne s’agit de refaire le monde mais d’atténuer les effets d’une politique qui nous échappe. La société civile est devenue le substitut du prolétariat. Ses instances représentatives sont des associations, O.N.G. sur des thèmes divers qui reproduisent le fonctionnement des syndicats institutionnalisés et en perte de vitesse. Cette montée du citoyennisme correspond donc à un affaiblissement des corps intermédiaires (idéologiques, le syndicalisme classique, tout ce qui est des médiations entre le capital et le travail) et elle joue un rôle très précis dans le redéploiement capitaliste actuel marqué par une formidable offensive de la bourgeoisie. Le citoyennisme réhabilite l’État, des tas de mouvements se tournent vers lui comme on se tourne vers un arbitre neutre ; le plus caricatural étant la grande majorité du mouvement voulant aménager la globalisation actuelle du capital.
Cela ne fonctionne pas si bien que cela car dans nos sociétés démocratiques un nombre croissant d’exclus ne se sent plus représenté dans ce système politique qui paradoxalement n’a jamais eu autant de prétendants à sa gestion. Il faut dire que la soupe citoyenne est bonne et nourrissante, mais il n’y en aura jamais pour tout le monde !
Mais au-delà des pertes de repère, au-delà de tout ce qui s’écroule, il faut quelque chose qui nous tienne pour nous faire vivre ensemble. Nécessairement de nouvelles collectivités d’appartenance vont naître qui n’émaneront pas forcément de politiciens machiavéliques.
ALORS ? LA SEULE CHOSE QUE NOUS POUVONS FAIRE C’EST DE CONTRIBUER A LA RENAISSANCE DE L’IDÉE DE RÉVOLUTION !
Vau mielh esser auseu de bòsc qu’auseu de gàbia
(Il vaut mieux être oiseau des bois qu’oiseau de cage, proverbe limousin)
Actuellement, le français est la langue nationale de la France. Cela semble évident, mais ce n’est qu’en 1992 que cela a été officialisé par l’introduction dans l’article 2 de la Constitution de la phrase : “La langue de la République est le français”. Tout en sachant que d’autres langues, non officielles, sont parlées en France, que le français est parlé dans d’autres pays et que certains des états voisins sont officiellement multilingues, la plupart de nos concitoyens considèrent comme allant de soi qu’une langue coïncide avec une identité nationale. Ce n’est en fait pas très fréquent et résulte d’une politique forgée depuis quelques siècles en France, voire quelques décennies dans d’autres pays.
NOUS SOMMES TOUS DES BARBARES
Cependant le lien entre citoyenneté et langue est bien plus ancien puisqu’il remonte à l’antiquité grecque. Pour être citoyen d’une cité grecque, il fallait parler la langue grecque (même si elle comprenait alors au moins quatre dialectes différents). Les langages des autres peuples, incompréhensibles aux grecs étaient qualifiés de barbares. Les barbares étaient tous ceux qui ne pouvaient être compris et n’étant pas grecs ne pouvaient être citoyens. L’acquisition de la langue faisait partie des conditions nécessaires pour devenir citoyen.
Cette théorie de la supériorité d’une langue sur les autres a en particulier été développée par Platon (dans le dialogue de Cratyle). Pour lui, le grec était une langue “bien-formée” et toutes les autres langues, les langues barbares, étaient “mal-formées”. Ce n’était nullement le résultat d’une comparaison linguistique (Platon ne parlant aucune autre langue), mais l’affirmation d’un principe idéologique. Nous parlons tous une ou des langues qui ne peuvent être comprises d’autres personnes ; nous sommes tous des barbares pour ceux qui ont une haute idée de leur propre langue. Il faut souligner également que si au départ le terme de barbare désignait l’étranger, le “non civilisé”, il n’a pris une connotation de cruauté et de sauvagerie qu’à partir du 19e siècle dans les manuels d’histoire de France.
Les romains ont repris cette distinction, mais en reconnaissant que les Grecs dont ils étaient en partie héritiers en terme de civilisation pouvaient échapper à la qualification de barbares. Pendant tout le Moyen âge, si de nombreuses langues se développent (non seulement sur le plan oral, mais aussi administratif et littéraire), pour la plupart des lettrés les seules langues nobles restent le grec et le latin. Ce sont eux qui forgent le terme de “barbarismes” pour désigner les mots ou tournures issues d’une langue étrangère. Par contre les souverains des États féodaux ne se préoccupent pas de l’unification de la langue de leurs territoires et ne cherchent pas à imposer leur langue aux peuples qu’ils dominent. Par exemple les souverains anglais ont laissé se développer cette langue bien qu’eux-mêmes aient parlé en normand, en français ou en langue d’oc.
LES DÉBUTS DE LA CENTRALISATION
C’est à la renaissance, avec le début de la construction des États modernes et en particulier à travers la rivalité entre le royaume de France et l’empire germanique, que vont apparaître des tentatives d’asseoir sa domination au moyen de la langue. Pour appuyer cette domination, les lettrés des institutions savantes créées par les souverains (en France, le Collège du Roi, actuel Collège de France est créé par François 1er en 1530) essayent de valoriser la langue de leur souverain en lui attribuant une filiation antique avec le latin, le grec ou l’hébreu, nouvellement promu langue noble par les humanistes (et l’exercice était rude pour trouver des liens entre la langue divine, l’hébreu, et le français ou l’allemand !).
Si dans les premiers temps, l’expansion territoriale du royaume de France ne s’est pas attaquée aux langues parlées dans les régions nouvellement conquises, une rupture se produit en 1539. En publiant l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François 1er s’attaque non seulement au latin qui restait largement répandu dans les actes officiels, mais aussi aux langues régionales. Sous prétexte que “les arrests (...) soient faits et escrits si clairement qu’il n’y ait ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ne lieu de demander interprétation”, il s’agit de soumettre les populations de France au pouvoir central. D’ailleurs, dans les faits, au cours des siècles suivants ce sont en premier lieu les juges des parlements puis les administrations (fiscales en particulier) qui introduiront la langue française dans les provinces. Si le petit peuple francophone y a gagné le droit d’être jugé et imposé dans une langue qu’il comprend à peu près (à peu près seulement, car le jargon de la justice ou de l’administration est — comme aujourd’hui — bien éloigné du français populaire), les Bretons ou Languedociens n’entendent pas mieux le français que le latin. Il n’y a pas eu de résistance à cette conquête linguistique de la France ; l’ordonnance de 1556 de Jeanne d’Albret imposant le “lengadge deu present pays” en Béarn reflétait une volonté similaire à celle du roi de France et d’ailleurs Louis XIII imposera par édit le “langage françois” en pays de Navarre, Béarn, Andorre et Donezan.
NAISSANCE DE LA CITOYENNETÉ ET ÉRADICATION DES PATOIS
L’ordonnance de Villers-Cotterêts n’a pas produit un développement important de la langue française. Celle-ci s’est essentiellement répandue dans l’administration et dans la bourgeoisie des villes de province. Cela explique bien le décalage qui s’est produit lors de la Révolution Française entre ces élites politiques de la bourgeoisie montante et le peuple des provinces. Les idées nouvelles telles que la citoyenneté (le terme date de 1783, à l’aube de la Révolution) s’exprimant et se débattant en français, il fallait que cette langue soit imposée à toute la population pour que celle-ci devienne citoyenne.
Or, à cette époque, sur 26 millions d’habitants, 12 n’étaient pas francophones et une grande partie des autres n’avaient qu’une connaissance limitée de cette langue ou ne pratiquaient qu’un de ses dialectes régionaux. L’abbé Grégoire dans son rapport à la Convention du 30 juillet 1793 (intitulé : Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française), après avoir énuméré trente patois (mêlant des patois de langue d’oïl, de langue d’oc ou d’autres langues), constate au niveau du français : “le nombre de ceux qui le parlent purement n’excède pas trois millions et le nombre de ceux qui l’écrivent correctement encore moindre”.
On trouve plusieurs types de justification à la volonté d’unifier la langue. Les citations suivantes, toutes de Barère de Vieuzac, député de Bigorre à la Convention, recouvrent l’ensemble du champ des justifications employées par les jacobins à l’époque de la Révolution Française comme de nos jours. On trouve tout d’abord un principe idéologique : “Chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous.” Ce principe d’unicité n’est en rien justifié puisque, d’une façon générale, les populations sont plus libres lorsque leurs particularités culturelles sont reconnues que lorsqu’elles sont niées.
La seconde justification est celle de l’égalité devant la loi. C’est la reprise du principe énoncé dans l’édit de Villers-Cotterêts. Mais si “tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”, l’obligation d’être jugés dans une seule langue introduit une inégalité pour ceux dont ce n’est pas la langue maternelle. Le troisième principe est un principe d’autorité : “Le législateur parle une langue que ceux qui doivent exécuter et obéir n’entendent pas”. Les citoyens ne sont plus libres, mais soumis aux ordres de ceux qui sont au pouvoir, et effectivement pour s’assurer de cette soumission, il est nécessaire que tous comprennent.
Le quatrième principe se situe au niveau du type d’organisation politique : “Citoyens, vous détestez le fédéralisme politique, abjurez celui du langage”. La bourgeoisie révolutionnaire fut tiraillée entre deux courants : le fédéralisme qui sera représenté par les Girondins et le centralisme jacobin dont la plupart des partis politiques actuels sont héritiers. Cette volonté centralisatrice confine au racisme lorsque Barère déclare : “Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton et la haine de la révolution parle allemand ; la contre révolution parle l’italien et le fanatisme parle basque”. On peut remarquer que pour parler de l’alsacien ou du corse, il les assimile à des langues étrangères. De plus cette classification abusive et révisionniste occulte le fait qu’il y ait eu des révolutionnaires non francophones avant et après 1789, et qu’il y a eu autant de francophones contre-révolutionnaires.
Enfin, Barère ajoute un dernier justificatif qui montre bien de quelle classe il est issu : “Les jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce”. Bien sûr, la diversité linguistique n’a jamais empêché le commerce, mais les puissances économiques se trouvent toujours renforcées lorsqu’elles peuvent imposer leur langue dans les relations commerciales ; nous le voyons bien aujourd’hui avec le rôle de l’anglais américain dans l’économie et en particulier dans les secteurs les plus modernes.
COLONIALISME INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
La Révolution Française n’a pas eu le temps ni les moyens de mener à bien son œuvre d’unification de la langue et d’éducation de tous les citoyens en français. D’ailleurs la tâche était impossible : devant le manque d’instituteurs francophones, il a fallu, dès le 20 octobre 1794 autoriser l’enseignement bilingue. Cependant les idées jacobines nées à cette époque vont se développer au cours du 19e siècle pour aboutir aux lois fondatrices de la 3e République. En 1871, Gambetta déplorait encore le fait que le français ne soit pas assez répandu : “nous qui parlons notre langue, tandis que tant de nos compatriotes ne font que la balbutier”.
C’est Jules Ferry qui sera l’artisan du développement de la langue française en organisant l’enseignement élémentaire (1881-1884). Il ne s’agit pas seulement d’éduquer tous les citoyens, mais de les éduquer en français, celui-ci devenant la seule langue d’enseignement pour toutes les matières. L’utilisation des langues locales à l’école est sanctionnée par des mesures vexatoires et des signes infamants. La désignation de ces langues est elle-même discriminatoire : baragouin, charabia, patois, jargon ainsi que sabir ou petit nègre.
De même que l’école permet la colonisation intérieure des provinces peu francisées, les colonisations lointaines s’accompagnent d’une volonté de “civiliser” les populations conquises, comme si elles n’avaient pas auparavant de civilisation, pas de culture ni de langues. Jules Ferry est aussi l’artisan du protectorat imposé à la Tunisie et de la conquête, souvent violente, du Bas Congo, de Madagascar et du Tonkin. A propos des colonies, il est nécessaire de signaler que si, en Afrique du Nord, l’arabe dialectal était interdit à l’école, l’arabe littéraire pouvait être enseigné dans le secondaire comme “langue étrangère”, ce qui est sacrément paradoxal.
Pour parfaire l’éducation des citoyens, tout en leur inculquant la langue française, il était important de leur donner une image nationale de l’État français à travers l’enseignement de l’histoire. Cela a amené à enseigner une histoire falsifiée d’une France quasiment éternelle partant des Gaulois et sans contradictions de cultures ou de choix politiques. Dans cette vision d’une France éternelle, la république est inscrite dans la continuité d’un État qui a été forgé par les rois. C’est ainsi aussi que l’on a fait apprendre “Nos ancêtres les gaulois...” à des générations de petits africains. Dans l’optique du développement de la langue française sur tous les continents, se créé en 1883 l’Alliance française, qui s’appelait au départ : “Alliance nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l’étranger”.
Évidemment, la France n’est pas le seul pays où on a pu assister à une politique d’unification de la nation autour d’une langue. On peut en citer deux cas particulièrement significatifs : la Roumanie et Israël. Plusieurs populations des Balkans parlaient une langue d’origine latine métissée avec les langues slaves ou d’autres langues de cette région. Elles se répartissent en quatre dialectes : dacoroumain, aroumain, mégléno-roumain et istro-roumain. Seul le premier de ces dialectes est assez répandu, sur un territoire correspondant à l’actuelle Roumanie. Depuis le 10e siècle, il est écrit en caractères cyrilliques et a beaucoup emprunté aux langues slaves.
C’est cependant autour de ce dialecte que se développe un mouvement nationaliste à base linguistique : en 1827, Ion Heliade Radulescu fonde la Société Littéraire qui se donne pour but de réorganiser l’enseignement et développer la littérature et la presse de langue roumaine. Tout est fait pour redonner à la langue un caractère latin : abandon de l’alphabet cyrillique en 1836, modification de l’orthographe pour la rendre plus proche du latin, remplacement par des néologismes d’origine latine des mots slaves, turcs, hongrois, allemands...
Tandis que Radulescu fait ce travail en Valachie, Asachi fait de même en Moldavie et Cipariu en Transylvanie, ainsi il est fait “une démonstration du caractère unitaire et distinctif de cette langue autour de laquelle devait se réaliser l’union politique”. Cette volonté politique aboutira à la création de la Roumanie en 1878 et à l’absorption par celle-ci de la Transylvanie en 1918. Les traces de cette politique nationaliste autour de la langue se font toujours sentir aujourd’hui et les minorités (hongrois, allemands, tsiganes...) ont toujours du mal à être reconnues comme citoyennes à part entière.
Le nationalisme peut même amener à unifier des populations autour d’une langue morte. En 1860, lorsqu’est créée l’Alliance israélite universelle, l’hébreu n’était plus qu’une langue morte, réservée au domaine liturgique par les plus croyants des israélites. Tous pratiquaient dans leur vie courante le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, ou tout simplement les langues des pays où ils résidaient. Eliezer Ben Yéhoudan décide de recréer la langue hébraïque, en utilisant la base de l’hébreu de l’antiquité, en créant des néologismes, en éliminant tous les mots trop calqués sur une autre langue.
Il a fait partie des premiers juifs européens à aller s’installer en Palestine et créé en 1890 la Va’ad halashon, commission de la langue hébraïque. Le mouvement sioniste linguistique a donc précédé le sionisme politique qui n’est théorisé par Herzl qu’à partir de 1896. A la création de l’État d’Israël, en 1948, Va’ad halashon deviendra l’Académie de la langue hébraïque et l’hébreu deviendra la langue officielle de l’État. Il était d’ailleurs logique que dans un État fondé sur une base religieuse (même s’il prétend être laïque), la langue officielle soit la langue sacrée de cette religion. Cela implique que dans cet État, les seuls véritables citoyens, ceux qui parviennent à avoir une représentation politique, sont ceux qui pratiquent correctement l’hébreu, excluant non seulement les arabes mais aussi les juifs plus récemment immigrés.
PEU DE CONCESSIONS, BEAUCOUP DE BLOCAGES
Une fois les langues régionales de France suffisamment laminées, il fut possible d’accorder quelques concessions aux régionalistes. Cela a commencé par la loi Deixonne adoptée le 22 décembre 1950. Cette loi “sur l’enseignement des langues et dialectes locaux” autorisait l’enseignement de quatre langues : breton, basque, occitan et catalan, avec épreuves facultatives au bac et stages facultatifs pour les normaliens. Encore, la mise en place de ces enseignements s’accompagnait de nombreuses restrictions. Le corse, le flamand et l’alsacien restaient exclus parce qu’assimilés à des langues étrangères. En Alsace, l’allemand a progressivement été autorisé, surtout à partir de 1971, mais les dialectes alsaciens restent exclus. Le corse n’a été autorisé qu’à partir de 1974.
Depuis un demi siècle de nombreux décrets, circulaires et notes de service ont organisé ces enseignements tout en maintenant des restrictions et en ne donnant que des moyens très limités. Aujourd’hui encore, il a été impossible d’intégrer les écoles Diwan parce qu’elles pratiquent l’enseignement par immersion et que le breton y est à la fois langue enseignée et langue d’enseignement. Il est temps de voir maintenant tout ce qui aujourd’hui contribue à limiter les droits des citoyens qui utilisent une autre langue que le français.
Comme il a été rappelé en introduction, c’est en 1992 que fut modifié l’article 2 de la constitution pour officialiser le français comme langue de la République. Cette modification a été décidée officiellement pour protéger le statut du français, en particulier contre “l’invasion” de la langue anglaise. Elle a été adoptée par la majorité d’union de la gauche, avec le soutien de la droite. Depuis onze ans, cet article n’a pas été utilisé contre l’anglais, mais uniquement contre les langues régionales. Le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’État s’en sont servi en particulier contre l’enseignement des langues régionales (refus de l’intégration des écoles bretonnes Diwan, menaces contre les quelques classes bilingues de l’Éducation nationale) et contre la ratification de la Charte Européenne des langues régionales et minoritaires.
Sur le plan de l’enseignement, le Conseil d’État, prétendant lutter contre les inégalités entre les citoyens, s’est prononcé sur le plan pédagogique, allant au delà de ses prérogatives, pour dire que “l’immersion va au delà des nécessités de l’apprentissage d’une langue régionale”. Il considère que ce serait privilégier ces langues régionales que de les enseigner ainsi, mais le français n’est-il pas enseigné par immersion dans tous les établissements français en France et à l’étranger ? Il y a donc bien là une discrimination entre les citoyens.
La Charte Européenne des langues régionales et minoritaires est un texte comprenant 97 articles. Le gouvernement avait finalement accepté d’en signer 39 (le minimum étant 35 articles pour que ce texte puisse entrer en vigueur). Le Conseil Constitutionnel ne s’est même pas penché sur ces articles, il s’est contenté de s’appuyer sur le préambule de cette charte pour déclarer qu’elle “pourrait être en contradiction avec la Constitution” et recommander, comme le lui avait suggéré Chirac, de ne pas la ratifier. Le gouvernement s’oppose à l’entrée dans l’Union Européenne de la Turquie entre autres raisons parce que les droits de la minorité kurde ne sont pas reconnus, mais il fait de même en France.
Face à ces blocages, il y a eu le 21 novembre dernier une discussion à l’Assemblée Nationale pour modifier l’article 2 de la constitution. La modification de la phrase incriminée par l’ajout de la formule “dans le respect des langues régionales qui font partie de son patrimoine”, avait été proposée par des députés de droite (Le Fur, UMP et Bayrou, UDF) mais a eu le soutien de députés de gauche. Pour le gouvernement, représenté à ce débat par le ministre de la justice, la législation actuelle est satisfaisante et n’a pas à être modifiée. D’autres députés de droite comme Myard (UMP ) accusaient les partisans de la modification d’être “instrumentalisés par des gens qui veulent la fin la République”. Au final de ce brillant débat, 50 députés ont voté contre la proposition et 39 pour... Tous les autres étaient absents ; l’égalité entre les citoyens ne mobilise pas les élus.
Malgré tout, le gouvernement Raffarin se voulant décentralisateur, il ouvre des possibilités de reconnaissance... sans réels moyens comme charger cette coquille vide qu’est la DGLFLF (Délégation générale à la langue française et aux langues de France, créée en 1999) d’organiser des “assises de langues de France” qui ne vaudront sans doute pas plus que les “assises des libertés locales”. Il souhaite surtout se débarrasser de la question sur les régions en leur donnant la possibilité d’aider un peu les langues régionales, si elles le veulent bien et si elles ne sont pas coincées par des coupes budgétaires.
Un fait divers montre bien comme on est loin encore de l’égalité de traitement entre citoyens d’origine différente. Au mois de mai 2001, le journal La vie parisienne a publié un article intitulé : “22 raisons de dire merde aux Corses”, qui était un ramassis de préjugés et d’injures. Attaqué par une association corse, le journal été condamné en première instance et en appel. La cour de cassation a annulé le jugement en considérant qu’on ne pouvait pas définir les Corses comme une communauté et donc qu’ils ne pouvaient se considérer attaqués et diffamés... Nier l’existence des minorités, c’est le meilleur moyen de les empêcher de se défendre contre les attaques dont elles font l’objet.
LES “CITOYENNISTES”
CONTRE LES LANGUES RÉGIONALES
Les attaques contre les langues et cultures régionales viennent aussi bien de droite que de gauche, voire même d’extrême-gauche. Tout d’abord, on peut citer l’actuel ministre de l’Éducation Nationale, Luc Ferry, qui en digne héritier de Jules Ferry combat les langues régionales en les assimilant à l’intégrisme : “Nous assistons à une dérive communautaire depuis une dizaine d’années qui a commencé par l’affaire du foulard et qui peut aller jusqu’au cas des écoles Diwan”. La dénonciation du communautarisme (qui est un refrain fréquent) oppose en réalité les cultures régionales ou d’origine étrangère à la culture française qui elle aurait une vocation universelle ; c’est en fait une façon encore plus aiguë de privilégier la langue et la culture de sa propre communauté. De plus, il se permet de dénoncer les parents qui mettent leurs enfants dans les Calandretas (écoles occitanes), alors que ce sont des écoles privées sous contrat, tout comme celles où il scolarise ses filles.
En bon gaulliste, la position de Jacques Chirac peut se résumer ainsi : oui à la diversité culturelle, mais surtout pas chez nous. En effet, il est à la fois capable de demander au Conseil Constitutionnel d’empêcher la ratification par la France de la Charte Européenne et de déclarer en septembre 2002 : “Il n’y aura pas de globalisation humanisée et maîtrisée sans respect de la diversité des cultures et des langues”. Nous ne nous étendrons pas sur le cas de la majorité du personnel politique de droite, elle est tout à fait semblable, c’est à dire sauf quelques exceptions hostiles à toute reconnaissance des langues régionales.
Ils ont reçu l’appui de certains membres de l’Académie française qui sont montés au créneau en décembre dernier. Tout d’abord, dans un discours virulent, Hélène Carrère d’Encausse s’est attaquée à la DGLFLF, trouvant scandaleux que dans le titre de cet organisme le français soit mis à égalité avec les “langues de France”. Elle s’est même attaquée à Raffarin parce que celui-ci avait déclaré vouloir “assurer la primauté du Français, langue de la République” ; pour elle, il ne doit y avoir de primauté, qui suppose l’existence d’autres langues reconnues, mais unicité telle que l’a définie il y a cinq siècles l’Édit de Villers-Cotterêts. Bertrand Poirot-Delpech a appuyé la position de sa collègue dans un article du Monde du 25 décembre, en faisant par ailleurs étalage de son inculture puisque pour lui les langues régionales sont des “parlers dépourvus de grammaire et de littérature de portée universelle”. Enfin, il n’est pas surprenant de trouver des intégristes de la défense du français dans cette institution puisqu’elle a été créée pour ça.
Des intégristes de la défense du français, on en trouve aussi dans le “pôle républicain”, du Pasquaio-chevènementiste Abitbol qui défend au parlement européen la reconnaissance des seules langues déjà langues nationales, jusqu’à des personnalités considérées comme “de gauche” telles que Bernard Cassen, Régis Debray ou Pierre Péan. Bernard Cassen (du Monde Diplomatique et d’ATTAC), ne manque pas une occasion de dénoncer la menace de l’anglais, mais refuse de reconnaître aux autres langues les mêmes droits qu’au français. Régis Debray est passé du romantisme révolutionnaire à la mitterrandolâtrie puis au patriotisme pur jus : “Je suis français avant d’être républicain et républicain avant d’être socialiste”. Pierre Péan et Philippe Cohen, même s’ils peuvent faire certaines critiques judicieuses à l’égard du quotidien Le Monde, ont aussi une argumentation dénonçant le caractère “anti-français” de ce journal et appuient leur démonstration sur le fait que Jules Antoine Colombani, père du directeur, est vraiment Corse !
La défense de la langue française contre les langues régionales est aussi largement répandue dans les organisations “laïcardes”, du très intégriste CNAL (Comité national d’action laïque) à la FCPE (fédération des conseils de parents d’élèves) et aux syndicats SNUDI-FO, SE-UNSA, SNES-FSU. Ce sont les recours de ces organisations qui ont été jugés par le Conseil d’État et ont permis à celui-ci d’empêcher l’entrée des écoles Diwan dans l’éducation nationale. Au nom de la laïcité et de l’unicité de la République, la “Libre Pensée” s’oppose à l’ouverture de classes bilingues ou d’écoles associatives, mais il est vrai que depuis que cette association est tombée aux mains de militants du “Parti des Travailleurs”, la pensée n’y est plus libre...
Pour finir ce tour d’horizon des défenseurs du français contre les langues régionales, il faudrait citer la plupart des courants du PS, du Manuel Valls qui a voté avec la droite la répression de l’insulte au drapeau ou à l’hymne national, à Arnaud Montebourg qui veut conserver l’article 2 actuel dans la constitution de la “6e République”, et à P. Cassen de la “gauche républicaine” qui déclare que Diwan est une secte. Une mention spéciale peut être réservée enfin à Arlette Laguiller qui a déclaré sur TV-Breizh qu’elle était contre l’enseignement du breton par immersion parce que “le français est une langue supérieure et le breton n’est même pas une langue écrite” !
LA LANGUE EST UN OUTIL POLITIQUE
Contrairement à Staline qui estimait (dans A propos du marxisme en linguistique) que “la langue comme moyen de communication entre les hommes sert également toutes les classes”, la langue n’est pas seulement un moyen de communication, elle est aussi un moyen de domination et un enjeu de pouvoir. Par exemple, dans les anciennes colonies d’Afrique noire, ce sont bien les minorités qui ont traité avec les colonisateurs en apprenant leur langue qui ont pu se constituer en élite à la fois économique et intellectuelle, arriver au pouvoir à l’indépendance et s’y maintenir jusqu’à aujourd’hui en maintenant la dépendance culturelle et économique avec l’ancienne métropole.
Autre exemple : aux États-Unis, la classe économico-politique dirigeante se recrute essentiellement parmi les anglophones alors que la pression démographique des minorités est de plus en plus importante. Face à cela s’est développé depuis une vingtaine d’années un vaste mouvement de défense de l’anglais qui fait adopter l’anglais comme langue officielle des états et restreindre l’éducation bilingue. De nombreux États ont adopté cette position conservatrice inspirée par les élites et très peu ont officialisé le plurilinguisme.
Pour revenir à la Grèce, il faut signaler que la langue grecque moderne connaît deux formes : le demotiki et le katharevoussa. Depuis l’indépendance du pays, chaque forme a été tour à tour langue officielle, en fonction des régimes au pouvoir, les régimes de gauche préférant la première et les régimes de droite la seconde (par exemple le régime des colonels avait rétabli le katharevoussa). Cela est significatif du fait que pour être un “bon citoyen” on doit écouter “la voix de son maître”.
Alain (OCL Limoges)
Bibliographie
De nombreuses informations ont été tirées des ouvrages suivants :
Calvet, Louis-Jean, Linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie, Payot 1974
Calvet, Louis-Jean, L’Europe et ses langues, Plon 1993
Citron, Suzanne, Le mythe national, l’histoire de France en question, Éditions ouvrières et EDI 1987
Gendre, Claude et Javelier, Françoise, École, histoire de France et minorités nationales, Fédérop 1978
Tevanian, Pierre, Le racisme républicain, L’Esprit frappeur 2001
Tozzi, Michel, Apprendre et vivre sa langue, Syros 1984
ainsi que de l’hebdomadaire occitan La Setmana (VISTEDIT, BP 486, 64234 LESCAR CEDEX)
Le droit de vote et plus largement la citoyenneté ont été présentés un peu partout dans le monde, depuis la Révolution française, comme les outils de l’égalité entre les citoyens, qui étaient uniquement des hommes. De ce fait, dans divers pays, des militantes de plus en plus nombreuses (et pas mal de militants, car le mouvement suffragiste fut assez largement mixte) ont mis ensuite toute leur énergie à acquérir le suffrage pour les femmes, dans l’espoir d’obtenir par ce biais leur accession à la citoyenneté, et dans la même logique leur égalité avec les hommes. Un choix stratégique malheureux, peut-on dire rétrospectivement, à la suite de révolutionnaires hommes et femmes contemporains des suffragistes. Car la mobilisation nécessitée par cet objectif réformiste s’est effectuée au détriment de luttes bien plus porteuses de rupture avec le système patriarcal et capitaliste, notamment celles remettant en cause les rôles sociaux qu’il impose ou favorisant la libération sexuelle des femmes. Il a fallu attendre le milieu du siècle dernier pour que des mouvements de femmes soient ici et ailleurs porteurs de tels thèmes, d’essence libertaire. Mais le suffrage « universel » avait déjà permis (après 1848 seulement, car auparavant le vote était censitaire) a la bourgeoisie d’asseoir son pouvoir sur le territoire français au détriment de la classe ouvrière, en entretenant l’illusion pour celle-ci d’une participation par les urnes à la gestion de la société. Et le même suffrage, posé comme revendication principale et prioritaire, et finalement obtenu pour les femmes, a aidé dans l’intervalle cette même bourgeoisie à renforcer son pouvoir, en engageant semblable processus d’intégration à leur égard.
La Déclaration de l’État de Virginie proclame en juin 1776 pour la première fois que « tous les hommes sont nés également libres et indépendants », mais le refus de toute restriction au droit de vote fondée sur le sexe ne sera inscrit dans la Constitution américaine qu’en 1920. En France, le suffrage pour les femmes ne sera acquis qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les mouvements féministes de ces deux pays avaient des origines et des caractéristiques bien spécifiques (voir l’article suivant sur les États-Unis), et pourtant ils ont convergé vers un objectif identique — l’obtention des droits civils (liés entre autres à la famille et au patrimoine) et civiques (en particulier le droit de vote) — parce qu’ils étaient animés par des femmes appartenant aux classes moyennes et traduisaient avant tout leurs aspirations. Avant de voir ici comment s’est opéré un tel processus en France, trois remarques :
— la domination masculine demeure, suffrage universel ou pas, parité ou pas, une réalité dans les sociétés que nous connaissons, parce que celles-ci reposent sur un système d’oppression fondamentalement non aménageable par et/ou pour ses victimes ;
— la lutte contre la condition féminine n’est pas — parce qu’elle ne peut être — un tout homogène, du fait qu’il existe au sein des femmes, comme chez les hommes, des classes sociales défendant des intérêts bien particuliers. De là des disparités entre les revendications, ou des finalités différentes pour une même revendication, qu’il convient d’analyser comme telles pour ne pas se leurrer sur les enjeux respectifs ;
— les références et valeurs de notre époque, en particulier l’héritage laissé par le mouvement des femmes des années 1970, doivent être utilisées avec une extrême prudence pour les périodes antérieures, si on veut avoir une vision claire des combats qui y ont été menés.
FEMMES DU PEUPLE ET « FEMMES SAVANTES »
PENDANT LA « RÉVOLUTION » DE 1789
Des femmes des milieux populaires ont joué un rôle important dans la Révolution française, en particulier chaque fois que s’est posée de façon aiguë le problème des subsistances — par exemple, lors de la marche sur Versailles, les 5 et 6 octobre 1789, dans l’objectif de ramener à Paris « le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». En revanche, l’opposition à la déchristianisation est plutôt venue de femmes : certaines tentaient d’arrêter les charrettes qui transportaient les ornements arrachés aux autels, boycottaient les curés jureurs, protégeaient les réfractaires et organisaient le culte clandestin. Cette emprise de l’Église plus forte chez elles que chez les hommes constituera un des principaux arguments utilisés par les adversaires du suffrage pour les femmes jusqu’à ce que celui-ci soit accordé ; et, pour la contrer, la nécessité et l’urgence d’une éducation laïque sera constamment mise en avant, que ce soit par des républicaine-s et des socialistes de diverses obédiences ou par des militantes de la cause des femmes (l’utilisation du terme « féministe » n’intervenant qu’après 1880.)
Toujours est-il que les acteurs de 1789 marquent vis-à-vis des femmes une évidente méfiance — due à la fois à leur sexe et à leur classe, car les bourgeois arrivés au pouvoir ne feront jamais appel au peuple qu’en cas de nécessité. Si des femmes avaient été autorisées à voter dans les assemblées populaires du premier degré parce qu’elles étaient... propriétaires, les 1.150 députés aux états généraux sont tous des hommes. Surtout, plusieurs mesures et sanctions vont être prises dès 1793 pour renvoyer dans leur foyer les femmes ayant participé à la « révolution » : elles seront congédiées des armées et des assemblées politiques, leurs clubs et sociétés populaires seront fermés ; enfin, après les émeutes de prairial, un décret leur enjoindra « de se retirer dans leur domicile » et ordonnera « l’arrestation de celles qui se trouveraient attroupées au-dessus du nombre de cinq ».
Ce retour à la norme — observable en d’autres lieux et périodes — ne suscite guère de réactions, car la répartition homme/public et femme/privé est bien établie. De plus, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen permet, grâce au caractère prétendument universel de l’Homme avec un grand H, de nier non seulement les privilèges et inégalités foncières de conditions — les classes sociales — existant avant comme après la « révolution » mais aussi la domination masculine sur l’ensemble de la société. Pire, l’universalisme de la Révolution française, vaste mystification, demeure depuis interprété par nombre d’hommes et de femmes, de par le monde, comme une avancée vers l’égalisation des conditions, les droits de l’Homme et du citoyen étant sacralisés comme la quintessence de la civilisation et de la modernité...
Encyclopédistes et « lumières » en général étaient déjà persuadés que « chaque sexe avait une destination particulière qui dérivait de sa constitution physique » (Nouvel ami des femmes, 1779), donc qu’une détermination sexuelle des personnes imposait des rôles sociaux bien définis. Les constituants vont estimer sans réelle discussion sur la question que les chefs de famille seuls sont citoyens. Même Condorcet — pourtant auteur en 1790 d’un texte sur « l’administration des femmes au droit de cité » qui prône l’égalité absolue dans l’instruction entre les deux sexes — ne propose pas l’égalité politique, lors des débats sur la Constitution girondine de 1793... convaincu qu’elle est irréalisable.
Quelques rares oppositions, connues depuis, à cette opinion : le Journal des droits de l’homme de Labenette, qui publie le 10 août 1791 un texte en faveur des droits de la femme... avant de changer d’avis ; un pamphlet anonyme, Du sort actuel des femmes, imprimé par un Cercle social quelques jours après ; et surtout la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite par Olympe de Gouges début septembre 1791 et adressée à la reine, mais passée à peu près inaperçue.
En revanche, La Défense des droits de la femme de la publiciste anglaise Mary Wollstonecraft, qui paraît en 1792 à Londres, a un impact important dans plusieurs pays. L’auteure, une des nombreuses « femmes savantes » de son époque, y demande l’égalité des sexes dans l’éducation et l’instruction. Elle dénonce, au nom de la justice, de la logique et du progrès, l’attitude des révolutionnaires comme tyrannique, s’en prend à Rousseau qui a préconisé dans Émile le confinement familial pour les filles, et prône la mixité à l’école très tôt. Toutefois, son ouvrage est d’abord un manuel d’« éducation domestique », essentiellement centré sur les mœurs : il défend le rôle irremplaçable de l’école, pour assurer aux femmes leur perfectionnement et leur donner les moyens de diriger leur famille, de nourrir leurs enfants et d’accomplir leur « part du contrat social ».
Au cours des décennies suivantes, la question du droit de vote pour les femmes est rarement posée de façon explicite ; le plus souvent, on parle d’une égalité avec les hommes, guère plus définie. Sans doute parce que les périodes de République sont très brèves jusqu’en 1871, qu’on y recourt peu aux élections, et que de plus celles-ci sont réservées à quelques-uns...
Quoi qu’il en soit, les hommes de la Révolution française ne seront intervenus en faveur des femmes que sur la question du divorce, légalisé en 1792 avec l’instauration du mariage civil dans des conditions identiques pour elles et pour les hommes. Mais pour peu de temps : à la suite du Code civil napoléonien qui consacre l’incapacité juridique de la femme mariée,1 le divorce sera supprimé en 1816 — redevenant un thème de revendication féminin jusqu’à son rétablissement en 1884.
LES SAINT-SIMONIENNES DANS
LA « RÉVOLUTION » DE JUILLET 1830
On note une forte participation de femmes du peuple aux trois jours d’émeutes parisiennes que connaît le régime de Charles X fin juillet 1830. L’augmentation du coût de la vie les pousse à envahir avec des hommes les Tuileries, provoquant l’abdication du roi, le 2 août... au profit de Louis-Philippe d’Orléans.
Les idées de Saint-Simon connaissent alors un succès important en France (comme en Angleterre et aux États-Unis) ; ses disciples s’activent, en particulier sous l’impulsion du « père » Enfantin qui attire à lui nombre de jeunes ouvrières.2 Certaines d’entre elles (Suzanne Voilquin, Jeanne Deroin...), mettant en commun leurs économies, vont créer deux publications à partir de 1832 (La Femme libre puis La Femme de l’avenir) pour réclamer l’égalité juridique et politique entre les sexes, ainsi qu’une réforme totale des mentalités et comportements — par la libération sexuelle des femmes qui doit conduire à leur émancipation. Pour ces saint-simoniennes, l’affranchissement des femmes est lié à celui de la classe ouvrière ; elles critiquent l’éducation des petites filles, le travail ménager, revendiquent la restauration du divorce... et défendent la maternité.
Dans le même temps, des bourgeoises cultivées se lancent également dans le journalisme. Ces Mmes Legrand, Beaufort ou Bassignac qui craignent le peuple prônent la paix civile par l’harmonisation des intérêts entre les classes ; et elles défendent leur rôle social, souhaitant que les femmes n’aient plus besoin, par nécessité économique, de travailler pour pouvoir se consacrer à leur fonction de mère. Au cours du XIXe siècle, la « presse féminine » prendra ensuite de l’ampleur ; elle sera de plus en plus considérée comme l’instrument privilégié de moralisation de la classe ouvrière : peu à peu, l’ouvrière y deviendra la figure devant servir de médiation entre peuple et bourgeoisie, les sujets politiques y seront abordés... et ces publications seront dirigées par des hommes soucieux de faire passer le message que les femmes doivent rentrer au foyer. Si l’émancipation féminine sera un des thèmes couramment repris, le discours qui l’accompagnera demeurera empreint de vertu et morale, avec une défense du mariage et des bonnes mœurs.
La socialiste Flora Tristan, elle, va remettre l’accent sur la Déclaration des droits de l’Homme comme acte significatif dans l’affranchissement des femmes ; mais sans que cet affranchissement résulte d’une action menée par les femmes elles-mêmes : c’est le prolétaire qui doit accomplir une seconde révolution en proclamant les droits de la femme. « Prolétaires, il vous reste à vous, hommes de 1830, écrit-elle dans L’Union ouvrière de 1843, une œuvre non moins grande [que la Déclaration existante] à accomplir — à votre tour, affranchissez les dernières esclaves qui restent encore dans la société française, proclamez les droits de la femme. » (Par ailleurs, si elle milite pour le divorce, F. Tristan se distingue des militantes précédentes... et des suivantes en défendant également l’« amour libre ».)
MILITANTES SOCIALISTES DANS LA « RÉVOLUTION » DE FÉVRIER 1848
Sous Louis-Philippe ont lieu à partir de 1832 divers soulèvements ; la politique ultraconservatrice de Guizot favorise la haute bourgeoisie, tandis que se développe une grande crise économique et financière en 1846 et 1847. Le 23 février 1848 éclate une insurrection parisienne, après une campagne pour l’élargissement du suffrage censitaire. On constate une fois de plus la mobilisation de femmes des milieux populaires, que ce soit sur les barricades (parmi les 600 qui seront déférées à la prison de droit commun de Saint-Lazare, il y a un grand nombre de blessées) ou pour fabriquer des munitions. Cependant, la presse féminine n’en parle pas, car, de par leur position morale, sociale et idéologique, la violence de rue répugne à ses rédactrices.
Des femmes se réapproprient l’espace public (souvent avec leurs enfants), réalisant tracts, affiches et pétitions, organisant des réunions. Une délégation se rend auprès de Marrast, le maire de Paris, pour revendiquer le suffrage féminin, mais celui-ci se retranche derrière l’Assemblée, seule à pouvoir l’accorder. Des saint-simoniennes (Désirée Gay, Eugénie Niboyet...) vont fonder deux nouvelles publications :
— La Politique des femmes, qui reflète un courant socialiste autogestionnaire pacifiste. Il se fait l’écho de l’action mené par les ouvrières créatrices de clubs et d’associations, à la fois bonnes ménagère et militantes actives, et défend la famille et la nation avec de forts accents religieux ;
— La Voix des femmes, premier « quotidien socialiste et politique » de femmes. Républicain, mais ouvert aux courant fouriériste, communiste et oweniste, il devient l’instrument de militantes résolue à obtenir l’égalité politique pour les femmes. Il incite cependant à des actions modérées, pacifiques, et à ne pas descendre dans la rue ; il fait reposer la moralité de la nation sur celle des femmes, défend la famille et la patrie.
La République a de nouveau été proclamée, et le gouvernement provisoire dirigé par Lamartine cherche à remédier au chômage et à la misère par le biais d’ateliers nationaux. La Voix des femmes mène campagne pour que pareilles mesures soient appliquées aux femmes : souvent ouvrières à domicile, elles subissent à la fois une forte baisse de salaire et la concurrence du travail effectué dans les prisons, communautés, couvents, hospices et casernes. Les ateliers nationaux vont finalement employer 22.000 femmes et 115.000 hommes ; mais ils demeurent trop peu nombreux et mal organisés, et les salaires très inégalitaires. D’où de nouvelles manifestations et interventions d’ouvrières auprès du gouvernement.3
Dans les clubs de femmes apparus partout à Paris se déroulent des incidents, dus à des interventions masculines hostiles. Le recours à la non-mixité ne suffit pas à en empêcher d’autres... entraînant des fermetures de clubs. Ainsi celui de La Voix des femmes, qui encourageait les ouvrières à se regrouper en associations et corporations ; réclamait une baisse du temps de travail, des crèches et des garderies ou le développement du travail à domicile.
Le 2 mars, le suffrage universel est accordé aux... hommes ; le 4, la liberté totale de la presse et du droit de réunion.
L’aide aux ouvrières sans emploi est supprimée le 15 avril ; des travaux effectués pour les mairies d’arrondissement sont payées au-dessous du tarif du marché. Le 2 mai, une commission gouvernementale examine 640 pétitions adressées par des ouvriers et ouvrières de toutes les industries de France. 63 émanent de femmes — qui sont surtout employées comme blanchisseuses, et dans les métiers de l’aiguille et de la mode ; mais la commission exclut ces métiers, tandis que les maires avouent considérer le travail féminin comme l’un de leurs « plus sérieux embarras ». De émeutes de femmes ont lieu à Paris et Saint-Étienne : elles attaquent la Garde nationale, il y aura des blessées et de mortes dans leurs rangs.
Le 23 juin, des barricades sont dressée dans Paris, mais la ville est reprise militairement par le « boucher » Cavaignac. Près de 20.000 personnes sont arrêtées. La Politique des femmes participe au refoulement collectif de la canonnade et de la violente répression qui la suit — tribunaux d’exception et peine de « transportation » (déportation) reflétant la grande peur qu’a eue la bourgeoisie.
La Politique des femmes, disparu avec d’autres titres, est remplacé par L’Opinion des femmes, journal que réalisent des ouvrières (J. Deroin, P. Roland...) qui parlera surtout des femmes, et présentera une « pensée d’amour et de paix ». Dépolitisé, il en arrive à défendre la propriété et l’ordre, à partir de la famille (avec un mariage établi sur la fidélité), et de la peur des socialistes qui arment les ouvriers. La sauvegarde réside en la femme : elle doit faire triompher l’esprit du bien contre l’homme. « Nous réclamons constamment, non seulement comme un droit mais par devoir et par dévouement, l’égalité civile et politique de la femme, expliqueront ses rédactrices, parce que nous avons la conviction profonde que l’organisation sociale ne peut être complète et durable sans le secours des deux sexes. Nous appellerons de tous nos vœux et de tous nos efforts le règne de Dieu sur Terre. »
Cependant, le décret qui exclut les femmes des clubs et réunions politiques va amener J. Deroin à se radicaliser, notamment en se présentant aux législatives de la Seine « pour l’égalité civique et politique des deux sexes » sous la bannière des socialistes, mais sans avoir vraiment leur appui... et en polémiquant avec Proudhon, qui est très hostile aux droits politiques des femmes.
Lorsqu’elle veut créer une Union des associations, la répression s’abat sur son journal. En 1850, elle est condamnée avec P. Roland à six mois de prison pour appartenance à société secrète. (L’année suivante est supprimé le droit de pétition que les femmes avaient depuis la Constitution de 1791...) J. Deroin part ensuite vivre en Angleterre ou, avec d’autres ex-saint-simoniennes, elle publie L’Almanach des femmes — soutenant les droits politiques des femmes, mais aussi la pureté par la chasteté, à travers une défense de la virginité, et incitant les lectrices à fonder des sociétés de femmes pour s’entraider.
En 1850 paraît en Angleterre The Subjection of Women de John Stuart Mill, qui constituera une référence pour toute l’Europe concernant l’assujettissement des femmes. En effet, à partir de là, l’émancipation des femmes est dissociée de l’émancipation ouvrière, et devient un projet politique réformiste : les partisan-e-s de l’égalité des sexes s’inspirent des courants libéraux et démocrates, qui établissent la prédominance de la notion de droit au cœur de la pensée politique, mais en intégrant les femmes dans cette démarche. Une réforme législative et morale ainsi qu’un juste équilibre entre les droits et les devoirs de chaque personne vont désormais être recherchés à travers une mobilisation spécifique sur les droits des femmes, sans plus attendre une transformation révolutionnaire de la société.
En France, J. d’Héricourt fait la transition entre la génération de 1830-1848 et celle de 1860. Dans La Femme affranchie, réponse a MM. Michelet, Proudhon, E. de Girardin, A. Comte et autres novateurs modernes, elle rend hommage au saint-simonisme et met encore en parallèle le sort des femmes et celui du prolétariat ; mais elle appelle de ses vœux « la création d’un journal indépendant de toute secte sociale et des questions politiques et religieuses ». La prise de conscience politique des femmes va s’accompagner de leur droit à l’activité professionnelle, élargissant les revendications du suffrage féminin et du divorce ; et la rupture avec les courants révolutionnaires va aller de pair avec des critiques plus vives par rapport au christianisme. Il ne s’agit pas, pour ceux et celles qu’on appellera bientôt les suffragistes, de prendre le pouvoir, mais plutôt d’avoir des pratiques de lobbying : pétitions, recherche d’alliés chez les élus... Cette nouvelle vague de mobilisation, d’abord en Angleterre et aux États-Unis, n’atteindra la France qu’avec la libéralisation du Second Empire en 1868.
Dans le salon de Charles et Maxime Fauvety se côtoient alors des femmes de lettres vivant assez bien de leur plume — des ex-quarante-huitardes (J. d’Héricourt, E. Niboyet, Élise Lemonnier) et une nouvelle génération : Jules Daubié (la première bachelière, en 1861), Adèle Esquiros, Paule Minck,4 Élisa Gagneur (femme d’un fouriériste), André Léo et Maria Deraismes. Ces deux dernières auront un rôle important — dans la Commune pour la première, dans l’évolution du mouvement des femmes pour la seconde.
L’écrivaine M. Deraismes, bourgeoise aisée et républicaine, a participé en 1866 à la création de la première organisation féministe, la Société pour la revendication des droits de la femme, avec P. Minck, A. Léo, M. Verdure, Louise Michel et les sœurs Reclus. Elle s’emploie ensuite avec Léon Richer, franc-maçon et lui aussi républicain, à développer des liens entre groupes de femmes, parti républicain, Libre Pensée et franc-maçonnerie pour construire un mouvement d’émancipation féminine laïque. En avril 1869, elle lance (avec J. Daubié, J. d’Héricourt, E. Gagneur...) le journal Le Droit des femmes (68 numéros jusqu’en août 1870) qui s’attaque au Code civil et à l’oppression des femmes analysée comme un fait de culture, une « invention humaine ». Mais la femme a un rôle spécifique à tenir : ministre des finances du ménage, elle doit être mariée car le mariage est une institution nécessaire, et mère car la maternité est son « travail » le plus important et le plus respectable. Quant au droit de vote féminin, il est soumis au préalable de l’éducation (comme chez Michelet, qui soulignait en 1850 : « Accorder aux femmes le droit de vote immédiatement, ce serait faire tomber dans l’urne 80.000 bulletins pour les prêtres »).
En avril 1870, L. Richer forme une Association pour le droit des femmes (qui comptera une centaine d’adhérent-e-s) pour « proclamer hautement l’égalité des sexes devant la loi et les mœurs », promouvoir l’instruction et l’égalité des droits dans la famille, au travail... La tendance républicaine et bourgeoise laïque prend ainsi de l’ampleur, et reflète un courant féminin très attaché à la famille (le concubinage étant jugé aussi inadmissible et à combattre que la prostitution).
André Léo, elle, sera journaliste à La Sociale, au Rappel et à La Commune. Républicaine socialisante liée aux milieux saint-simoniens et coopératifs (notamment par son compagnon Malon), elle assimile l’infériorité sociale et civique de la femme à celle du paysan, et estime que sa cause doit être soutenue avec la cause socialiste, du fait de la double oppression subie par les ouvrières. En 1868, elle crée la Ligue en faveur des droits de la femme, avec un premier manifeste guère revendicatif — la peur de la répression incitant à ne pas se mobiliser pour l’inscription des femmes sur les listes électorales, mais plutôt à fonder une école primaire libre de filles. Cependant, un second manifeste — signé par E. Gagneur, Maria Verdure, ainsi que des anarchistes militantes (Louise Michel, Marthe-Noémie Reclus) et militants (Élie Reclus, Gustave Francolin), et publié l’année suivante dans Le Droit des femmes se révèle plus revendicatif sur les droits civils « refusés à la moitié de la nation ».
LES COMMUNARDES DE PARIS AU PRINTEMPS 1871
Les différences de classe entre des bourgeoises comme M. Deraismes et les ouvrières parisiennes vont ressortir très clairement pendant la Commune, par leurs préoccupations respectives :
— les premières, qui militent pour une reconnaissance des femmes dans la société existante par l’obtention des droits civiques, recherchent une intégration dans la vie publique grâce à des réformes institutionnelles. Elles ne veulent en général pas se mêler à la classe ouvrière (sauf par quelque action philanthropique), la « populace », et mettent en avant l’institution du mariage,5 ainsi que l’accès des femmes à l’éducation comme moyen d’ascension sociale. De même, elles s’emploient à démanteler le Code civil afin d’acquérir la maîtrise de leurs biens — un problème qui ne concerne guère les ouvrières ;
— les secondes sont surtout préoccupées d’avoir du travail (les deux tiers travaillent en ateliers, le reste comme domestiques ou concierges) et de le réaliser à un « bon » prix. Leur salaire étant très bas, elles n’échappent à la misère que par la vie en concubinage (un tiers des ménages ouvriers parisiens, avec un pourcentage presque identique de naissances « illégitimes » ; 60 % des femmes qui seront arrêtées à la fin de la Commune sont en union libre). Par ailleurs, un certain nombre d’ouvrières sont politisées : une vingtaine signeront début juillet 1870 le manifeste de protestation de l’Internationale contre la guerre. Dans le mouvement ouvrier, socialistes, anarchistes ou communistes considèrent souvent l’accès à l’éducation pour les femmes comme un élément déterminant, mais tant pour leur prise de conscience politique que pour leur autonomie économique ; enfin, l’éducation sexuelle deviendra plus tard un point très important à leurs yeux.
Lorsque la République est proclamée pour la troisième fois en France, le 4 septembre 1870, la guerre contre la Prusse débouche sur une défaite. Le 8, un appel « Aux femmes de Paris », signé de Mmes Dereure (qui sera membre de la Commune), Lebéhor (blanquiste), L. Michel et Octavie Tardif, vise à organiser les soins aux blessés et l’aide aux indigent-e-s. Des associations philanthropiques apparaissent pour gérer les ambulances, distribuer des repas aux enfants et installer un atelier de travail (A. Léo, O. Audouard et M. Deraismes y participeront). Le 22, une manifestation de femmes (avec, là encore, A. Léo et L. Michel...) revendique d’aller aux remparts relever les blessés. Un comité de vigilance des femmes (semblable aux comités d’hommes par arrondissement) se forme à Montmartre, animé par L. Michel, A. Léo, Jeanne Alambert et Sophie Poirier. Des activités de bienfaisance sont menées par la Solidarité des Batignolles, grosse section de l’Internationale que dirige la veuve Fernandez et à laquelle se joignent A. Léo et Malon. Des femmes de Montmartre et des Batignolles seront partie prenante dans la dernière émeute du siège de Paris par les Prussiens, devant l’Hôtel de Ville, le 22 janvier 1871. Un comité de femmes est aussi impulsé rue d’Arras par Jules Allix, futur membre de la Commune, républicain socialiste et partisan de l’émancipation féminine.
Une nouvelle Assemblée nationale est élue le 8 février, mais le 18 mars le Paris populaire, républicain — et très patriote — s’insurge contre le gouvernement de Thiers, qui vient de décider la paix et est soupçonné de préparer une restauration royaliste. A Montmartre, des hommes et des femmes (dont L. Michel) reprennent les canons de la Garde nationale aux troupes du gouvernement, lequel se réfugie à Versailles. Le 26, Paris élit une Commune qui aura deux préoccupations principales jusqu’à sa fin : le travail et le combat.
Une commission du travail et de l’échange animée par Frankel, membre de l’Internationale socialiste, s’attelle à mettre en place des institutions républicaines neuves. Mesure étonnante pour l’époque, la Commune accorde pension aux femmes des gardes nationaux tués au combat et à leurs enfants, et déclare prendre en charge leur éducation... qu’ils soient légitimes ou non — autrement dit, elle passe par-dessus l’institution du mariage.
Le 11 avril, la marxiste (russe d’origine aristocratique) Élisabeth Dmitrieff constitue une Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés qui lance, dans le Journal officiel de la Commune, un appel « aux citoyennes prêtes à servir soit aux ambulances ou fourneaux, soit aux barricades », et cherche à « organiser le mouvement des femmes par rapport à la défense de Paris », tout en se proclamant pour la « guerre à outrance ». Cette Union (à laquelle 300 femmes auraient appartenu) s’intéresse avant tout au travail des femmes, préconisant sa réorganisation générale à partir du recensement et de la réquisition des ateliers existants, et des comités d’arrondissement. Une socialisation du travail est tentée dans le textile (à travail égal, salaire égal hommes-femmes ; baisse du temps de travail à huit heures...).
En matière d’éducation, la Commune va faire avant tout œuvre laïque : s’il n’y a pas de vrai problème de scolarisation à Paris, où garçons et filles de sept à treize ans vont à l’école, il s’agit de les dégager de l’enseignement religieux (en particulier les filles) et de leur enseigner l’instruction civique. Vaillant, délégué à l’enseignement, mobilise les institutrices républicaines, et une commission est désignée pour surveiller l’éducation dans les écoles de filles (A. Léo et M.-N. Reclus en feront partie). Le 26 mars est créée une Société de l’éducation nouvelle (dont M. Verdure, H. Garosle et Louise Laffitte) qui propose une refonte générale des programmes et des méthodes pédagogiques neuves. Une Société des amis de l’enseignement est également animée par M. Verdure pour mettre sur pied un enseignement professionnel gratuit...
Il n’est donc guère question de droits politiques pour les femmes : seule A. Léo en parle, sans rencontrer de véritable écho. Même le Comité féminin de vigilance de Montmartre est avant tout un lieu de discussion. Cependant, beaucoup de prises de parole féminines ont lieu dans les clubs, et si, au début, les femmes ne peuvent y participer aux votes, les choses évoluent vite. La plupart de ces lieux sont mixtes, certains exclusivement féminins, et on y compte des « oratrices » très populaires, qui vitupèrent contre les curés ou le mariage. De plus, bien des communardes ont sans nul doute le sentiment de participer aux côtés des hommes à l’œuvre de « régénération », et l’heure n’est sans doute pas pour elles dans la recherche d’un droit de suffrage, alors inutile. Certaines ont des responsabilités réelles dans la Commune, et d’autres s’estiment « citoyennes » en étant cantinières de bataillon, ambulancières ou combattantes, parce qu’elles sont patriotes. (Une centaine d’entre elles vont demander des armes à la Commune. La Légion des fédérées du 12e arrondissement est organisée par le Comité des républicaines pour rechercher les « franc-fileurs », autrement dit les réfractaires au combat... Des femmes comme N. Lemel, de l’Union des femmes pour la défense de Paris, seront sur les barricades, et B. Lefebvre sera tuée à Montmartre... mais la participation féminine demeure peu forte sur le plan militaire.)
Début avril, Paris est cerné par l’armée régulière. La Semaine sanglante, du 21 au 28 mai, fera 20.000 victimes, et il y aura 40.000 arrestations (dont un millier de femmes, qui cette fois n’échapperont pas toutes à la « transportation ») pour participation présumée à l’insurrection.
Après ces événements reparaît Le Droit des femmes sous le nom de L’Avenir des femmes, avec les mêmes rédactrices sauf André Léo — désavouée pour avoir justifié la Commune au Congrès de la paix qui l’a suivie à Genève. En juin 1872, un banquet patronné par Victor Hugo saluera le lancement d’une Société pour l’amélioration du sort de la femme et la revendication de ses droits par M. Deraismes, L. Richer, trois anciennes de la Commune (H. Garoste, L. Laffitte et Julie Thomas), ainsi qu’Hubertine Auclert — la première à se définir, en 1882, comme féministe.
MILITANTES SOCIALISTES ET
« FÉMINISTES BOURGEOISES »
À LA FIN DU XIXe SIÈCLE
La Ligue internationale des femmes, fondée en Suisse par Marie Goeff Pouchoulin en 1869, montre que les droits politiques ne sont pas encore une priorité pour les mouvements féminins : elle se mobilise sur la libre disposition des biens et du salaire de la femme mariée, la mise en place d’une éducation secondaire de qualité, l’accès à l’université, le droit d’exercer toutes les professions et les droits civils. Les premiers groupes suffragistes apparaîtront en Angleterre d’abord, avec le phénomène original des suffragettes (voir encadré), et le combat spécifique du suffrage féminin ne commencera vraiment dans les autres pays européens et aux États-Unis qu’après 1900.
Sous l’influence de M. Deraismes et L. Richer, la revendication féminine sous la IIIe République s’en tient à la réclamation des droits civils, par peur à la fois de la répression et des conséquences que pourrait entraîner l’impact encore marqué de la religion sur les femmes, si elles devenaient électrices. H. Auclert, en désaccord avec cette ligne, écrit Le Droit politique des femmes, question interdite du congrès de 1878 ; puis elle fonde en 1881 le journal La Citoyenne (qui paraîtra jusqu’en 1891) et le groupe le Suffrage des femmes en 1883 ; mais sa démarche demeure marginale par rapport à l’ensemble du mouvement féminin. Toutefois, M. Deraismes change de stratégie au cours des années suivantes, en constatant que, d’une part, la République semble désormais assez solide pour résister au vote clérical des femmes (lesquelles se détachent de plus lentement de l’emprise religieuse) et que, d’autre part, ce vote sans doute encore plus conservateur que celui des hommes peut être utile pour contrer les socialistes, qu’elle n’aime pas. La Ligue française pour le droit des femmes, créée par elle en 1882, met en avant le suffrage féminin.
Mais, à la fin du XIXe siècle, l’entrée massive des femmes dans le salariat pose de plus en plus fort aux syndicats et groupes révolutionnaires le problème de leur place dans la production économique et dans les mouvements sociaux, et de la nécessaire liaison entre lutte ouvrière et lutte des femmes. Le travail féminin s’est développé dans les campagnes avec l’industrie du textile, et d’autres secteurs ont embauché des femmes depuis 1850 : dès 1866, 30 % de la main-d’œuvre industrielle totale est féminine (répartie entre le travail des étoffes et les industries de transformation — alimentaires et chimiques), mais avec un niveau de salaires très bas (la moitié des salaires masculins), ce qui suscite l’inquiétude des syndicats. Et bientôt va se déclencher une véritable bataille entre militant-e-s socialistes et « féministes bourgeoises » — lesquelles sont pour certaines bourgeoises par leur origine sociale, mais pour d’autres plutôt par leur « esprit bourgeois » et leur absence de « conscience de classe », vu les revendications qu’elles posent (davantage porteuses d’intégration que de changement révolutionnaire) et leur recours aux institutions pour obtenir gain de cause.
La participation croissante des femmes à l’industrie entraîne certaines oppositions de la part des hommes — travailleurs et même syndicalistes — dans le monde entier. Si l’Association internationale des travailleurs (AIT) prône, dès son 1er congrès à Genève en 1866, l’émancipation des femmes avec l’abolition de la famille, de fortes réticences à leur entrée dans les usines y sont exprimées. En particulier, la section française, sous influence proudhonienne, y présente une motion condamnant le travail des femmes et déclarant que leur vraie place est au sein de leur famille (seul Eugène Varlin s’élèvera contre, parmi ses délégués). De plus, des militant-e-s révolutionnaires, syndicalistes ou non, estiment que la condition des femmes sera complètement et automatiquement transformée par la révolution (la Révolution russe entretiendra brièvement cette illusion) ; ou que c’est un problème secondaire par rapport à la condition ouvrière et à la lutte à mener pour abolir le salariat.
La première grève de femmes, celle des ovalistes lyonnaises en 1869, reçoit un généreux soutien de l’Internationale. Cependant, la position de la CGT sur le travail féminin demeure souvent ambiguë : ainsi, en 1898, elle préconise encore que « l’homme nourrisse la femme », mais que, dans le cas des veuves et des filles forcées de subvenir à leurs besoins, la formule « A travail égal salaire égal » soit appliquée.
LES SUFFRAGETTES ANGLAISES
Dans les années 1850, le mouvement suffragiste anglais a adopté une stratégie légaliste et prudente pour faire pression sur les parlementaires : pétitions, conférences, journaux et adhésions à la National Union for Women’s Suffrage Societies, fondée en 1897 par Millicent Garrett Fawcett. Celle-ci demande l’égalité entre les sexes au nom de leur différence, ce qui correspond bien aux aspirations identitaires des femmes de la Belle Époque en Europe (elle déclarait déjà en 1891 : « Nous ne revendiquons pas la représentation des femmes parce qu’il n’y a point de différence entre les hommes et les femmes, mais au contraire à cause de cette différence entre eux. ») En 1905, la Women’s Social and Political Union (WSPU) qu’ont créée deux ans plus tôt Emmeline Pankhurst et sa fille Christabel fait parler d’elle pour la première fois, quand deux de ses militantes sont emprisonnées pour avoir refusé de quitter un meeting libéral. Celles que la presse va appeler suffragettes développent alors des actions violentes. M. Pelletier, seule militante française avec C. Kauffmann à accepter une invitation à la grande manifestation du WSPU le 21 juin 1908 à Londres, sera très impressionnée par les 500.000 femmes en uniforme qui avancent sur Hyde Park en 7 cortèges très disciplinés. En 1909, ces militantes brisent régulièrement les vitres des bâtiments officiels, et leurs manifestations deviennent de plus en plus dures. Le « vendredi noir » 18 novembre 1910 tourne à l’émeute et fait plus d’une centaine de blessées. Des arrestations ont lieu jusqu’en 1912 ; les suffragettes emprisonnées demandent en vain le statut de prisonnier politique, et, quand elles font la grève de la faim, la plupart d’entre elles sont nourries de force. En 1913, des bombes sont posées à plusieurs reprises dans des lieux publics. Après l’attentat par Mary Richardson contre la Vénus de Velasquez à la National Gallery, l’entrée des musées est interdite aux femmes. Les suffragettes sont désormais semi-clandestines. Le sentiment qu’elles avaient déjà d’être investies d’une mission spirituelle et purificatrice grandit encore, exaltant leur sentiment sacrificiel. C’est alors qu’Emily Wilding Davidson se jette sous le cheval du roi pendant le Derby du 4 juin 1913 et meurt des suites de ses blessures. Son enterrement sera l’occasion d’une procession de plus de 2.000 suffragettes. Mais l’emploi de la force pour nourrir les détenues impressionne l’opinion publique : la répression sert l’idée d’un combat politique... qui n’aboutira cependant pas avant 1928.
En 1879, H. Auclert a fait inscrire le suffrage féminin et l’égalité des sexes dans le programme du parti socialiste, à son congrès de Marseille : « Femmes et prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». (La même année paraît La Femme dans le passé, le présent et l’avenir d’A. Bebel.)
Critiquant le conservatisme du mouvement féminin, plusieurs groupes de femmes socialistes vont apparaître (en 1880, l’Union des femmes ; en 1890, la Solidarité des femmes...) pour faire avancer dans le parti la question de l’émancipation féminine. Mais ni la candidature de Léonie Rouzade aux municipales de 1881 ni celle de Paule Minck aux législatives de 1893 ne bénéficient vraiment de l’appui des socialistes. En 1899 voit le jour un Groupe féministe socialiste qui vise la conquête des droits pour les femmes, mais comme « un moyen pour préparer l’éducation socialiste des femmes », non comme un but. Le courant socialiste féminin reproche — à juste titre — aux « féministes bourgeoises » de mener une politique de collaboration avec le pouvoir en place, par ses pratiques de lobbying. Des articles assez virulents paraissent contre elles dans le journal La Femme socialiste qu’a lancé L. Saumoneau, couturière devenue journaliste, avec E. Renaud en 1901. Du côté des « féministes bourgeoises », la presse qui a pris de l’ampleur (on comptera une vingtaine de périodiques avant 1914) répond à la polémique. En particulier le quotidien La Fronde, qu’a fondé Marguerite Durand en décembre 1897, et qui recueillera jusqu’en 1905 des signatures connues comme celle de la journaliste libertaire Séverine.
Quand, en juin 1902, une grève est faite par des ébénistes pour demander l’exclusion des femmes de leur métier, le Groupe féministe socialiste défend le travail des femmes en demandant leur syndicalisation et un salaire égal. Mais le cas n’est pas isolé, et le règlement d’autres conflits déclenche des réactions assez violentes de part et d’autre. Selon Madeleine Guilbert (Les Femmes et l’Organisation syndicale avant 1914), il y a entre 1890 et 1908 54 grèves d’hommes pour obtenir des renvois de femmes. Cette opposition va conduire des féministes à impulser la création de syndicats de femmes (typotes, dactylos, caissières comptables, fleuristes plumassières, sages-femmes) — parfois en opposition à des syndicats masculins qui accusent les femmes de casser les salaires et d’être des concurrentes déloyales sur le terrain économique —, et M. Durand à recourir aux autorités contre eux.
Après l’affaire Couriau en 1913 déclenchée lorsque Louis Couriau est radié de la CGT du Livre, à Lyon, pour avoir « laissé » sa femme Emma exercer la typographie et l’avoir « laissée » demander son adhésion au syndicat —, la CGT favorise l’entrée des femmes dans ses syndicats, où des militantes et des militants se battent déjà pour faire avancer cette adhésion, ainsi que l’égalité des salaires entre les deux sexes. (Dans d’autres syndicats et métiers, des militantes, comme Marie Guillot à travers la revue L’École émancipée, s’activent à faire avancer la cause des femmes.) Du côté de la SFIO, fondée en 1905, la participation des femmes est très faible : elles sont 5 parmi les 286 délégués cette année-là... et 1 sur 215 en 1914. Mais l’Internationale socialiste évolue quelque peu, notamment sous l’influence de Clara Zetkin et d’Alexandra Kollontaï. En Allemagne, où l’IS compte 30.000 adhérentes au début du XXe siècle, C. Zetkin fonde le journal socialiste féminin L’Égalité. A la première Conférence internationale des femmes socialistes, tenue à Stuttgart en 1907, elle est désignée pour s’occuper d’un secrétariat indépendant des femmes au sein de l’Internationale ; au congrès de Copenhague, la même année, elle propose la création d’une Journée internationale de la femme. L’IS appelle aussi à constituer des groupes de femmes dans chaque pays et vote une résolution sur le suffrage féminin. Conformément à ses directives, un autre groupe de femmes socialistes se constitue en France en 1913 ; il attire des féministes de gauche (Marie Bonnevial, Hélène Brion, Marguerite Martin et Maria Verone), mais la rupture suit presque aussitôt ; le groupe décide ensuite de ne plus recruter hors du parti... et ne s’occupe plus guère des problèmes des femmes. La volonté de rompre avec les tactiques des « féministes bourgeoises » conduit certaines militantes socialistes à ne pas appuyer la revendication des droits ; pour d’autres, l’égalité politique poursuivie comme une fin est un leurre : elle ne doit être qu’un moyen, un acheminement vers l’égalité économique que le triomphe du socialisme réalisera. Diverses polémiques se développeront — ainsi L. Saumoneau, dans L’Équité (« organe éducatif du prolétariat féminin » fondé par Marianne Rauze), La Bataille syndicaliste et La Voix du peuple, critiquera le soutien apporté par les « bourgeoises » aux grèves des ouvrières, ou la création de syndicats féminins destinés à mettre les secondes sous la coupe des premières...
Hors du monde du travail, les associations de femmes se multiplient en France dans le même temps sur des sujets précis, comme la libre disposition de leur salaire par les femmes mariées. Il y en aura une soixantaine à la veille de la Première Guerre mondiale. Ce dynamisme et cette effervescence, observable ailleurs en Europe, proviennent en partie du mouvement philanthropique féminin, qui se sensibilise aux droits des femmes et se met à demander des réformes égalitaires : conseils juridiques gratuits, pétitions, campagnes de presse, propositions de textes législatifs vont pleuvoir. En 1888 s’est formé un Conseil international des femmes sous l’impulsion des féministes américaines. Au début de 1900, les mouvements féministes européens en sont encore à un succès d’estime : les groupes de femmes sont sortis de leur isolement, les manifestations en Angleterre rassemblent plusieurs milliers de suffragistes, et des réformes ont été obtenues sur divers plans ; mais ces mouvements restent de faible ampleur, avec des composantes pas toujours très actives, et ils ne sont pas représentatifs des femmes en général. De plus, ils n’échappent pas à une certaine instrumentalisation de la classe politique et financière. Ainsi La Fronde doit-il bien plus à son financement jusqu’en 1903 par le baron G. de Rothschild qu’à ses abonnements les moyens de payer bien ses collaboratrices...
Cependant, l’adoption — au Congrès de la condition et des droits de la femme qu’organise tous les quatre ans M. Durand depuis 1892 — du suffrage féminin comme revendication officielle va constituer un tournant important pour la revendication féministe en France. Le mouvement suffragiste s’y développera ensuite jusqu’en 1930, faisant preuve d’inventivité. En 1901, un timbre tiré à 250 000 exemplaires montre non la commémoration de la Déclaration des droits de l’Homme, mais, par une inversion de l’allégorie républicaine officielle, un homme en train de tenir les tables des droits de la femme. D’autres moyens plus classiques seront utilisés : pétitions, manifestations, diffusion d’objets publicitaires, refus argumenté de payer les impôts... et conférences de M. Durand, H. Auclert, M. Pognon, H. Brion ou Nelly Roussel sur la condition des femmes.
A l’Exposition universelle de 1900 se tient un stand de féministes, mot devenu à la mode, mais qui englobe à la fois les « modérées » (dans la tradition philanthropique, pour l’action sociale et familiale) et les « radicales » (pour l’intégration des femmes dans la cité à égalité avec les hommes). Car le mouvement féministe français est complexe dans sa composition. Certaines de ses militantes — souvent des jeunes femmes en réaction face aux maigres débouchés qui leur sont offerts, comparé à l’instruction qu’elles ont reçue — ne se contentent pas de réclamer leur place dans la société telle qu’elle est, et critiquent l’Église ou l’État autant que la domination masculine ; elles n’occupent pas des postes dirigeants (on compte alors en France 1 avocate et 30 docteurs femmes). En revanche, dans la masse d’institutrices, secrétaires ou demoiselles des postes sensibilisées au discours féministe, différentes couches sociales sont représentées ; aussi les groupes existants ont-ils des conceptions assez contradictoires. Trois grands courants féministes coexistent au début du XXe siècle : le Congrès catholique des institutions féminines, le Congrès des œuvres et institutions féminines (protestant) et le Congrès
international de la condition et des droits des femmes — le plus important au plan numérique, le plus « à gauche »... et celui avec qui le mouvement révolutionnaire a maille à partir.
Cette « gauche féministe » comprend elle-même plusieurs groupes, représentés respectivement par un journal : Le Suffrage des femmes d’H. Auclert ; La Solidarité des femmes, crée en 1891 par Eugénie Potonié-Bonnevial et son mari (socialistes saint-simoniens non révolutionnaires), Caroline Kauffmann et Madeleine Pelletier ; La Ligue du droit des femmes, de M. Pognon et M. Bonnevial ; ainsi que La Fronde de M. Durand. Le programme social de cette tendance est devenu assez vaste : à travail égal, égalité des salaires avec les hommes ; ouverture des carrières ; libre disposition du salaire et et organisation professionnelle des femmes ; limitation du temps de travail identique pour les deux sexes ; abolition des lois d’exception et de la concurrence du travail des couvents et des prisons ; assimilation du travail des domestiques à celui des ouvriers ou des employés ; congé de maternité de six semaines à la charge de l’État.
De 1878 à 1913, les féministes multiplient conférences, meetings et congrès sur la cause des femmes. La Fronde mène en 1899 campagne pour la révision du Code civil, le droit à la maternité volontaire, la suppression de la réglementation sur la prostitution (qui pénalise seulement les femmes), l’émancipation économique... et le droit de vote pour les femmes. Après des années d’efforts en ce sens, la section française du Conseil international des femmes (fondé aux États-Unis en 1888) naît en 1901 : le Conseil national des femmes françaises (CNFF) regroupe 160 associations dans les années 20, avec 150.000 adhérentes annoncées. Ses déléguées, reçues par le Président Poincaré en 1913, demandent l’égalité des salaires à travail égal, la coéducation laïque, l’accès à l’enseignement supérieur, la refonte égalitaire du Code civil, la recherche en paternité, des facilités dans le divorce... mais surtout les droits politiques, clé de voûte de tous les autres droits à leurs yeux.
En 1904, l’Alliance internationale pour le suffrage des femmes apparaît à Berlin et, en 1909, l’Union française pour le suffrage des femmes à Paris. Elle sera dirigée par Jeanne Schmahl, puis par Cécile Brunschvicg jusqu’en 1946, et revendiquera 12.000 membres en 1914.
Le lobbying porte ses fruits : un groupe parlementaire pour le droit des femmes affirme compter 200 inscrits en 1906, et 250 après 1918. Figures de gauche : Ferdinand Buisson, Marcel Sembat, Jean Jaurès, René Viviani ; et de droite : Louis Marin. Partis politiques et Églises s’intéressent désormais de près à la question. Au 1er congrès du parti communiste, en 1920, est créée une section féminine qui attire des féministes de gauche (dont M. Pelletier), la plupart pour une courte durée. D’autres partis imitent le PC : M. Durand entre au parti républicain socialiste, C. Brunschvicg et Marcelle Kraema-Bach au parti radical (où elles se montrent beaucoup moins virulentes). Les catholiques s’en mêlent : Benoît XV se positionne en 1919 pour le vote des femmes, car celui-ci, toujours réputé conservateur, est susceptible de constituer le meilleur des remparts contre la contagion révolutionnaire. Et la position de l’Église accélère le processus : création en 1925 d’une Union féminine civique et sociale par Andrée Brutillard et d’une Union nationale pour le vote des lemmes par Mme Levert-Chotard (qui déclarera 100.000 adhérentes en 1939) ; en 1929, de la Fédération nationale des femmes par Aimée Bazy... Un suffragisme catholique très sage, qui défend la famille traditionnelle, avec un mari en chef incontesté, et une épouse gardienne de son rôle de mère et des bonnes œuvres. La recherche de droits nouveaux s’accompagne donc ici d’une réaffirmation des devoirs sacrés de l’épouse et de la mère.
MILITANTES NÉOMALTHUSIENNES
ET PACIFISTES AUTOUR DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
En fait, de profondes divergences existent au sein du mouvement féministe, et des clivages entre une grosse majorité et une petite minorité s’opéreront sur deux grandes questions : le pacifisme et la libération sexuelle, en même temps qu’ils créeront des ponts entre cette petite minorité et certains courants révolutionnaires en particulier anarchistes, par le biais du courant néomalthusien.6
Pendant la guerre de 14-18, en effet, le mouvement féministe pratique largement l’Union sacrée (comme d’ailleurs une très grande partie du mouvement révolutionnaire)... En pure perte, car si l’Assemblée nationale vote en 1919 la réforme du suffrage électoral en faveur des femmes, le Sénat, bastion du radicalisme, refuse en 1922 d’en discuter. L’agitation suffragiste reprend de ce fait, mais davantage sur le modèle des suffragettes anglaises — avec des interventions dans les campagnes électorales, les meetings politiques ou les discussions parlementaires, et des manifestations et actions dirigées surtout contre le Sénat. La Ligue française pour les droits des femmes de M. Verone, notamment, fait montre d’une grande activité. Aux municipales de 1925, sur 80 candidates qui postulent à Paris, 10 sont élues, mais rejetées par le Conseil d’État (une communiste exercera malgré tout son mandat à Malakoff).7
Cependant, nombre de féministes persisteront, contre la marée patriotique qui noie l’internationalisme en 1914, à défendre une position pacifiste — certaines dans les syndicats, la CGT et surtout l’École émancipée. Elles enverront en 1915 un texte affirmant leur solidarité au Congrès de la paix, auquel le CNFF a pour sa part refusé de participer. Certaines d’entre elles passeront en conseil de guerre pour défaitisme — comme H. Brion, institutrice et syndicaliste qui, en 1917, en profitera pour faire un plaidoyer féministe.
N. Roussel, quant à elle, fait le lien entre antimilitarisme et contrôle des naissances. Elle traite de lâches, en 1917, les révolutionnaires qui sont partis à la guerre, enjoint toutes les femmes qui la rendent possible et supportable de s’abstenir (l’infirmière qui soigne les blessés, l’ouvrière qui tourne les obus, la bourgeoise qui tricote des pulls pour les soldats ou entretient des œuvres d’assistance...), et déclare la guerre à la guerre. Madeleine Vernet militera de son côté, à partir de 1927 et pendant près de trente ans, avec son journal La Mère éducatrice, pour l’objection de conscience (comme les époux Mayoux, instituteurs qui seront révoqués pour propagande pacifiste).
Ces féministes fréquentent, à un moment ou un autre de leur vie et de plus ou moins près, les milieux anarchistes, qui dénoncent la répression sexuelle d’origine bourgeoise, l’appauvrissement des familles nombreuses ouvrières, le nationalisme et le militarisme. N. Roussel écrit dans « Créons la citoyenne », le 16 mars 1914 : « Le droit civique que nous réclamons nous apparaît non pas comme un but, un idéal, un courant, mais comme un moyen, tout simplement un moyen d’améliorer, faiblement peut-être, mais immédiatement notre sort, comme une arme de combat, dont l’absence est, pour nous, d’autant plus regrettable que nos adversaires l’ont entre les mains et ne se font pas faute de s’en servir contre nous. » Cette déclaration fait écho au sentiment de M. Pelletier,8 qui expliquait en 1908 dans La Femme en lutte pour ses droits : « Le vote étant un droit, tout le monde doit le posséder ; libre ensuite à chacun d’en user s’il le désire. »
Tandis que les marxistes, comme Aline Valette ou Paul Lafargue, optent pour des positions natalistes, N. Roussel (reprenant l’expression de Marie Huot) appelle à la « grève des ventres » dans le journal Génération consciente du militant néomalthusien Eugène Humbert. Elle se bat, ainsi que d’autres néomalthusien-ne-s et/ou anarchistes, pour la « libre maternité » et le contrôle des naissances. Dans la lignée de la pédagogue Pauline Kergomard ou de Séverine, qui réclamaient une éducation sexuelle à l’école, ces militant-e-s ajoutent l’éducation sexuelle à l’éducation professionnelle et culturelle des femmes.
A l’inverse, la très grande majorité du mouvement féministe se montre fort peu préoccupée de sexualité... quand elle n’est pas carrément hostile à la libération sexuelle : elle approuve la politique nataliste et familiale existante, et propose des mesures pour lutter contre la dépopulation (protection et droits maternels, meilleurs salaires, aide aux mères célibataires...).
Avec l’accès aux études supérieures et l’émergence des métiers du tertiaire, certains emplois féminins sont mieux payés et plus attrayants : ils incluent des savoirs et pouvoirs jusque-là masculins (avocates, médecins, professeurs...), ou des responsabilités avec plus large autonomie d’action, et contribuent à une remise en cause des modèles d’épouse. Mais si nombre de féministes vivent seules (la majorité des dames des postes et beaucoup d’institutrices sont célibataires), c’est rarement par choix, car le mariage reste un idéal de vie à leurs yeux. Seulement, l’évolution des images liées aux deux sexes ne le facilite guère. Ainsi, les femmes des postes se heurtent aux hommes de leur milieu, qui ne veulent pas d’une épouse dotée d’un emploi, et elles-mêmes refusent de se déclasser en épousant un ouvrier ou un paysan. D’autres célibataires forcées vont naître de la guerre : 14-18 fait 600.000 veuves et 200.000 fiancées en deuil, qui seront invitées à une maternité de substitution, sociale, par leur engagement dans les domaines de l’éducation, des soins ou de la philanthropie. On est loin du choix revendiqué par M. Pelletier de son état de célibataire, dans Le Célibat, état supérieur...
En 1906, le Conseil national des femmes françaises prend une résolution contre l’avortement, au nom de la fonction altruiste de la femme et de sa mission maternelle (son homologue allemand fera de même en 1908), et les oppositions à cette décision seront très minoritaires. La majorité des féministes applaudit encore, en 1920 et 1923, les « lois scélérates » qui renforcent la répression de l’avortement et interdisent l’information, la vente ou la distribution des contraceptifs. De la même façon, elle condamne La Garçonne de Victor Margueritte, roman écrit en 1922 qui fait scandale pour avoir mis en scène la liberté sexuelle et amoureuse de son héroïne (de leur côté, les antiféministes récupèrent cette image comme la figure négative de la féminité et... celle du lesbianisme). En fait, nombre de féministes, sous couvert d’établir « une seule morale pour les deux sexes », veulent essentiellement domestiquer la sexualité masculine dont les femmes sont victimes.
Les néomalthusien-ne-s considèrent pour leur part l’avortement comme un « crime de classe » puisque, par manque d’information, on y recourt en milieu ouvrier à la place de la contraception. M. Pelletier, une des premières femmes médecins en France, sera condamnée pour l’avoir pratiqué — et le parcours de cette militante montre clairement que les divergences au sein du mouvement féministe portent à la fois sur l’appréciation du suffrage féminin comme revendication (fin ou moyen ?) et sur les actions à privilégier pour l’obtenir (action directe ou pratiques de lobbying ?).
Après la guerre de 14-18, la revendication du droit de vote féminin retombe, et le mouvement féministe avec. Les militantes socialistes insistent quant à elles sur les luttes syndicales et politiques. La Femme socialiste du 29 mars 1926 lance ainsi un appel à adhérer au socialisme international pour « l’émancipation de tous les exploités, de tous les opprimés, de tous les meurtris de l’ordre capitaliste, “sans distinction de sexe ou de race” ».
La crise économique des années 30 dessert la revendication féministe en général, des réflexes protectionnistes émergeant de toutes parts pour réserver les emplois aux hommes. Avec la faiblesse démographique créée par la saignée de la guerre, mariage et maternité sont plus que jamais considérés comme les éléments essentiels de réussite dans la vie d’une femme. Le suffrage féminin est réadopté par l’Assemblée nationale en 1936, et une fois de plus bloqué par le Sénat. Léon Blum nomme malgré tout trois femmes de la bonne bourgeoisie secrétaires d’État : C. Brunschvicg (qui anime l’Union nationale pour le suffrage des femmes), Irène Joliot-Curie et Suzanne Lacore... alors qu’elles ne sont pas électrices ! En 1939 paraît le Code de la famille, et une allocation est versée à la mère au foyer. Vichy sera pour une épouse soumise et une mère attentive : Pétain fustige la liberté des femmes et la féminisation de la IIIe République, rendues en partie responsables de la défaite. Le 25 mai 1941 est officialisée la fête des Mères ; le 15 février 1942, l’avortement, déclaré crime contre l’État, devient passible de la peine de mort. Et si un salaire d’appoint semble désormais indispensable pour les foyers, beaucoup pensent qu’il peut et doit être gagné à la maison (grâce à la machine Singer...).
Si on dresse un bilan des victoires obtenues par le mouvement féministe à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on s’aperçoit que : le barreau s’est ouvert aux femmes en 1899 ; les épouses peuvent disposer de leur salaire depuis 1907 ; les femmes sont électrices puis éligibles au sein des chambres de commerce ou d’agriculture, des prud’hommes et des syndicats depuis 1920 ; après les institutrices en 1919, les postières obtiennent l’égalité de salaire en 1939 ; un baccalauréat est instauré pour les filles en 1919, et deviendra identique à celui des garçons en 1924 ; en 1938, les épouses gagnent leur capacité juridique, elles ne sont donc plus des mineures placées sous l’autorité de leur mari au plan civil. (On peut y ajouter deux mesures législatives « amusantes » : en 1909, en même temps qu’est voté un congé de maternité sans traitement, il est décidé que le port du pantalon n’est plus un délit pour les femmes... si elles tiennent un guidon de vélo ou les rênes d’un cheval ; et, en 1915, les femmes obtiennent l’autorité paternelle en l’absence de leur mari... pour la durée de la guerre.) Mais le régime matrimonial légal reste celui de la communauté dont l’époux est le chef, et les femmes ne votent toujours pas.
LES MILITANTES DU PLANNING FAMILIAL
APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Le renouvellement de la classe politique, à l’issue de la guerre, va néanmoins entraîner des avancées importantes sur le plan des droits : le 21 avril 1944, le suffrage est accordé aux femmes, qui l’exerceront pour la première fois aux municipales de mars 1945. Les élues, toutes issues de la Résistance, poussent plus loin l’avantage : la magistrature s’ouvre aux femmes, les abattements légaux sur les salaires féminins sont abrogés, le congé de maternité (indemnisé à 50 %) devient obligatoire, la prostitution est réglementée. Le préambule de la Constitution de 1946 précise : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »
Les principales associations féministes se reconstituent néanmoins et font campagne pour réclamer davantage de candidatures féminines, militer pour la réforme du régime matrimonial et de l’autorité paternelle (qui interviendront en 1965 et 1970). Mais leurs troupes ne se renouvellent pas. Le Deuxième Sexe, publié en 1949, ne provoque chez elles qu’indifférence, alors qu’il dénonce pêle-mêle les grossesses subies, les avortements clandestins, la monotonie des vies rétrécies aux bornes du foyer, le surmenage des femmes qui travaillent.
Cependant, à partir de 1956, la Maternité heureuse, qui deviendra quatre ans plus tard le Mouvement français pour le planning familial, est le point de ralliement de nouvelles militantes. Aussitôt suivies par les protestantes du Mouvement jeunes femmes et par les franc-maçonnes, elles réclament la libéralisation de la contraception, pratiquée légalement dans le reste de l’Europe du Nord-Ouest. Catholiques et communistes demeurent contre jusqu’au milieu des années 60 — les un-e-s étant pour l’abstinence périodique par les méthodes dites « naturelles », les autres accusant le néomalthusianisme de vouloir réduire les forces vives de la classe ouvrière. Mais la « nouvelle gauche » qui émerge alors (FGDS, CFDT, PSU, clubs politiques) modifie les rapports de forces au sein de la classe politique. En 1965, Mitterrand inscrit l’abrogation des « lois scélérates » dans son programme et politise le débat. Les revendications féminines reçoivent enfin un écho en matière de contraception : la loi Neuwirth (décembre 1967) autorise la vente des produits contraceptifs sous strict contrôle pharmacien et médical. Il faudra cependant attendre l’après-Mai 68 pour qu’un mouvement de femmes passe à l’action directe pour remettre en cause les rôles sociaux et revendiquer la libération sexuelle.
Vanina (OCL-Poitou)
Dans La Politique du mâle, Kate Millett analysait ainsi en 1970 l’évolution du mouvement féministe américain vers le suffragisme : « Il fut, à bien des égards, la “tarte à la crème” de la révolution. Il fut l’enjeu d’une lutte si longue et si âpre qu’il prit une importance disproportionnée. Quand il fut acquis, le mouvement féministe en mourut, pour ainsi dire d’épuisement. Le principal inconvénient de cette polarisation sur le droit de vote, qui contribua à perdre le mouvement, c’est que celui-ci ne réussit pas à ébranler assez fortement l’idéologie patriarcale. » Un constat assez juste, et qui, l’article précédent l’a montré, est également valable sous d’autres cieux. Mais un constat incomplet, dans la mesure où il fait l’impasse sur les spécificités du mouvement américain lui-même, que nous rappellerons ici, et dont découle assez logiquement l’évolution soulignée.
Si dates et événements changent, le mouvement féministe suit aux États-Unis une trajectoire parallèle à celui de la France : de 1840 à la guerre de Sécession (1861-1865), la lutte féminine porte avant tout sur la reconnaissance des droits civils. Celle des droits politiques émerge, puis se développe avec une diversification des organisations — jusqu’à une polarisation sur le droit de vote, qui sera acquis dans plusieurs États en 1869, et pour finir reconnu par la Constitution américaine en 1920. Mais le féminisme américain présente également les caractères bien particuliers suivants.
AUX ORIGINES, LE PROTESTANTISME ÉVANGÉLIQUE
Le mouvement évangélique qui se développe aux États-Unis au XVIIe siècle, en opposition au calvinisme, promeut l’action philanthropique à travers les luttes contre l’alcoolisme et pour l’abolition de l’esclavage. Ce phénomène religieux original est beaucoup porté par des épouses et mères, gardiennes de la foi et des bonnes mœurs, en lutte contre le péché, la prostitution féminine et la luxure masculine. Se vivant comme les Anges du Foyer, elles mènent sur tous les terrains un « pieux harcèlement » pour défendre la pureté féminine contre la sensualité masculine. Le féminisme américain découle pour une bonne part de cet investissement dans les associations philanthropiques. En effet, leurs militantes s’y trouvent confrontées à une misogynie certaine. Et de même dans le mouvement Reform — qui traduit un désir de changer la société (dans l’attente de l’Âge d’or) en abolissant l’esclavage, la famille ou le mariage, et qui, regroupant des sociétés alternatives inspirées des utopies millénaristes ou socialistes, donne naissance à de nouvelles thérapeutiques ou au spiritisme. Cette opposition envers les femmes, souvent au nom de préceptes religieux (en particulier chez les quakers), conduira certaines militantes, notamment par la croisade contre l’esclavage, à réaliser la synthèse entre action morale et conscience de l’oppression qui sera la base du mouvement féministe.
UNE COMPOSITION GRANDE BOURGEOISE
ET CLASSES MOYENNES
Deux facteurs principaux contribuent au développement du mouvement féministe : l’accès aux études et l’accroissement du salariat féminin dans l’industrialisation du capitalisme américain. Entre 1780 et 1840, le niveau d’instruction des filles change fortement : le taux d’alphabétisation double et des établissements d’enseignement supérieur deviennent mixtes (l’université vers 1870). L’enseignement constituera « le » débouché pour les WASP, ces Blanches anglo-saxonnes protestantes, de milieu bourgeois ou petit-bourgeois, qui vivent sur la côte Est et dans les États du Nord-Est, et qui seront largement partie prenante du suffragisme et de la lutte pour les droits civils. A la fin du XIXe siècle, les usines emploient aussi de plus en plus de femmes en atelier, tandis que l’invention en 1890 de la machine à écrire permet à beaucoup d’autres de connaître les joies du secrétariat.
Les millions de femmes appartenant aux classes moyennes que comptent alors associations et clubs féminins dans un large champ social (sur le jardinage, des problèmes sociaux...) sont très conservatrices. Elles aspirent à une activité intelligente et utile, mais l’éventail des professions qui leur sont ouvertes s’est peu élargi par rapport à la hausse des diplômées de l’enseignement supérieur. Leur action philanthropique atténue la conscience de cette injustice : par ce biais, elles revendiquent leur « différence » dans une optique chrétienne, et recherchent des réformes sociales davantage que des objectifs politiques. Les nombreuses grèves, dans le textile, les mines et les chemins de fer, leur font rejeter avec horreur tout ce qui ressemble à du radicalisme — d’autant que se développe de nouveau chez elles la théorie selon laquelle il reviendrait aux femmes de rétablir la moralité et l’équilibre dans un pays déstabilisé par ces secousses sociales et gagné par la corruption. Le droit de vote est associé à la prohibition des boissons alcoolisées, l’abolition de la prostitution et du travail des enfants ou la réforme du régime pénitentiaire. La revendication égalitaire dans le travail n’est guère prise en compte, et de toute façon la lutte contre l’alcoolisme prime : devant la prolifération des saloons, des manifestations sont organisées, avec prières et bibles à la clé.
Beaucoup de féministes, à l’approche de la Première Guerre mondiale, sont repliées sur la morale bourgeoise et valorisent leur « féminité ». Le mouvement se réduit alors au suffragisme ; et ses manifestations, en accueillant ou en étant conduites par des femmes très fortunées (la « brigade aux visons », qui comprend la fille du banquier Morgan, une des « 400 familles » américaines), font apparaître le vote comme un luxe étranger au monde du travail. Les ouvrières se sentent peu concernées par cette revendication.
UNE STRATÉGIE AUX ASPECTS
CONTRADICTOIRES ET AMBIGUS
— Puritanisme et religion contre libération sexuelle
La Woman’s Christian Temperance Union (WCTU), constituée en 1874 par F. Willard et qui comptera un million de membres, a comme slogan : « Pour Dieu, pour la famille, pour le sol natal ». Le droit de vote féminin est inscrit dans son programme en 1882 pour protéger cette famille (la lutte contre l’alcoolisme demeurant pour elle un puissant instrument d’émancipation des femmes) ; cependant, il n’est pas revendiqué au nom de l’égalité des sexes et des personnes dans la cité, mais à partir des responsabilités prescrites aux femmes dans la « sphère » privée, de leur « vocation morale » et de leur supériorité « naturelle » sur les hommes.
Les organisations suffragistes prônent la chasteté, sauf devoir de procréation, et contribuent à entretenir un climat puritain très fort. Elles ne soutiennent pas la campagne lancée début 1900 par Margaret Sanger, à travers conférences et brochures, en faveur des moyens contraceptifs. Dans leur grande majorité, en effet, leurs membres sont contre toute forme de libération sexuelle. Pareille attitude sert la forte censure qui s’exerce alors par le biais de la loi Comstock (président de la Société new-yorkaise pour la suppression du vice et... militant suffragiste) interdisant la diffusion de la littérature qui offense la morale : non seulement cette loi freine l’élan de la critique à l’égard de la famille, du mariage et de la morale, mais elle brise la propagande sur le contrôle des naissances. Elle sera responsable, en 1913, de 700 arrestations et de 333 condamnations, ainsi que de la saisie de milliers d’articles jugés « immoraux » sur cette question.
— Racisme contre abolitionnisme
Si le féminisme américain a largement découlé de la lutte pour l’abolition de l’esclavage, il y a très peu de Noires dans les clubs féminins en général, et la National Association of Colored Women, apparue en 1896, se heurte en 1900 à un refus catégorique des autres organisations de femmes de se réunir avec elle, car le racisme est fort dans leurs rangs.
Par ailleurs, la croyance en la supériorité et la pureté féminines donne parfois lieu à d’embarrassants dérapages dans le mouvement féministe par rapport aux heureux détenteurs du droit de vote. Telles les formules racistes et xénophobes d’E. Stanton (fondatrice du mouvement, avec la Déclaration de Seneca Falls en 1848), opposant en 1869 les femmes « instruites » aux immigrants ignorants ; celles de C. Catt, dirigeante de la National American Woman Suffrage Association (NAWSA, pendant des années la seule organisation féministe suite à une réunification du mouvement), qui évoque en 1894 le péril représenté pour l’Amérique par l’électorat étranger et ignorant issu des taudis des grandes villes ; ou encore d’A. Shaw, qui lui succède et déplore en 1904 le fait que « les femmes américaines soient gouvernées par les hommes de toutes les origines sous le soleil ».
— Pacifisme contre bellicisme, et oppositions... tactiques entre « radicales » et « modérées »
Quand éclate la guerre de Sécession, en 1860, les femmes collaborent à l’effort de guerre, par sentiment patriotique ou caritatif. La Première Guerre mondiale, elle, les divise : la (très grosse) NAWSA soutient l’intervention américaine, alors que le (tout petit) Women’s Party (WP, lancé par A. Paul en 1915) se fait traiter d’« antipatriote » en s’y opposant.
Sur différents plans, ces organisations semblent en opposition : le WP a des campagnes agressives et agit au plan fédéral pour obtenir le suffrage féminin par un amendement ; la NAWSA défend son modèle féminin vertueux et apolitique, et mène ses campagnes État par État. Cependant, ces désaccords sont d’ordre tactique, car en fait les divers regroupements féministes ont une même revendication à leur programme : le droit de vote pour les femmes, et les mêmes pratiques de lobbying (pressions sur la classe politique et contacts personnels de leurs dirigeantes avec la Maison-Blanche).
D’abord dans le mouvement abolitionniste et proches du parti républicain qui promettait le suffrage des femmes avec celui des Noirs, les féministes (regroupées dans l’American Equal Rights Association, AERA, fondée en 1866 par L. Mott) se sont en effet divisées entre prodémocrates et prorépublicaines quand leurs anciens alliés ont privilégié l’abolition de l’esclavage sur le droit de vote féminin. A partir de là, le soutien à tel ou tel a été affaire de marchandages qui ont parfois entraîné des alliances douteuses avec des politiciens (comme le démocrate Train, parfaitement raciste, qui finance le journal de l’AREA)...
Ces réalités du mouvement suffragiste n’ont guère incité les militantes révolutionnaires à rejoindre leurs rangs, même si — comme ailleurs — la revendication du suffrage féminin a été soutenue par un certain nombre d’entre elles, pour faire avancer par ce biais aussi la cause de femmes. Ces militantes, investies quant elles dans la classe ouvrière (voir le texte suivant), se sont davantage préoccupée d’y faire progresser l’égalité économique entre les sexes et la lutte anticapitaliste.9
V.
Marginale par rapport au mouvement féministe de son époque, qu’elle critique... et figure de proue des féministes radicales dans les années 70, Emma Goldman (1869-1940) a milité activement en faveur de la contraception (« étape de la lutte sociale » à ses yeux), l’« amour libre », le droit à la libre maternité, l’homosexualité ou l’égalité économique hommes-femmes...
Avec Margaret Sanger, rédactrice du mensuel The Women Rebel en 1914, elle a tenu des conférences sur l’avortement, la vasectomie, la prostitution... et y a gagné (comme en parlant d’antimilitarisme, de grèves et de bien d’autres sujets) des séjours en prison. Elle n’a, dans sa vie privée, jamais eu peur du qu’en-dira-t-on ; s’est toujours élevée contre la morale familiale et le puritanisme — et contre l’« instinct de propriété du mâle », y compris chez les révolutionnaires. Elle n’a jamais hésité à parler du sexe, polémiquant avec le penseur anarchiste Kropotkine qui lui reprochait ses « débordements », ou quittant le congrès international anarchiste de Paris, en 1900, quand on l’empêchait de lire un texte sur ce sujet. Pour avoir travaillé comme ouvrière puis sage-femme, elle connaissait bien les problèmes spécifiques des femmes. Elle a défendu une « morale » anarchiste pour combattre les rapports de pouvoir, et la nécessité de révolutionner toutes les relations sociales y compris les plus intimes. L’amour était pour elle un facteur important dans l’émancipation féminine, parce que l’élan sexuel et amoureux peut s’inscrire dans le champ révolutionnaire ; en effet, les passions féminines étant condamnées dans le système patriarcal comme perturbatrices de l’ordre social, il est nécessaire pour devenir une personne sexuellement libre de lutter contre la morale réactionnaire, mais aussi de vaincre ses inhibitions.
Si E. Goldman n’a pas participé au mouvement féministe en tant que tel, on peut donc néanmoins la qualifier de féministe libertaire, ou d’anarcha-féministe, à la fois par sa façon de vivre et par son combat pour faire avancer certains aspects de la lutte des femmes — qui étaient rejetés par la grande majorité de ses contemporaines féministes. Elle avait peu de rapports, et ils étaient orageux, avec le mouvement suffragiste, alors en plein essor. Elle considérait en effet le droit de vote comme réformiste, et critiquait les suffragistes, très éloignées de la classe ouvrière, et bien trop puritaines.
Dans les clubs de femmes qui l’invitaient pour parler de l’émancipation des femmes ou du contrôle des naissances, elle provoquait des réactions houleuses car elle remettait en cause le côté démagogique et les dangers réformistes du suffragisme, et choquait en insistant sur l’importance de la mère dans la reproduction des rôles sociaux de la société patriarcale.
Comme bien d’autres femmes russes engagées dans la lutte antitsariste, et assoiffées de culture et d’éducation, E. Goldman avait une conscience sociale très forte. Elle n’a pas cessé de rappeler aux suffragistes l’importance d’une lutte d’émancipation globale, car si « le droit au vote, aux capacités civiques égales, peut constituer une bonne revendication [...] l’émancipation réelle ne commence pas plus à l’urne qu’à la barre, souligne-t-elle dans « La Tragédie de l’émancipation féminine » (paru dans le premier numéro de son journal, Mother Earth, en mai 1906). [...] Il est réellement grand temps que les personnes douées d’un jugement sain et clair cessent de parler de “la corruption dans le domaine politique” sur un ton de salon bien-pensant. La corruption, en politique, n’a rien à faire avec la morale ou le relâchement moral de diverses personnalités politiques. Son origine est purement matérielle. La politique est le reflet du monde commercial et industriel. [...] L’émancipation a fait de la femme l’égale économique de l’homme, c’est-à-dire qu’elle peut choisir sa profession ou son métier [mais] son éducation physique passée et présente » ne lui donne pas la force nécessaire pour concurrencer l’homme, « et les préjugés existants font que les patrons préfèrent toujours employer celui-ci dans certaines professions ». Quant à « la grande masse des ouvrières, quelle indépendance ont-elles gagnée en échangeant l’étroitesse de vues et le manque de liberté du foyer pour l’étroitesse de vues et le manque de liberté de l’usine, de l’atelier de confection, du magasin ou du bureau ? Qu’on y ajoute pour nombre de femmes le souci de retrouver un chez-soi froid, sec, en désordre et inaccueillant, au sortir de leur rude tâche journalière. Glorieuse indépendance en vérité [...] », qui pousse certaines à préférer le mariage à l’usine.
Dans « Le Suffrage des femmes » dont voici un extrait (publié par L’Anarchie n°428 de juin 1913, trad. E. Green), E. Goldman précise sa pensée sur la question du suffragisme et la nécessité pour les femmes de se libérer (d’)elles-mêmes :
« Nous nous vantons, nous nous glorifions de l’état d’avancement des sciences et du progrès. N’est-ce pas étrange alors que nous soyons encore dans l’adoration des fétiches ? Nos fétiches ont une substance et une forme différentes, il est vrai ; leur pouvoir sur l’esprit humain est tout aussi désastreux que celui des dieux d’antan.
Notre fétiche moderne est le suffrage universel. Ceux qui ne le possèdent pas encore combattent et font des révolutions sanglantes pour l’obtenir. Ceux qui jouissent de son règne font de lourds sacrifices à l’autel de sa divinité omnipotente. Malheur aux hérétiques qui osent douter de cette divinité !
La femme, plus encore que l’homme, est adoratrice des fétiches, et quoique ses idoles puissent changer, elle est toujours à genoux, toujours élevant ses mains, toujours aveugle au fait que son Dieu a des pieds d’argile. Ainsi elle est le plus grand soutien de toutes les déités depuis un temps immémorial. Aussi elle a eu à payer le prix que seuls les dieux peuvent exiger : sa liberté, le sang de son cœur, sa vie même.
La maxime générale de Nietzsche : “Quand vous allez à la femme, prenez le fouet”, est considérée comme très brutale. Cependant, Nietzsche exprime dans cette phrase l’attitude de la femme envers ses dieux. C’est elle qui recherche le fouet.
La religion, spécialement la religion chrétienne, a condamné la femme à la vie inférieure de l’esclave. Elle a contrecarré sa nature et enchaîné son âme. Malgré cela, cette religion n’a pas de plus grand soutien, pas de plus dévoué partisan que la femme. En vérité, on peut dire avec certitude que la religion aurait depuis longtemps cessé d’être un facteur dans la vie des peuples sans l’appui qu’elle reçoit de la femme. Les plus ardents ouvriers de l’Église, les plus infatigables missionnaires dans le monde entier sont femmes, toujours sacrifiant sur l’autel des dieux qui ont enchaîné leur esprit et asservi leur corps.
Ce monstre insatiable, la guerre, dépouille la femme de tout ce qui lui est cher et précieux. ll lui prend ses frères, ses amants et ses fils, et en retour lui donne une vie de désespoir et de solitude ; pourtant, le plus grand défenseur et adorateur de la guerre est la femme. C’est elle qui inculque l’amour de la conquête et du pouvoir à ses enfants ; c’est elle qui murmure les gloires de la guerre aux oreilles de ses petits et qui calme son bébé au son des trompettes et au bruit des fusils. C’est elle aussi qui couronne le vainqueur au retour du champ de bataille.
Puis il y a le foyer conjugal. Quel terrible fétiche ! Combien cette prison moderne avec des barreaux dorés sape l’énergie vitale de la femme ! Ses aspects brillants l’empêchent de voir le prix qu’elle a à payer comme épouse, mère et ménagère. Pourtant, elle se cramponne avec ténacité au foyer, au pouvoir marital qui la tient en asservissement.
On peut dire que la femme désire le suffrage pour se libérer, parce qu’elle reconnaît le terrible péage qu’elle doit verser à l’Église, à l’État et au foyer. Ce peut être vrai pour quelques unités, mais la majorité des suffragistes répudie entièrement un tel blasphème. Au contraire, elles affirment toujours que c’est le suffrage des femmes qui fera d’elles de meilleures chrétiennes et femmes d’intérieur, de dévouées citoyennes de l’État. Ainsi, le suffrage est seulement un moyen de fortifier l’omnipotence des dieux mêmes que la femme a servis depuis un
temps immémorial.
Il ne faut pas s’étonner alors qu’elle soit aussi dévote, aussi zélée, aussi prosternée devant la nouvelle idole : le suffrage des femmes. Comme au bon vieux temps, elle endure persécutions, emprisonnements, tortures et toutes sortes de condamnations avec le sourire aux lèvres.
Comme autrefois, même les plus éclairées espèrent en un miracle de la divinité du XXe siècle : le suffrage. Vie, bonheur, joie, liberté, indépendance, tout cela et davantage doit naître du suffrage. Dans sa dévotion aveugle, la femme ne voit pas ce que les gens éclairés aperçurent il y a cinquante ans. Elle ne se rend pas compte que le suffrage est un mal, qu’il a seulement aidé à asservir les gens, qu’il leur a fermé les yeux, afin qu’ils ne voient pas le subterfuge grâce auquel on obtient leur soumission.
Le désir de la femme pour le suffrage est basé sur le principe qu’elle doit avoir des droits égaux à ceux de l’homme dans toutes les affaires de la société. Personne ne pourrait réfuter cela si le suffrage était un droit. Hélas ! c’est à cause de l’ignorance de l’esprit humain que l’on peut voir un droit dans une imposture. Une partie de la population fait des lois, et l’autre partie est contrainte par la force à obéir. N’est-ce pas là la plus brutale tromperie ? Cependant, la femme pousse des clameurs vers cette " possibilité dorée " qui a créé tant de misères dans le monde et dépouillé l’homme de son intégrité, de sa confiance en lui-même et en a fait une proie dans les mains de politiciens sans scrupules.
Libre, le stupide citoyen de la libre Amérique ? Libre de mourir de faim, de rôder sur les grandes routes de ce grand pays. Il possède le suffrage universel. Grâce à ce droit, il a tout juste réussi à forger des chaînes autour de ses membres. La récompense qu’il reçoit consiste en lois appelées sociales qui prohibent le droit de boycottage, de picketing [chasse aux jaunes, aux renards], tous les droits, en un mot, excepté le droit d’être volé des fruits de son labeur. Cependant tous ces résultats désastreux n’ont rien appris à la femme. Même alors, on nous assure que la femme purifiera la politique.
Il est inutile de dire que je ne m’oppose pas au suffrage des femmes pour la raison qu’elles n’en sont pas dignes. Je ne vois pas de raisons physiques, psychiques ou morales interdisant à la femme de voter. Mais cela ne peut pas me convaincre que la femme réussira là où l’homme a échoué. Si elle ne faisait pas les choses plus mal, elle ne pourrait certainement pas les faire mieux. Donc, c’est la doter de pouvoirs surnaturels que d’affirmer qu’elle réussirait à purifier ce qui n’est pas susceptible de purification. Puisque le plus grand malheur de la femme est d’être considérée comme un ange ou comme un diable, son véritable salut repose sur le fait d’être considérée comme un être humain, c’est-à-dire sujet à toutes les folies et erreurs des hommes. Devons-nous alors croire que deux erreurs feront quelque chose de juste ? Pouvons-nous penser que le poison inhérent à la politique sera diminué, si les femmes entrent dans l’arène ? Les plus ardentes suffragistes soutiendraient difficilement telle folie. [...] »
V.
Quelques remarques, en conclusion de ce dossier sur le suffragisme.. .
SUR L’ORIGINE DU MOUVEMENT FÉMINISTE
En Angleterre et aux États-Unis, les féministes ont mis en avant l’égalité des sexes devant le Créateur, alors qu’en France leur discours s’est développé dans un espace de laïcité et beaucoup nourri de la Libre Pensée. L’influence des quakers ou des Unitariens10 prédisposait les Anglo-Saxonnes à une relecture féministe de la Bible ; l’active composante protestante dans le mouvement des femmes françaises n’a au contraire pas cherché à le christianiser. (Des féministes catholiques ont de leur côté lancé en 1896 une revue, Le Féminisme chrétien, qui essayait de concilier l’égalité des sexes avec le catholicisme... mais elles sont devenues antisémites et xénophobes au moment de l’affaire Dreyfus, et ont rompu avec le reste du mouvement.) La grande majorité des féministes françaises, en optant pour le suffragisme, a trouvé une certaine cohésion dans le pacte républicain qui dessinait alors les limites de sa « neutralité politique » en matière de religion.
Le suffragisme a découlé de l’individualisme des classes moyennes féminines : le ralliement des femmes appartenant à ces classes, en général citadines, a créé au début du XXe siècle un mouvement politique et social revendiquant une autonomie sur la base de l’accès au savoir et à l’indépendance financière. L’industrialisation, l’urbanisation et la transformation des modèles familiaux, en provoquant une distorsion entre la séparation sexuelle des sphères d’activités et les nouveaux besoins économiques et culturels créés par l’évolution de la société, a rendu l’autonomie financière et juridique vitale pour beaucoup de femmes, et les a mises en mouvement.
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU
MOUVEMENT FÉMINISTE FRANÇAIS
Il existe un fossé entre les suffragistes républicaines du début du XXe siècle et les nouvelles féministes de son milieu, mais des traits persistants traduisent aussi des spécificités nationales de longue durée :
— la faiblesse numérique du féminisme en France, qui tient pour partie à la composition sociale de ce pays. Si partout les mouvements de femmes ont connu un essor parallèle à ceux de l’urbanisation et du salariat, la lenteur de l’industrialisation française a retardé un tel phénomène ;
— la division du mouvement français, où cohabitent des positions stratégiques contradictoires, avec des querelles de personnes et de sensibilités (journaux et associations sont liés aux personnalités qui les créent — souvent des « premières » à avoir obtenu un diplôme universitaire). Des clivages importants existent aussi dans les mouvements d’autres pays (en Angleterre entre suffragistes et suffragettes), ou entre ces mouvements et celui de la France (entre le Bund Deutscher Frauenvereine allemand, plus conservateur encore que le Conseil national des femmes françaises, et ce dernier). Mais, en France, les stratégies d’union restent particulièrement rares, fragiles, et ne parviennent jamais à une position unanime. Le CNFF, qui adopte le modèle pragmatique anglo-saxon (fédérer les groupes pour un réformisme très progressif), ne réussit pas à s’imposer comme le « parti des femmes » ; les groupes, jaloux de leur autonomie, cultivent avec soin leur différence. M. Pelletier, elle-même à l’origine de plusieurs, se moque volontiers de cette collection de « généraux sans armée ».
— les clivages politiques et religieux. L’Église catholique et le mouvement ouvrier, bien implantés en France et adversaires du féminisme pour des raisons très différentes, n’autorisent à leurs membres que des alliances partielles et ponctuelles avec ses militantes. De leur côté, qu’elles soient libres-penseuses, protestantes, juives, franc-maçonnes ou plus tard catholiques progressistes, ces dernières défendent la laïcité même si leur mouvement doit beaucoup aux protestantes, depuis Sarah Monod ou Julie Siegfried (qui président aux premières destinées du CNFF) jusqu’au Mouvement jeunes femmes qui, dès le milieu des années 1950, se bat pour la libre contraception. La tardive égalité politique en France a pas mal tenu à une inextricable contradiction : les féministes attendaient cette réforme des milieux laïques, alors que ceux-ci estimaient, non sans raison, avoir tout à y perdre tant que les femmes demeureraient sous l’emprise de l’Église. Le parti radical est resté, depuis le refus du Sénat d’en débattre en 1922 jusque dans les discussions de l’Assemblée consultative d’Alger en 1944, en passant par la « trahison » du Front populaire, le plus féroce opposant au droit de vote féminin. Quant aux socialistes et communistes, s’ils partageaient bien des revendications féministes, ils ont refusé toute autonomie au mouvement et toute dénonciation de l’exploitation masculine de la classe ouvrière.
SUR LES RAPPORTS DES SUFFRAGISTES
AVEC LA CLASSE OUVRIÈRE
Dans les pays où ils se développent, les milieux contestataires féminins n’opèrent guère de jonction avec la classe ouvrière. Aux États-Unis, ces deux mondes se côtoient très tardivement et demeurent assez indifférents à leurs préoccupations respectives. En Europe, les revendications féministes reçoivent souvent un difficile écho parmi les ouvrières : en France et en Allemagne, malgré la création de syndicats féminins dans des professions où les femmes sont exclues des syndicats masculins et le soutien actif de féministes aux grèves de femmes, les ouvrières sont dans l’ensemble peu réceptives au discours féministe. Si le taux d’adhésion féminine au socialisme et au syndicalisme est encore bien bas aujourd’hui en Europe (sauf en Allemagne), les ouvrières qui se mobilisent se sentent davantage attirées par un discours de classe que par la revendication d’une égalité des sexes sur le plan civil et politique... sauf en Angleterre, où existe un réseau suffragiste parmi les ouvrières. (Dès les années 1890, les radical suffragist de la National Union for Women’s Suffrage Societies se consacrent à la propagande au sein des femmes de la classe ouvrière et réussissent à faire vivre plusieurs comités : en 1903 est créée par Esther Roper et Eva Gore-Booth une organisation suffragiste ouvrière qui établit une alliance fructueuse avec le parti travailliste.) Ailleurs, la prétention à l’autonomie du mouvement féministe engendre des problèmes avec les partis socialistes alors en train de s’organiser.
SUR LES RELATIONS AVEC
LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
Le constat de la domination masculine dans la société patriarcale a été théorisée par des révolutionnaires, au XIXe siècle, avant que des mouvements féministes voient le jour en Europe. Les analyses des penseurs utopiques et socialistes ont servi à nombre de militantes de ces mouvements. En France, socialistes, anarchistes ou communistes militent contre la difficile condition des femmes — mais plus particulièrement celles du prolétariat, du fait de leur double oppression, d’origine patriarcale et capitaliste. Après la scission avec les communistes, les socialistes s’orientent vers une réforme de la société ; et anarchistes et communistes divergent dans leurs analyses, leurs objectifs et leurs terrains d’intervention, même si les un-e-s comme les autres visent à mettre en place une nouvelle société. Des militantes communistes ont milité pour la cause des femmes sans arrière-pensée, mais le « féminisme prolétarien » tel que l’ont conçu les partis communistes avait pour devoir de se fondre dans le mouvement socialiste et de s’effacer devant les revendications ouvrières générales ; la « socialisation et collectivisation des tâches domestiques et ménagères » s’est réduite à quelques améliorations sur la protection des travailleuses, et les tenants du marxisme ont le plus souvent nié la lutte des sexes pour ne reconnaître que la lutte des classes. Côté anarchistes, le féminisme étant comme tous les regroupements interclassistes un mélange composite aux revendications variées, des militants et surtout des militantes se sont trouvés sur certaines luttes à sa lisière — ou on peut dire que des féministes se sont activées à la lisière du mouvement anarchiste —, notamment à travers un engagement commun dans les combats néomalthusien et pacifiste. Ces personnes-là ont souvent revendiqué le suffrage féminin comme étape nécessaire (mais sans se leurrer sur ses limites ni ses pièges) en le situant dans une lutte de bien plus grande envergure. Le clivage se pose en fait toujours en termes de « réforme ou révolution » : devant l’absolue nécessité de détruire le système existant, chercher à l’aménager pour le rendre plus vivable pour ses victimes est ambigu, et nocif dans ses effets. Parce que le remède à l’oppression féminine ne peut passer par la seule recherche de l’égalité sur le plan de la loi : il implique forcément un changement à la fois dans les structures économiques et dans les rôles sociaux imposés, donc dans les têtes de chacun et chacune.
Si l’éducation est apparue tant aux révolutionnaires qu’aux suffragistes comme un élément fondamental pour faire évoluer les mentalités, des divergences se sont fait jour sur cette question aussi, on l’a vu. De plus, mise au service du citoyennisme, cette éducation a renforcé le nivellement des cultures régionales qui s’effectuait au profit de la « culture française »... et de la centralisation jacobine. Elle constituait bien une arme absolument nécessaire pour faire ressortir la manipulation démagogique de l’ignorance populaire que représentait le suffrage universel, et pour parvenir à la révolution. Mais la revendication de l’égalité avec les hommes par l’obtention du droit de vote pour les femmes ne pouvait que conduire à une impasse : elle a conforté le parlementarisme et entretenu l’illusion de sa « démocratie ». Si le mouvement féministe a été perçu par beaucoup de révolutionnaires comme un adversaire au début du XXe siècle (par sa stratégie bien plus que par ses analyses sur la condition des femmes), c’est parce qu’ils et elles avaient alors la quasi-certitude de se trouver à l’aube du « grand soir » : la Révolution était pour demain, l’utopie dans beaucoup de têtes, et le degré de rupture avec le système existant tel que toute tentative pour l’améliorer relevait de la dangereuse aberration. Et puis, se battre pour une partie seulement d’un tout ne servait à rien, car la libération des femmes se ferait à l’évidence avec celle des hommes une fois le patriarcat et le capitalisme détruits. Le suffrage universel, qui a été une « victoire » démobilisatrice pour les forces révolutionnaires dans l’Histoire, demeure l’instrument de la domination économique et sociale d’une petite minorité sur la grande majorité. Si aucune réelle libération n’a pu s’obtenir par les urnes, pour les femmes pas davantage que pour les hommes, c’est parce que cette libération passe en fait à la fois par la destruction de structures économiques et par celle de l’organisation sociale leur correspondant.
SUR L’ENJEU DE LA CITOYENNETÉ
En mettant l’accent sur le droit de vote pour faire avancer la cause des femmes, les féministes ont fait progresser l’idée républicaine — de même que l’accès à l’éducation pour les femmes a au bout du compte renforcé la patrie française et le citoyennisme. La démarche interclassiste des mouvements féministes a servi à masquer les intérêts de couches sociales toujours identiques : les classes moyennes et supérieures. Comme certaines féministes le désiraient, de par leur origine sociale ou leur ambition personnelle, elles ont fait « leur » Révolution française en misant tout sur la défense de leurs droits, de leurs biens et de leurs privilèges, et sont entrées dans l’establishment, « récupérées » par le système sans trop le déplorer... mais sans avoir acquis l’égalité avec les hommes pour autant.
De plus, le recours à l’État, dans la logique citoyenne, par des pratiques de lobbying ne s’est pas cantonné au terrain du suffrage féminin. Or, la demande de poursuites judiciaires contre les violeurs, plutôt qu’une démarche d’autodéfense ou d’action directe contre ces violeurs ; ou encore la revendication d’un salaire pour les femmes au foyer, au lieu de la lutte pour un partage des tâches domestiques sont également des choix critiquables en ce qu’ils ne produisent pas une rupture avec le système, mais au contraire son renforcement à travers son appareil répressif et l’organisation sociale qui le sous-tend. Un véritable changement révolutionnaire — d’ordre politique, économique et social, pas seulement juridique — implique une critique des rôles imposés par le patriarcat aux deux sexes, plutôt qu’une défense du rôle d’épouse et de mère, et il passe notamment par un partage des tâches ménagères et éducatives — ce que le mouvement féministe français n’a guère pris en compte. Il s’est plutôt cramponné à la « sphère traditionnelle » des femmes — les cantonnant de ce fait au foyer et à l’élevage des enfants, au détriment de leur libération personnelle. Si un certain nombre d’hommes, quels qu’ils soient, ont bien évidemment eu « tort » de refuser que les femmes quittent ce foyer, qu’elles travaillent ou soient payées comme eux, les féministes qui ont défendu la « spécificité féminine » n’ont pas davantage eu « raison », car elles ont ce faisant desservi la cause des femmes.
SUR LA VISION DE LA SEXUALITÉ
DANS LE MOUVEMENT FÉMINISTE
Au début du XXe siècle, la quête d’une nouvelle identité féminine est encouragée par l’émergence de courants philosophiques qui postulent le primat de l’intuition sur la raison, partent à la découverte de l’inconscient et remettent en cause les normes patriarcales ; et pourtant les mouvements féministes en France comme aux États-Unis demeurent attachés, pour la plupart de leurs composantes, à un projet réformiste au sein de la société patriarcale. Ils ne remettent pas en compte ses valeurs : mariage, procréation, famille, et ont une vision beaucoup plus pragmatique et politique, voire politicienne des transformations possibles que celles d’avant-garde intellectuelles et artistiques dénonçant alors l’ordre établi. (La politique colonialiste et la montée des fascismes ont également montré que de nombreuses femmes avaient du mal à concevoir l’autonomie individuelle de leur sexe en la détachant de la famille et de l’avenir de la « race ». Si la solidarité entre femmes a été affirmée par les mouvements féministes au niveau européen, elle n’a guère dépassé les limites de l’Occident — hormis pour H. Auclert, qui parlera des femmes algériennes.)
Les féministes les plus radicales elles-mêmes restent critiques à l’égard des partisan-e-s de l’« amour libre » ou de l’érotisme — arguant par exemple des difficultés d’être fille-mère... mais souvent pour dissimuler, en prônant le mariage, des conceptions très morales. Certaines figures du féminisme refusent personnellement tout contact avec les hommes, et érigent virginité et chasteté en modèle d’émancipation pour échapper à l’oppression sexuelle des femmes. La libération sexuelle, pourtant indissociable d’une véritable libération, est de ce fait refusée par une très grande majorité de féministes jusqu’au milieu du XXe siècle... où la lutte pour la contraception et l’avortement font heureusement tomber un certain nombre de tabous.
Vanina
FÉMINISTES ET/OU CITOYENNES À PART ENTIÈRE !
La posture identitaire des femmes en mouvement a créé les conditions nécessaires à l’assimilation républicaine, étatique de leurs revendications. Se posant comme corps social spécifique de par l’oppression qu’elles subissent, les femmes en lutte ont reçu les réponses législatives adaptées à leur statut. Comme l’affirme C. Delphy, la différence est « la façon dont, depuis plus d’un siècle, on justifie l’inégalité entre les groupes, et pas seulement les groupes dits de « sexe ». Le naturalisme réside en ceci, penser qu’une fois que les groupes sont constitués, on ne se demande plus comment ils ont été constitués. On se demande en quoi ils diffèrent, comme si l’opération par laquelle ils ont été nommés différents, puis traités différemment, était sans rapport avec leur différence actuelle. [...] Ils sont différents, donc la loi a été obligée d’en tenir compte, c’est si anodin que cela ne mérite même pas d’être mentionné. »11
Les luttes dans leur ensemble, s’en tiendront donc aux constats de la place des femmes dans cette société et exigeront l’amélioration du sort fait aux femmes par les hommes. Mais on ne peut pas dresser un tableau homogène de l’ensemble du mouvement des femmes, seulement une approche synthétique de ce qu’il en reste dans les faits de nos jours. Pendant toute la période contemporaine des divergences théoriques et pratiques émergent dans le mouvement de libération des femmes, MLF : sigle créé par les médias durant l’été 1970.
« Dans l’immédiat on peut poser que la libération des femmes ne se fera pas sans la destruction totale du système de production et de reproduction patriarcale. Ce système étant central à toutes les sociétés connues, cette libération implique le bouleversement total des bases de toutes les sociétés connues. Ce bouleversement ne pourra se faire sans une révolution. » Christine Delphy, 1970, L’ennemi principal12. « Poser la question — les femmes sont-elles des citoyennes ? — fait bien référence à leur possible exclusion du corps civique en raison de leur sexe. En étant directe, nous pourrions dire : le sexe féminin peut-il être citoyen ? Et nous apercevoir ainsi que la troisième république, bonne continuatrice de ses devancières, a répondu avec constance que seul le sexe masculin avait droit à ce titre. Posé ainsi, l’argument moqueur que Jenny d’Héricourt opposait à Proudhon vient tout de suite à l’esprit : elle ne s’était pas rendu compte que cet organe était le siège de la raison... » Marie-France Brive, 198713 .
LE FÉMINISME CONTEMPORAIN
Près de vingt ans sépare ces deux citations qui symbolisent d’une certaine manière deux orientations opposées du mouvement féministe contemporain : l’une radicale se dit révolutionnaire, l’autre plus réformiste interroge la société sans vouloir la détruire.
Déjà, dans le mouvement féministe qui précède les années soixante-huitardes une grande partie des associations féminines qui le constituent « ne remettent nullement en cause la société actuelle. Elles tendent à une meilleure intégration des femmes dans cette société et défendent la version moderne de la femme au foyer. Elles visent à des améliorations ponctuelles du sort de la femme. »14
Si les années soixante-dix voient apparaître un discours plus radical, — celui de Christine Delphy cité en introduction — ainsi que des actions et des revendications moins citoyennes comme « Liberté pour les femmes hors du mariage. Droits des femmes à reconnaître ou non le père biologique de l’enfant qu’elles portent. Des noms pour les femmes. Supprimons l’appropriation privée du corps des femmes par les hommes. » (slogans de la grève des femmes, 8/9 juin 1974), dans le même temps se construit un courant réformiste militant. Dans ce courant, on peut citer l’association Choisir, qui « se dit être un mouvement qui accueille les femmes de tous horizons avec des objectifs qui ne sont ni de faire la révolution, ni de changer les rapports de production, ni de remettre en cause la médecine libérale ». Le projet législatif élaboré par Choisir sur l’abrogation de la loi de 1920 qui interdit l’avortement et la contraception, a été défendu par le parti socialiste. G. Halimi, avocate, en est la présidente-fondatrice.
La création le 23 juillet 1974 du Secrétariat à la Condition Féminine, dirigé par Françoise Giroud est une réponse institutionnelle aux revendications des femmes de l’époque. Dans les années 70, la partie radicale du mouvement, portée par des femmes militantes d’organisations qui se disent révolutionnaires, questionne le système patriarcal et l’assignation des femmes qui en résulte dans tous les espaces sociaux : du privé au public, de l’institutionnel au militant.
La forme revendicative et le fond ont pu être rupturistes en de nombreux points dont la libre disposition du corps en formait l’axe essentiel pour mettre en cause la maternité non désirée, revendiquer un liberté sexuelle bousculant le sacro-saint couple hétérosexuel, et dénoncer le prétexte biologique servant à perpétuer l’asservissement social des femmes.
Après avoir établi un constat et des analyses qui cassent de nombreux mythes et tabous sur les rôles, en particulier de la femme, s’appuyant sur l’incontournable travail de Simone de Beauvoir15 qui démontre la construction sociale de la situation faite aux femmes, les diverses associations féministes aux statuts labellisés par l’État, s’orientent vers l’assistance aux femmes en détresse et un travail d’élaboration de revendications légitimes sur la place des femmes dans cette société, en se référant à une victimisation du genre féminin et un appel à la loi. « En phase avec la société globale [le courant féministe qui a dominé ces quinze dernières années se réfère] (...) tantôt au différientialisme, tantôt au victimisme. A l’aise dans les partis politiques de droite comme de gauche, dans les instances européennes ou le monde associatif, son credo tient en deux propositions principales : les femmes sont toujours les victimes des hommes et appellent une protection particulière. Elles sont essentiellement différentes d’eux, et l’égalité des sexes exige la prise en compte de cette différence ».16
Ainsi l’ensemble du mouvement de libération des femmes sera multiforme, mais un discours dominant s’impose en réintroduisant la notion d’intégration sociale par des concepts d’égalité et de citoyenneté.
CITOYENNETÉ
« La notion de citoyenneté — dans la tradition libérale, comme dans la tradition républicaine — a été construite en excluant les femmes et a été forgée sur le modèle de l’homme, propriétaire, blanc et hétérosexuel ».17 Cette notion a évolué mais vers un pôle démocratique qui en limite encore plus l’approche. « Distinguer, par conséquent, citoyenneté, représentation et gouvernement : les femmes participèrent au gouvernement en 1936 alors qu’elles n’étaient même pas encore électrices, encore moins députées. Serait-il donc plus facile de gouverner que de représenter, plus évident d’être ministre que député ? Oui. La citoyenneté fut très tard acquise », déclare Geneviève Fraysse.18 Ce qui réduit l’espace citoyen à celui de la démocratie représentative. Dans ce schéma proposé à la réflexion, Michèle Riot-Sarcey trace d’autres pistes : « Tel est ainsi le destin du mot citoyen, vidé de son sens politique au point d’être utilisé dans tous les sens, en tous lieux où est censé intervenir l’individu a qui échappe l’exercice du souverain. Le citoyen nouveau n’est même plus animé part l’idée de déléguer ses pouvoirs, tant il dépend des pouvoirs en place. La vertu du mot citoyen, inlassablement répété, masque ainsi la réalité d’assujetti des citoyens, amputés de leur part de souverain et à qui l’idée même de libre exercice du pouvoir, y compris par délégation, est devenu étrangère. »19 L’idéologie générale du peuple souverain, de la devise liberté/égalité/fraternité, se réfère à la révolution française dont seul le concept d’égalité a survécu et dont le droit à « cette égalité » est conditionnée à des devoirs de citoyen, l’égalité étant la juste récompense d’une attitude citoyenne respectant ces devoirs ! De plus « Le mot citoyen, par la vertu de la continuité historique, se veut inchangé, identique au sens présupposé de la liberté de la période révolutionnaire, comme si, à l’époque même les enjeux de pouvoirs n’étaient pas précisément révélés par les débats sur le contenu de la pratique citoyenne : l’identification à l’universel a permis de légitimer la perpétuation d’un sens univoque en faisant l’économie de son historicité. Le référent, mis à l’écart, s’est effacé au profit d’un neutre, masculin, non explicité. »20 Cette analyse pourrait servir à dénoncer le caractère ségrégationniste du statut de citoyenneté, écartant non seulement les femmes, mais toute personne n’ayant pas les moyens et/ou les capacités de remplir son devoir de citoyen. « Le seul signe qui distingue l’Élu, c’est le privilège : c’est à travers les privilèges que l’Élite se reconnaît, s’affirme, se sépare... Toute l’astuce consiste à faire du privilège la manifestation d’une valeur dont la présence conférerait précisément au privilégié le droit au privilège. »21 Pourtant c’est bien cette citoyenneté que les femmes revendiquent, y dénonçant simplement le caractère misogyne, les revendications féministes s’inscrivent dans cette logique de droits et devoirs pour négocier la place des femmes dans la société.
DROITS ACQUIS POUR QUELLE FINALITÉ ?
Les femmes ont donc gagné des droits comme citoyennes, des droits et des devoirs mais bien sûr pas les moyens ! Les droits sont inscrits timidement dans les limites du raisonnable ou par le discours sans engagement comme le droit égal d’accès : à propos de la loi sur la parité, modification de la Constitution en juin 1999 : « La lecture attentive des textes confirme l’absence totale du mot parité (...). » « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Art.3 » G. Halimi22 conclue son texte par : « Elle [la parité] est une nouvelle lecture de I’universalisme, mais aussi une symbolique, un point de départ. A partir d’elle, tout reste à faire. Au législateur de prendre l’outil et de construire l’ouvrage. » C’est moi qui souligne cette allégeance à l’autorité ... masculine ! G. Halimi est avocate, connue pour avoir porté devant les tribunaux des affaires de femmes concernant l’avortement et les viols.
La liberté de choix..., mais dans un monde inchangé, inégalitaire, oppressif qui peut donc jouir de ces droits ? Les riches et les puissants, argent et pouvoir tout ce dont une grande majorité des femmes est dépourvue ... et la majorité des hommes également ! Les droits accordés ne rompent pas les relations de pouvoir.
QUELQUES EXEMPLES
Sur le corps : la législation élargit la dérogation pour l’IVG mais n’abolit pas la loi d’interdiction de l’avortement. Elle décline des mesures répressives pour tout acte contrevenant à ces dispositions ce qui accentue les contrôles et la répression sur les plus faibles, les mineures, les étrangères, les hors normes. L’apparition de comité d’éthique, l’intervention médicale obligatoire et le contrôle social sur tout ce qui concerne justement le corps des femmes ne peuvent pas vraiment représenter même accessoirement la liberté de libre disposition de son corps. Qu’il s’agisse de la contraception, de l’avortement, des méthodes de procréation artificielle, médicalement assistée, le corps des femmes reste sous haute surveillance et son enjeu reproductif en est toujours la cause première.
Sur le travail : les divers aménagements prennent en compte la double journée des femmes, leur statut maternel et maternant afin de combiner le droit d’accès au travail et le devoir d’enfanter et d’élever les enfants. Ainsi des progrès et avancées des droits sur le corps en résultent la nécessité de mieux gérer par les femmes leur fonction maternelle, un enfant quand il faut ! Et la flexibilité est un atout qui permet de jongler entre ces deux injonctions du travail et des enfants. Quant à l’égalité elle reste énoncée comme un droit égal d’accès aux emplois, aux salaires, aux formations ... dans des conditions qui contredisent les dispositions ci-dessus énoncées et rendent caduques ces droits à moins d’adopter le mode de vie du modèle dominant, cadre masculin. « Les femmes peuvent être séductrices (comme dans l’Islam), tentatrices et pécheresses (comme Eve dans la religion chrétienne), ensorceleuses (comme dans la religion juive). Mais, dans les trois religions du Livre, elles ont une seule et unique vocation : enfanter. Et leur place dans la société en découle. ». [Travail à temps partiel : 80% des femmes en France, 81% en Suède, 85% en Angleterre, 90% en Allemagne.]23
Sur la politique : quel est cet espoir qui veut que les femmes changent le pouvoir en y accédant ? Ce qu’on attend c’est donc une intervention génétique car la formation des femmes de pouvoir passe par les mêmes règles, mêmes écoles et dogmes, etc., que celle des hommes de pouvoir. Issues de la classe dominante, héritières : « L’enquête nous apprend que les femmes élues en 1997 appartiennent aussi souvent que les hommes, voire plus qu’eux, a des milieux sociaux très privilégiés. » [Les députées]. En un sens, ce sont des héritières, qui, non contentes d’avoir reçu une dot sociale, ont aussi, pour certaines, recueilli un héritage politique : plus de 20% d’entre elles ont été élevées dans le sérail par un père qui a lui-même exercé des fonctions politiques ».24 Elles n’ont aucune particularité politique, sociale, culturelle qui les différencie de leurs homologues masculins, alors où se trouve donc la différence ?
De quoi se nourrit cette espérance que les femmes au pouvoir seraient sources de changement, d’innovation si ce n’est en usant de prédisposition biologique féminine ou en perpétuant l’éducation sexiste, au nom du « symbolisme dialectique » selon Bourdieu25 , du féminin/masculin qui serait à l’œuvre dans nos sociétés tout comme dans la société kabyle des années 60 !
Sur le couple : l’autorité parentale est élargie aux deux parents mais cela change quoi dans le rôle attribué aux femmes, si ce n’est une responsabilité de plus qu’elles assument plus que nécessaire dans des familles monoparentales. « 93,3% des familles monoparentales (personnes seules vivant avec un ou des enfants) sont composées par des femmes en Autriche ; 92,2% au Portugal ; 90,5% en Angleterre ; 89,7% en France ; 89,2% en Allemagne... En revanche la majorité des personnes seules sans enfant sont des hommes quel que soit le pays d’Europe ».26 Quant à la répartition des tâches domestiques aucune loi n’y pourrait rien changer certes, mais de ces divers acquis législatifs dans le domaine public et privé auraient pu découler un modeste changement d’attitude qui n’est pas d’actualité ! « Quant au partage des tâches ménagères, il est proportionnellement inverse au nombre d’enfants du couple. C’est précisément cette division des rôles traditionnels qui compromet l’égalité des chances et le partage du pouvoir économique et politique. » Alice Schwarzer.27
Les acquis récents autour du contrat du PACS ne rompent en rien la logique légaliste, il s’agit de normalisation et d’intégration d’attitudes jugées jusqu’alors déviantes. C’est la Loi, l’État et son représentant le maire qui valident la relation deux personnes ; ces personnes pouvant revendiquer les mêmes droits que les couples civilement reconnus et hétérosexuels.
L’IMPASSE CITOYENNE
Les femmes plus que toute autre partie de la société ont exigé le statut de citoyenneté : citoyennes à part entières ! Du droit de vote à la criminalisation du viol, c’est une exigence légaliste de reconnaissance citoyenne qui est réclamée.
Les outils citoyens ne fonctionnent pas ou en tout cas ne peuvent rien changer, on s’en doutait mais les bilans sont là pour le dire.
Même le ministère du droit des femme a disparu, et les centres de planning pour informer et orienter autour de la contraception et de l’IVG disparaissent au gré du vent des crédits diminués et du bénévolat envolé. La parité n’a pas résolu la présence des femmes dans les instances du pouvoir politique : « Aux élections législatives de juin 2002, 71 femmes ont été élues sur un total de 577 députés, contre 63 en 1997. (...) Le Sénat compte 35 sénatrices sur un total de 321 élus (10,9% d’élues), devant les conseils régionaux (9,4%) ».28 L’égalité des salaires reste un vœu pieu sur les tables de la loi : « Leurs salaires, à qualification égale, sont toujours inférieurs d’environ 25% à ceux des hommes. »,29 etc.
Si le patriarcat est bien la cause principale du sort fait aux femmes, la citoyenneté ne le met nullement en danger. Tout comme elle n’est pas un outil de rupture avec le capitalisme puisque au contraire elle le renforce en gérant au mieux les interventions socio-politiques. La citoyenneté légitime le rôle des femmes et les aménagements législatifs obtenus par la lutte ne font que reconnaître la contribution spécifique des femmes à l’ensemble de la société sans être en contradiction avec la morale patriarcale. Le doute s’empare de quelques-unes mais pour rester dans le vase clos du groupe de sexe féminin (voir en introduction C. Delphy) : « Le féminisme issu des années 1970 continue à se battre pour l’égalité des droits. Mais cette revendication ne se veut pas porteuse d’intégration ; elle se retournerait contre les femmes ; ce serait une intégration-désintégration.. » Irène Corradin, 199230
SEXES ET CLASSES
Sur la question des rapports entre la lutte des sexes et la lutte des classes, « Les socialistes et les libertaires se posaient déjà les mêmes questions au début de ce siècle, relisaient Bebel, puis abandonnaient le sujet, dans la tourmente de 1917 ; nous en sommes toujours au même point en 1970, mais il faudra bien un jour débusquer la théorie de ses antres idéologiques. »31 Ainsi s’exprimait Nelcya dans la revue Partisans en 1970. Mais actuellement, la révolution n’est plus à l’ordre du jour, la lutte des classes c’est dépassé, et le travail théorique s’est enfermé dans les Universités pour s’intégrer au savoir institutionnel. « Suffit-il désormais de se revendiquer de études de genre, qualifiées ou non de féministes, de travailler dans leur champ pour faire rupture, entrer en résistance, dessiner une utopie [...] Car la subversion ne va pas de soi : ce n’est jamais un état. S’il suffisait de s’intéresser au genre et/ou au sexe au sein de nos institutions universitaires ou de recherches, d’en faire une thèse, un cours, un livre, pour faire la révolution, et même la révolution théorique, ce serait trop beau. »32
L’abandon ou la mise à l’écart de l’option révolutionnaire n’est pas spécifique au mouvement des femmes, l’ensemble du mouvement politique subit la tyrannie de l’idéologie citoyenne.
« Car si, en 70 la pénurie était telle qu’il suffisait de poser la question des rapports entre les sexes pour être subversive, depuis lors des processus d’assimilation qui peuvent aussi être des processus de neutralisation ont été mis en place. »33 Et la citoyenneté est un de ces processus.
Aujourd’hui en observant les mouvements alter/anti-mondialisation et la revendication citoyenne qui s’y attache, un parallèle est possible. Par exemple avec l’appel fait aux institutions internationales pour réguler les inégalités, la volonté d’y siéger, le droit d’intervenir dans les structures de pouvoir pour éviter les excès du système. Ces exigences citoyennes, de fait, permettent la survie du système en douceur dans un cadre humanitaire, respectueux des droits internationaux dont le capitalisme se nourrit, tout en reconnaissant (sans les appliquer) des droits spécifiques aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, handicapées, dépendantes, droits des peuples, etc., : droit de survie dans ce monde tel qu’il est : indépassable, capitaliste et patriarcal ! Pour s’en convaincre quelques chiffres illustrent l’état de ce système : environ 1/10ème de la population possède près de 10% des richesses de la planète, et « 99% de la propriété de la planète sont entre les mains des hommes, les femmes ne détiennent que 1% et gagnent seulement 10% des revenus mondiaux. »34
L’urgence d’une politisation des luttes sans concession au système n’est plus à démontrer et si les problèmes soulevés par le mouvement restent d’actualité, ce n’est pas à l’État d’y répondre. La libération des femmes ne se fera pas sans la libération de toutes les personnes opprimées : « un projet féministe qui ne questionne pas toutes les formes de sujétion [...] deviendra un projet corporatiste et ne méritera plus l’appellation de projet de libération. »35 Ce projet doit s’articuler bien évidemment avec les luttes antiautoritaires, anticapitalistes et antipatriarcales pour un changement radical de la société et non l’aménagement d’un capitalisme moderne. Les causes structurelles de toutes les discriminations sont « liées à l’exploitation et à l’expropriation économique de certains groupes par d’autres. Dans ce sens, est-il possible de continuer à défendre la stratégie politique de l’identité comme un élément rassembleur et contestataire produisant une proposition révolutionnaire contre le racisme, le sexisme et le classisme ? Qu’implique la revendication d’une identité, quand les rapports sociaux se définissent fondamentalement sur la base des rapports économiques ? ».36
Chantal EFE (OCL Toulouse)
En 81, Mitterrand, avec la gauche PS/PC, vient de prendre le pouvoir de l’État français et, malgré les déceptions que ce pouvoir fera naître rapidement (le PC abandonnera ses postes ministériels en 83), de nombreux ex-militants de la gauche du Parti Socialiste des années 70 vont progressivement l’intégrer. C’est ainsi que le Parti Socialiste Unifié disparaît, certains de ses cadres devenant députés, ministre (Mme Bouchardeau) et même Premier ministre (Rocard).
Malgré tout, il reste de cette nébuleuse extrême gauche des petits groupes qui se définissent encore, au début des années 80, comme étant « alternatifs », « autogestionnaires », même si ces mots, très à la mode dans les années 70, n’ont pas ou plus aucun contenu un tant soit peu révolutionnaire. C’est dans ce milieu que l’on voit apparaître un nouveau concept : « la Nouvelle citoyenneté », bien avant les cérémonies du bicentenaire de 89. Cette revendication est donc avancée sur le terrain politique par la gauche de la gauche et sa naissance s’explique en grande partie par la conjonction de deux phénomènes :
— La promesse du candidat Mitterrand sur « le droit de vote des immigrés » qui ne sera jamais tenue.
— La montée en puissance des revendications de jeunes issus de l’immigration.
De cette « Nouvelle citoyenneté », il ne restera, quelques années plus tard, que la revendication du droit de vote des immigrés alors qu’elle a eu bien d’autres contenus qui seront, pour la plupart, gommés par des apprentis politiciens avant que ne disparaisse l’adjectif « nouvelle ».
DE LA THÉORiE À LA PRATIQUE...
De nombreux intellectuels (sociologues, philosophes,...) se pencheront sur les formulations possibles de cette « Nouvelle citoyenneté ». A ma connaissance, une seule structure collective planchera sur ce sujet au milieu des années 80, le groupe dit de Navarrenx autour d’Henri Lefebvre. Ces travaux sont pour nous, révolutionnaires, intéressants car ils veulent toujours se situer dans une perspective de dépérissement de l’État, de l’État nation même s’ils reconnaissent d’emblée que revendiquer de nouveaux rapports entre individus et État complique sérieusement cette perspective. En effet, ce type de démarche peut tout simplement renforcer l’État, lui donner de nouvelles fonctions, de nouvelles légitimités.
Pour ce groupe la « nouvelle citoyenneté » signifiait « passer d’un homme éclaté à un homme moderne capable de réaliser la synthèse de sa vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle. Passer d’un citoyen éclaté à une Nouvelle citoyenneté réalisant la synthèse du sujet politique, du sujet producteur et du sujet citadin-usager-consommateur. Passer du citoyen de l’État nation à la fois au citoyen planétaire et au citoyen du local ». Il se hasardait même à en donner une définition : « La Nouvelle citoyenneté peut être définie, pour chaque individu et pour chaque groupe social, comme possibilité (comme droit) de connaître et maîtriser (personnellement et collectivement) ses conditions d’existence (matérielles et intellectuelles), et cela en même temps comme acteur politique, comme producteur et comme citadin-usager-consommateur, dans son lieu de résidence, dans sa cité et sa région, dans ses activités professionnelles comme dans les domaines du non-travail, mais aussi dans sa nation et dans le monde. » (extraits de l’avant propos « du contrat de citoyenneté » du groupe de Navarrenx).
Néanmoins et malheureusement, sur le terrain, en dehors des associations issues de l’immigration (voir plus loin), le contenu de cette « Nouvelle citoyenneté » se limitera, très rapidement (avant 1986, date de la fin de la première législature du P.S.) à la revendication du droit de vote aux immigrés, titulaires de la carte de résident, aux élections locales (municipales et cantonales) et européennes. Pas question de gêner la gauche au pouvoir en revendiquant ce droit de vote au niveau de la désignation des députés et du Président de la République, ce qui nécessiterait une modification de la Constitution de la Ve République pouvant avoir entre autre pour conséquence l’extension du droit d’accès au statut de fonctionnaire à des personnes n’ayant pas la nationalité française.
Le pouvoir expliquera maintes fois qu’il ne peut pas satisfaire cette revendication, qui a été en son temps une promesse électorale, à cause de la montée du Front National. En fait, le P.S. tient à utiliser Le Pen afin de garder le Pouvoir en déstabilisant la Droite. Et pour cela, il ne faut surtout pas « provoquer » cette extrême droite montante. Rappelons tout de même que Mitterrand réussira ainsi à se faire réélire en 1988 !
DE « L’ÉGALITÉ DES DROITS » À UNE RECHERCHE D’UNE
« NOUVELLE CITOYENNETÉ »
Les années 80 vont être le théâtre de l’apparition sur les terrains social et politique des jeunes issus de l’immigration. Depuis les années 60 et l’émiettement de l’empire colonial français on assiste à une modification sociologique importante de la population immigrée Elle passe progressivement d’une population de travailleurs vivant seuls en France (pouvant être mariés dans le pays d’origine) dans des foyers (dont les foyers SONACOTRA qui seront le lieu de luttes de résidents qui marqueront l’histoire de la première génération d’immigrés) à celle d’une population familiale donnant naissance à toute une génération d’enfants nés en France mais d’origine étrangère ou arrivés très jeunes sur le sol français. Cela s’explique par le fait que de nombreux immigrés issus de nos anciennes colonies ou protectorats tiennent à s’installer durablement en France, là où ils vendent leur force de travail. Ce regroupement familial est naturellement ressenti comme un danger pour les gestionnaires politiques de l’État Nation français qui n’en finiront pas de légiférer afin de le rendre de plus en plus difficile. D’ailleurs, pour la petite histoire, c’est une certaine Georgina Dufoix (du gouvernement Fabius) qui en 1984 interdira la régularisation sur le sol français de la famille immigrée, regroupée en obligeant le demandeur à solliciter ce regroupement alors que sa famille est encore dans le pays d’origine. Nous sommes donc, là aussi, très loin d’un soi-disant droit écrit dans un article de toutes les constitutions des États démocratiques à savoir le droit de vivre en famille.37
Avec la montée du chômage qui touche les pères de famille et qui ne donne aucun espoir de travail aux enfants qui ne seraient pas les meilleurs élèves à l’école de la République, avec la désignation toute trouvée de « l’immigré » comme bouc-émissaire par la classe politique qui joue « sur du billard » avec une population dont une grande partie n’a pas digéré la fin de « leur » empire colonial, avec une urbanisation démentielle qui concentre les familles les plus démunies (pas seulement immigrées car le parcage se fait surtout sur des critères de classes) dans des ghettos ; cette jeunesse issue de l’immigration va vivre l’exclusion, le racisme, la galère et ses dérives. Elle connaîtra même ses premiers morts, victimes de la police c’est-à-dire de l’ordre républicain ou des partisans de celui-ci (petits commerçants, petits propriétaires de voiture ou de pavillons « villa mon rêve », ...).
En 1983, une marche sur Paris de jeunes issus de l’immigration est organisée à partir de la cité des Minguettes à Lyon. Cette marche s’intitule « pour l’égalité et contre le racisme », elle est organisée à partir de l’association « SOS Avenir-Minguettes » et est sous le patronage « d’éducateurs chrétiens ». A son arrivée, c’est un énorme succès numérique (des dizaines de milliers de personnes) et médiatique alors que cette marche n’est pas porteuse de revendications clairement énoncées. L’Élysée accepte de recevoir une délégation de marcheurs qui en a fait la demande et Mitterrand la reçoit lui-même car il a compris tout l’enjeu politicien qu’il pouvait en tirer.
Cette marche provoque une mobilisation dans certaines cités avec la création d’associations à caractère culturel (faire survivre la culture des pays d’origine ou faire naître une culture urbaine) ou social (aide aux devoirs, commission juridique d’aide aux démarches administratives, ...).
Quelques mois plus tard s’enclenche une nouvelle dynamique qui est cette fois patronnée par des éducateurs et éducatrices en milieu ouvert plus ou moins liés à l’extrême gauche (au sens large). Elle débouchera sur « Convergence 84 » où des jeunes des 4 coins de la France convergeront sur Paris à mobylette. Dans chaque ville traversée, sur chacun des parcours, ils essaieront de rencontrer des jeunes afin de libérer leur parole et de dresser tout un catalogue de revendications. Le contenu a évolué car ces jeunes veulent dépasser la lutte traditionnelle antiraciste pour aborder le problème réel, vécu, de l’inégalité des droits. Cette inégalité a pour eux plusieurs origines : le fait d’avoir la nationalité française ou non, le fait d’être issu de l’immigration mais aussi d’être issu de familles dont le père s’est ou se fait exploiter durement. On voit donc apparaître au sein de ces « rouleurs » l’amorce de débats sur l’égalité des droits entre d’un côté le formalisme d’une citoyenneté donnée par l’acquisition de la nationalité française et de l’autre la réalité liée à l’origine ethnique déclenchant un racisme quotidien et à l’appartenance sociale qui les excluent doublement. Cette deuxième initiative sera marquée par des conflits entres les « rouleurs » et la majeure partie des associations antiracistes de soutien, sans parler des partis politiques de gauche et d’extrême gauche. Son arrivée sur Paris est marquée par un discours final rejetant toutes les formes de récupération et affirmant une volonté d’autonomie. Malgré tout cette marche est encore un succès numérique (des dizaines de milliers de manifestants) et médiatique mais dès que les dernières banderoles sont rangées, on sent bien que l’unité de tout un mouvement qui semblait émerger n’est plus possible.
En effet, apparaît dès l’arrivée de Convergence 84, une petite main jaune et un slogan « Touche pas à mon pote ». SOS-Racisme est né et capitalise en quelques mois le mouvement d’opinion antiraciste apparu dans la jeunesse scolarisée. Le parti socialiste au pouvoir a compris l’enjeu, il n’hésite pas à lui donner toutes les facilités d’expression, Mitterrand monte d’ailleurs lui-même au créneau, des industriels proches des socialistes financent son lancement. Les médias suivent, Jack Lang au ministère de la culture prend le relais et des vedettes du show-biz lui emboîtent le pas. Nous avons droit à des concerts gratuits avec des centaines de milliers de jeunes.
Nous sommes très loin de toute la problématique de Convergence 84. Cette « petite main » conçue par des publicitaires est un « hybride de la main de Fatma et de l’étoile jaune des juifs sous le nazisme » comme l’écrit Mogniss Abdallah.38 C’est en quelque sorte une réponse aux keffieh des jeunes qui marchaient en 83 ou qui roulaient en 84. Mais cette petite main et son slogan « touche pas à mon pote » orientent toute une partie de la jeunesse sensibilisée vers des questions humanitaires où le responsable de toutes les discriminations vécues n’est plus l’État et ses institutions, le système capitaliste mais l’individu ordinaire qui est raciste. Le plus drôle c’est que la L.C.R. et certains libertaires serviront, pendant des années, de « porteur de valises » à une entreprise politicienne de dépolitisation et d’encadrement.
D’autre part, il apparaît au sein même des jeunes issus de l’immigration qui ont bougé en 83 et 84, un courant qui prônera le repli communautaire (voire religieux dans certains cas) ; d’autres, au contraire essaieront de se lancer dans la stratégie de constitution d’un lobby arabe complètement intégré.
Néanmoins, dans la débandade, quelques associations de jeunes issus de l’immigration rejointes par des associations issues de la première génération (marocaine, tunisienne, algérienne, turque,...) vont poursuivre tant bien que mal la démarche esquissée par Convergence 84 à l’occasion d’une troisième marche qui se déroulera en novembre 85. Cette marche, la dernière de ce type, est concurrencée sur le plan médiatique par celle de SOS Racisme qui tente ainsi de récupérer cette pratique inaugurée en 83. Ce n’est pas un succès numérique car seulement quelques milliers de personnes manifestent pour son final à Paris. Cependant, elle est l’occasion de l’affirmation de l’autonomie de ces associations face au pouvoir socialiste (et à tous ses relais associatifs) qui a pour stratégie d’utiliser la naissance de toutes ces associations antiracistes dans un contexte de montée d’un certain Front National. Malgré tout, le P.S. perd les législatives de 86. Un certain Pasqua est nommé Ministre de l’Intérieur et sa première préoccupation est d’aggraver la loi sur l’entrée et le séjour des immigrés en France (dite « loi Pasqua »). Pendant l’été 86, une grève de la faim débute à Lyon avec pour slogan : « J’y suis, j’y reste ». Cette démarche redonne vigueur au jeune mouvement associatif immigré balbutiant et aboutit à des rencontres nationales associatives qui au fil des mois donnent naissance à un regroupement qui tente de définir le contenu d’une « nouvelle citoyenneté » qui devra être l’épine dorsale du mouvement associatif issu de l’immigration.39
LE CONTENU DE CETTE « NOUVELLE CITOYENNETÉ »
Ces associations se battent concrètement pour l’égalité des droits quelle que soit la nationalité des résidents sur le sol français. Naturellement, elles en viennent à revendiquer une citoyenneté qui ne serait basée que sur un seul critère : La résidence. L’État Nation français a connu deux périodes où ce seul critère fut retenu : la constitution de 1793 et surtout la Commune de Paris de 1871 où il fut appliqué par les communards quelle que soit leur nationalité. Dans le contexte de la fin du XXe siècle, en France, cela apparaît comme étant une revendication très difficilement gagnable.... Et alors ?
Leur revendication d’égalité porte sur l’ensemble du domaine du droit : Droit civil (expression, justice, protection, sécurité,..), droits sociaux (logement, école, prestations sociales,...) et droits politiques (rapport du citoyen et de la société civile à l’État, qui ne se limite donc pas au droit de vote et d’éligibilité mais doit poser le problème du contrôle du citoyen sur un État chargé d’appliquer les décisions collectives). Nous pouvons noter que jamais l’État ne fut remis en cause dans ses fonctions mais quel embryon de mouvement social fait cette remise en cause de nos jours sous nos latitudes ?
Ce qui est intéressant c’est que cette réflexion reste en phase directe avec le vécu de toutes les populations immigrées vivant sur le sol français qui ont bien compris qu’en matière de droits il y avait les droits formels et les droits réels. C’est ainsi qu’il ne suffit pas d’avoir la nationalité française pour avoir accès à tous les droits qu’elle confère sur le papier même si son acquisition empêche l’expulsion du territoire. Et là, intervient le vécu de la lutte de classe des premières générations d’immigrés. C’est ainsi que ces démarches associatives, dont le lieu d’intervention sera le plus souvent le quartier, proposeront une convergence entre tous ceux qui sont exclus, qui leur donneront un contenu de classe indéniable même si le critère d’appartenance ethnique restera parfois déterminant sur le terrain.
Cette recherche d’une Nouvelle citoyenneté a eu aussi le mérite de poser le problème du soutien. Le soutien à l’immigration se cantonne bien souvent à un antiracisme humanitaire où il y a des victimes et où ceux et celles qui les défendent sont des altruistes ou ont des intérêts extérieurs à l’immigration. Or, cette recherche à montré les liens possibles entre les différentes communautés de vie ou groupes sociaux ayant des intérêts communs donnant ainsi un contenu social et politique à la solidarité.
Une carte de citoyen ayant pour fonction de remplacer la carte de nationalité française ou la carte de séjour fut émise en 1987. Malgré son succès dans les villes où ce réseau associatif existait, elle n’a pas eu l’impact souhaité capable de dépasser le cadre des personnes déjà sensibilisées.
ÉPILOGUE
Cette « Nouvelle citoyenneté » était alors portée par des associations de jeunes et de moins jeunes personnes issues de l’immigration maghrébine dont les familles (au sens large) étaient bien intégrées depuis presque une génération à leur environnement et en particulier à leur quartier. L’immigration récente (venant d’Afrique noire ou de Turquie) n’avait pas les mêmes préoccupations, leur droit au séjour en France était pour beaucoup d’entre eux leur principale revendication. Quant aux personnes issues des migrations antérieures (portugaises, espagnoles, italiennes, polonaises), leur tissu associatif très vivant n’est que culturel. Elle ne pouvait donc pas être un but unificateur de toute l’immigration installée en France.
De plus, en l’absence de mouvements sociaux d’envergure permettant à des gens de divers horizons culturels mais vivant la même réalité sociale de se rencontrer dans des luttes, il était logique que cette « Nouvelle citoyenneté » reste confinée à la théorie tout en dérivant pratiquement dans l’institutionnel.
En 1988 se tinrent des États Généraux de l’immigration pour une Nouvelle citoyenneté. 125 associations furent représentées et ce sera la dernière apparition centrale de ce mouvement associatif. Il y fut surtout question de participation et d’intégration dans les structures existantes (comité de locataires, associations de parents d’élèves, conseils d’administration des caisses d’assurance, des H.L.M..., commissions diverses dont les extra-municipales,...) sans aucune analyse du rôle, de la fonction, du contenu de ces institutions et surtout sans mettre en avant la nécessité d’un rapport de force sur le terrain obtenu grâce à des luttes. En fait, ces États Généraux furent un glissement de ce milieu associatif d’une position de lutte sociale, de classe à une revendication de participation à la gestion de la société française telle qu’elle est.
Pouvait-il en être autrement ? Assurément NON !
Denis (O.C.L. Reims)
Il est évident que toute vie en collectivité nécessite des accords communs décidés librement par chacune et chacun des membres de la collectivité. C’est a partir des bases de ce postulat que le républicanisme définit une partie des cadres du citoyennisme, omettant bien évidemment de préciser que l’ensemble des règles qu’il dicte ne sont pas débattues et décidées en commun et que les membres « associés » n’ont jamais été consulté quant à leur appartenance ou non à cette collectivité (la nation). Cette usurpation effectuée, l’État des Citoyens peut donc au gré de ses volontés et de ses intérêts définir les règles (la loi) et se glorifier de représenter « l’intérêt général » qui n’est en fait que l’intérêt de celles et ceux à qui il profite. De plus, bien que les droits et les devoirs soient affichés comme proportionnels, ils sont en fait complètement déséquilibrés (citoyenneté à l’école par exemple) au profit de l’ordre du plus fort et au détriment de celles et ceux qui subissent les devoirs.
QU’EST-CE QU’UNE COLLECTIVITÉ LIBRE ?
Une collectivité libre est une collectivité où chaque membre fait le choix d’y appartenir, d’après des critères qui lui sont propres. Chacun/chacune peut faire le choix de s’en séparer et d’en changer, et participe à l’ensemble des modes de décisions. Il y est appliqué une démocratie directe qui permet à l’ensemble des participantEs de s’y exprimer, de décider et selon les cas aussi de changer ce qui est établi. La collectivité est « élargissable » à souhait. La démocratie directe appliquée et transmise doit empêcher la création puis la prise de pouvoir d’une classe sociale sur une autre. Autant dire que de là où nous sommes aujourd’hui, il faudrait une révolution pour y arriver. Et c’est bien ce que la notion de droit et devoir cherche à endiguer ! En faisant croire que nous nous trouvons dans « le moins pire des systèmes », on s’essaye à donner des gages d’égalité à celles et ceux qui sont « un peu moins égaux que d’autres » afin de créer un état de résignation : il n’y a qu’au pauvre qu’on demande d’être citoyen.
QU’EST-CE QU’UNE NATION ?
Car en effet, dans quel monde nous trouvons-nous ? Un monde où les riches dominent les pauvres, organisé dans un ensemble de collectivités : les États nations qui se sont constitués historiquement, au fil du développement de l’espèce humaine, de sa domestication et de sa domination. La nation est souvent prise au sens de l’État qui structure l’ensemble des prises de pouvoirs de la société, et non de la nation qui désigne des collectivités d’individus partageant des traits communs, langue, histoire, habitat,... La nation étatique c’est à dire l’État nation s’oppose à toute collectivité libre et la combat :
— Nous ne choisissons pas notre nationalité, elle nous est imposée à la naissance. Dans de rares cas, il nous est proposé d’en acquérir une nouvelle quand elle n’est pas directement obligatoire (ce qui est le cas des enfants de migrantEs). Le choix reste déterminé par les seuls caractéristiques reconnues que sont le sol et le sang. On fait fi des envies et des choix ! Ils et elles sont même combattuEs, comme le sont aujourd’hui par exemple tous les sans-papiers.
— Les modes de décisions sont prises par des représentants qui décident eux-mêmes les modes de leur désignation, sans que les membres exposés aux droits et devoirs de leur condition ne soient consultés. Et quand, ils et elles le sont (les élections très souvent à scrutin majoritaire), ces mêmes représentants se foutent aussi bien de celles et ceux qui n’ont pas marché dans leurs combines que de celles et sont qui s’y sont risqué. Ces représentantEs fixent les lois applicables à l’ensemble du territoire national. Et seule une remise en cause par la force peut empêcher ces autoproclamés de continuer leur bout de chemin. L’accès à la représentation nationale est dicté par un déterminisme social qui attache à la naissance celui et celle qui va travailler et celui et celle qui va faire travailler. Il n’y a, surtout aujourd’hui, que très peu de passerelles entre les classes dans l’accès à la représentation nationale, et quand bien même elle existe, c’est toujours vers « l’intérêt du plus fort qui est toujours le meilleur » que s’ouvre la passerelle.
RÉPUBLICANISME, CAPITALISME
ET INTÉRÊT GÉNÉRAL : LES DROITS
Le « service public » est souvent donné en pâture à celles et ceux qui doutent des droits que la citoyenneté offre. Mais là encore, l’exigence que tout service soit rentable pour être viable (organisation de la société pour les patrons au détriment du monde du travail), maintient le droit dans le secteur économique. Ces droits sont sensés être assurés par l’État via les services publics (transport, énergie... certains y mettent même les flics !). Mais ces services ne sont en sorte que de vulgaires marchés qui comme n’importe quels marchés se fichent de l’intérêt et des avis des membres la collectivité nationale en ne portant grâce qu’au jeu de l’argent et du profit. Pour exemple, les lignes de TGV sont décidées dans « l’intérêt général » (l’économie capitaliste et principalement les marchandises, main d’œuvre comprise), et non pas pour celles et ceux qui en supporteront les conséquences (proximité des lignes et travailleurs). Le choix du nucléaire pour la production d’énergie quant à lui, a été pris en catimini par un lobby du lobby. Il est aujourd’hui assuré dans une complète désinformation qui se fout pas mal d’un droit à l’information. Le droit à l’information sensé contre-balancer les représentants nationaux est en fait lui aussi complètement lié à la loi de l’argent et les informations connues sont celles qui s’adaptent à la rentabilité, non celles qui s’adaptent aux besoins de connaissance d’une collectivité sociale. De ces droits là, aucune dignité n’est laissée aux citoyens : ces services en étant payants sont donc limités non pas par le besoin mais par le fric. La répression est terrible pour celles et ceux qui ne s’acquittant pas de l’argent dû, souhaitent quant même jouir de leurs droits. Ce qui est sensé être un droit, n’est donc qu’un grossier moyen d’enrichissement des plus riches et de privations des plus pauvres.
UNE ÉTHIQUE DE LA RESPONSABILITÉ :
LE CIVISME ET LES DEVOIRS
Les devoirs de la citoyenneté représentent en fait tous les intérêts de l’articulation droits et devoirs. Exiger des devoirs de quelqu’un sans lui assurer des droits c’est reconnaître le rapport de force qui anime les classes sociales. Offrir des droits même trompeurs, permet de réclamer des devoirs qui eux sont conséquents. Le tout est d’y croire, là est la fonction de la valeur citoyenne : accepter.
Pour comprendre cette inégalité entre droits et devoirs, il suffit de regarder dans les écoles républicaines françaises où les règlements intérieurs sont friands de cette dualité. Aux cases « devoirs », l’écolierE, collégienNE, LycéenNE se doit de respecter des comportements très précis : vocabulaire utilisé avec les autorités, attitude vestimentaires stricts (retirer une casquette par exemple), accepter l’enseignement et ne rien faire pour détourner le cours normal, attitudes de travail exigées, interdiction de ce qui se rapporte à la sexualité (les baisers des bancs publics, mains amoureuses, attitudes vestimentaires) etc. A la précision des devoirs s’oppose le flou des « droits » : droit à l’éducation (mais de quelle éducation ?), droit au respect (c’est ça le respect ?), droit à l’intégrité physique (manquerait plus que ça !), qui sont en plus des aspects qui intègrent l’acceptation de la structure et des rapports de force qui la fondent : accepter l’école telle qu’elle est, le respect tel qu’il se définit, et l’intégrité physique là où elle est. Spectaculairement élaborée par des représentants de l’autorité scolaire en compagnie d’élèves, la rédaction de ces lois restent dictée par les adultes qui restent maîtres du sens des mots et de leurs applications. Et si jamais, on en venait à critiquer tout cela, avec aisance on rappelle que dans la case « devoirs », il y a « respect du règlement intérieur » : la boucle est bouclée !
On retrouve les mêmes structurations dans l’établissement de la justice et de la sécurité publique qui est affiché, avec beaucoup d’actualité, par les républicains. La justice est un droit qui coûte cher, entendez qu’il n’est offert qu’à celles et ceux qui en ont les moyens : frais d’avocat, de procédure, délais de remboursement très longs.... La justice comporte des codes qui ne sont compréhensibles que par celles et ceux qui ont pu prendre le temps de comprendre le charabia. Le monde du travail par l’absence d’accès à la connaissance juridique et par sa non-solvabilité s’exclut de lui-même de la justice. La justice maintenant l’équilibre de la structure nationale définie par la loi, elle-même rédigée par les auto-proclamés de la représentation nationale, ne peut donc que faire ce qu’elle doit faire : respecter la loi du plus fort, respecter l’argent et celles et ceux qui la détiennent.
Cette justice de classe définit, elle aussi, un autre critère qui pour faire accepter les devoirs du citoyen (respect de la loi), il faut que spectaculairement on ait l’impression d’avoir eu le droit d’y être entendu : le flonflon des cours de justice sert à faire croire. La notion de « faire croire » s’oppose évidemment à celle « d’être ».
La notion de sécurité publique est, elle aussi, énoncée dans le cadre du droit du citoyen. Mais en réalité pour les plus pauvres, c’est plus dans la case des devoirs, qu’ils la subissent : accepter les agents de la force publique quoi qu’ils fassent.
En même temps que la société de classe rend les pauvres plus pauvres, et les riches plus riches, qu’elle précarise une part importante de la collectivité nationale, en les privant de logement, de nourriture, etc. via l’argent, la bourgeoisie renforce aussi le lien souhaité entre classe pauvre et classe dangereuse. Si bien que ce qui apparaissait initialement comme un droit n’est en fait qu’une nécessité pour le maintien du socle et de son évolution. Mais dans une collectivité libre, égalitaire et sans classe, les notions de justice et de sécurité publique sont bien différentes : est juste ce qui débattu et décidé collectivement, est sécurité ce qui procure une certaine garantie de préservation face à l’imprévu ou contre l’arbitraire des dominants.
Jérôme ch, (OCL Strasbourg), 25/02/03)
Dès sa création, l’École de la République s’est vu confier une fonction idéologique essentielle : après le double traumatisme de la Commune et de la défaite face à la Prusse, il fallait ressouder la nation en instaurant l’illusion d’une égalité républicaine et en insufflant l’esprit de la patrie dans la caboche des petits « Français » des provinces comme de l’empire colonial... Un État français et deux Républiques plus tard, il n’est donc pas surprenant de voir l’Éducation nationale propager le citoyennisme ou l’idéologie citoyenne.
D’UNE MORALE IDENTITAIRE...
Depuis Ferry (Jules) l’instruction civique (ou éducation civique et morale) a toujours compté au nombre des enseignements scolaires, sous diverses appellations, en tant que discipline spécifique, ou encore diluée en tant que point programmatique particulier des différentes disciplines. C’est d’ailleurs Chevènement, pas encore créateur du mouvement des citoyens mais Ministre de l’Éducation nationale qui rétabli en 1985 une « éducation civique » en tant que telle, quand dans le même temps il réintroduit la Marseillaise en primaire, et multiplie les protocoles d’accords Armée-Éducation.
Une éducation civique à l’école semble difficilement contestable, tant il paraît en effet indispensable d’avoir dans son bagage éducatif, une certaine connaissance du fonctionnement du système politique, juridique et social dans lequel on vit. C’est même une des conditions des possibilités de sa critique. Le débat a donc pu porter tout au long du XXe siècle sur les modalités de cet enseignement, et de la distance critique que permettaient les enseignants pour échapper à la simple propagande électoraliste de l’État. Mais en ceci rien de bien différent avec les autres disciplines : il n’y a pas de neutralité ou d’objectivité des connaissances, et leur transmission est toujours l’expression d’un parti pris ou d’un a priori.
... AUX TROUBLES CITOYENS !
Ce qui est relativement nouveau, c’est qu’avec la valse permanente des concepts (certains appellent cela la modernisation, d’autre le changement, d’autres encore le progrès) l’éducation citoyenne se soit substituée à l’instruction civique et morale. Ceci dans une période (les années 80) où la gauche moderniste était en quête d’une « nouvelle citoyenneté » fondée sur les droits de l’homme et l’antiracisme et autres valeurs coupées de toute assise sociale.
Ainsi comme le dit fort bien JC Michéa « quand la classe dominante prend la peine d’inventer un mot (« citoyen » employé comme adjectif) et d’imposer son usage, alors même qu’il existe, dans le langage courant, un terme parfaitement synonyme (civique) et dont le sens est tout à fait clair, quiconque a lu Orwell comprend immédiatement que le mot nouveau devra, dans la pratique, signifier l’exact contraire du précédent. ».40
Et Michéa de développer son analyse : « Quant à (...) la nécessité de transformer l’élève en consommateur incivil et, au besoin violent, c’est une tâche qui pose infiniment moins de problème. Il suffit ici d’interdire toute instruction civique effective et de la remplacer par une forme quelconque d’éducation citoyenne, bouillie conceptuelle d’autant plus facile à répandre qu’elle ne fera, en somme, que redoubler le discours dominant des médias et du show-biz ; on pourra de la sorte fabriquer en série des consommateurs de droit, intolérants, procéduriers et politiquement corrects, qui seront, par là même, aisément manipulables tout en présentant l’avantage non négligeable de pouvoir enrichir à l’occasion, selon l’exemple américain, les grands cabinets d’avocats.
Naturellement, les objectifs ainsi assignés à ce qui restera de l’École publique supposent, à plus ou moins long terme, une double transformation décisive. D’une part celle des enseignants, qui devront abandonner leur statut actuel de sujets supposés savoir afin d’endosser celui d’animateurs de différentes activités d’éveils ou transversales, de sorties pédagogiques ou de forums de discussion (conçus, cela va de soi, sur le modèle des talk-shows télévisés) ; animateurs qui seront préposés par ailleurs, afin d’en rentabiliser l’usage, à diverses tâches matérielles ou d’accompagnement psychologique. D’autre part, celle de l’école en lieu de vie, démocratique et joyeux, à la fois garderie citoyenne — dont l’animation des fêtes (anniversaire de l’abolition de l’esclavage, naissance de Victor Hugo, Halloween...) pourra avec profit être confiée aux associations de parents les plus désireuses de s’impliquer — et espace libéralement ouvert à tous les représentants de la cité (militants associatifs, militaires en retraites, chefs d’entreprise, jongleurs ou cracheurs de feu, etc.) comme à toutes les marchandises technologiques ou culturelles que les grandes firmes, devenues désormais partenaires explicites de « l’acte éducatif », jugeront excellent de vendre aux différents participants. Je pense qu’on aura également l’idée de placer, à l’entrée de ce grand parc d’attractions scolaires, quelques dispositifs électroniques très simples, chargés de détecter l’éventuelle présence d’objets métèques ».
La critique est sévère, le trait forcé, mais le tableau dressé sur les bases de tendances observables depuis plusieurs années dans le système éducatif induit bien la confusion ambiante autour de la mise en œuvre de cette pseudo-citoyenneté dans les établissements scolaires et de ses effets. Car les choses se sont singulièrement compliquées lorsque l’École a cessé de se contenter d’apprendre les principes civiques (acquisition de la citoyenneté, mécanisme électoraux, division des pouvoirs, etc....) mais s’est mise à prétendre les mettre en pratique, en faisant de l’élève un citoyen de la communauté scolaire, préfigurant ainsi sa future citoyenneté politique et sociale.
L’ÉCOLE PROPÉDEUDIQUE
DE LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVO-PARTICIPATIVE
Être citoyen cela signifiait appartenir à une collectivité politique dont on était membre agissant, et dont notamment on instituait la loi par des pratiques politiques, aux premiers rangs desquelles le débat et le vote. Être citoyen c’était prendre part à une collectivité historique et géographique en devenir, et donc arrêter des choix et des décisions en fonctions de modalités définies mais modifiables.
Que reste-t-il de ces principes appliqués à l’école ? La scolarité est obligatoire, les programmes sont définis nationalement, les enseignants sont désignés, les établissements sont quasiment imposés : il y a donc d’entrée peu de chose de négociable et de discutable dans l’école. L’institution a certes inventé l’autonomie des établissements et leur liberté de construire des projets. Mais l’autonomie se limite au vote par les conseils d’administration de convention et de contrat d’entretien par ailleurs obligatoire ou du choix des manuels scolaires. Bien sûr, les élèves sont représentés par des délégués dans ces conseils d’administration : mais quand ils ont encore le courage d’assister à des réunions tristes et tardives, c’est pour ratifier par des votes des décisions dont ils ne maîtrisent le plus souvent ni les tenants, ni les aboutissants, pas plus d’ailleurs que les représentants de leurs parents ou des personnels de l’établissement. Et, pour le cas ou un vote aurait un sens (refuser par exemple la suppression d’une discipline dans l’établissement (langue rare) ou exiger que les crédits nécessaires soient donnés pour assurer tous les enseignements obligatoires) les autorités de tutelles (Académie, collectivité territoriale de rattachement, et Préfecture) disposent du droit d’invalider les décisions, et d’appliquer ce que bon leur semble...
L’adulte est le maître, l’enfant est l’élève, celui qui est là justement pour s’élever jusqu’au statut de l’adulte : l’égalité des citoyens face à la loi dans ce contexte devient proprement orwélienne tant certains sont plus égaux que d’autres. Et allez expliquer à un jeune de 14 ans qu’il doit respecter adultes et camarades en toutes circonstances quand lui-même subit au quotidien moqueries, brimades ou humiliations sous prétexte de le stimuler ou de ne pas le leurrer sur ses capacités. Faites comprendre à cet autre qu’il est exclu du cours parce qu’il a oublié son matériel, par le prof même qui la fois précédente avait oublié qu’il leur avait promis de leur rendre leurs travaux corrigés, et qu’il a eu le malheur de le lui dire... Ainsi, à partir du moment où le « citoyen » est présenté et vécu comme le produit d’un échange entre des droits contre des devoirs, le bon sens et l’indulgence qui devraient présider aux relations avec un groupe d’enfants s’effacent pour faire place à une comptabilité juridique fondée sur une dialectique du « j’ai le droit /il a pas le droit ». Le droit scolaire étant bien sûr conforme à son modèle pénal et bourgeois : il est conçu et utilisé pour étendre mes prérogatives et ma toute puissance en les faisant passer pour légitime. Un des problèmes actuel étant qu’à ce petit jeu, les élèves surpassent souvent des maîtres dépités, et qu’ils ont le nombre pour eux, et qu’à défaut, ils peuvent déjà faire appel à des professionnels du barreau pour les représenter et les défendre...
A l’école de la démocratie, les élèves élisent des délégués de classe. Ces délégués sont leurs représentants dans les différentes instances de l’établissement, depuis le conseil de classe qui fait le bilan et l’évaluation du travail de la classe et de chaque élève, jusqu’au conseil d’administration dont nous avons déjà parlé. Ces délégués sont définis comme des membres à part entière des différents conseils dont ils font partie, et a minima du conseil de classe. Imaginez la capacité d’intervention d’un élève dans une collectivité d’adultes, majoritairement enseignants. Pour cela les délégués sont formés, et certaines formations leur permettent au moins une capacité d’expression.41 Seulement la plupart des formations n’ont pas prévu d’apprendre aux adultes à entendre cette parole de l’élève, qui sera inévitablement vécue comme une mise en cause des adultes et le délégué trop en verve aura tôt fait de se faire moucher, par une équipe enseignante pour le coup ressoudée. La parole des élèves est ainsi le plus souvent rabrouée parce que désobligeante ou agressive, ignorée parce que hors de propos, ou encore raillée parce que maladroite sur la forme ou sur le fond...
L’institution des délégués est cependant indispensable parce qu’elle garantit une démocratie de la transparence : rien n’est dit, rien n’est fait, mais tout est su, et rien ne saurait être contesté puisque décidé en accord avec les représentants des élèves ou des familles qui étaient présents ou auraient dû l’être.
L’institution des délégués n’est ainsi donc pas sans rappeler la fonction des syndicats dans le monde du travail : ils ont voix au chapitre pour la destination du centre de vacances du comité d’entreprise, ils seront éventuellement écoutés sur les conditions de travail grâce à leur présence au comité d’hygiène et de sécurité, mais leur parole sera sans suite compte tenu des impératifs de productivité...
PLUS T’ÉDUQUES LE CITOYEN,
PLUS IL S’ABSTIENT...
Le problème c’est que les élèves ne sont pas dupes, et que les déconvenues vécues à propos de la mise en pratique de l’éducation citoyenne dans les bahuts se sont traduites par un désinvestissement politique vérifiable par l’abstention et la non-inscription sur les listes électorales des jeunes.42
La multiplication des instances et des lieux où l’on discute ou tente de mettre en pratique une « éducation citoyenne » à l’école se sont multipliées. Des instances paritaires élève-adulte ont été créées dans les lycées sous le doux nom de Comité de vie lycéenne (CVL), structure démultipliée au niveau Académique et national (CAVL, CNVL), mais leur fonction essentiellement consultative sur des problèmes subalternes risque de rapidement épuiser leur succès de nouveauté. D’autant que la tentative de promouvoir un véritable syndicalisme lycéen grâce à ces structures, n’a pas permis à la Fédération Indépendante et Démocratie des lycéens de décoller de la région parisienne, ni de s’affranchir de la tutelle du PS et de SOS-Racisme qui s’étaient penchés sur son berceau dans les années 90...
De nouveaux cours sont apparus au lycée, notamment l’éducation, civique, juridique et sociale (ECJS), qui n’est effectivement qu’une matière de plus au programme, confié aux enseignants d’histoire géographie, tout comme l’éducation civique au collège.
Comme la citoyenneté est bien malade dans l’école, si le symptôme de son dysfonctionnement se mesure à l’aune de la médiatisation des phénomènes de violence dans les bahuts, l’Éducation nationale à fini par créer des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, qui sont censés mener des actions transversales et des projets sur ces thèmes dans les établissements, et qui ajoutent à la confusion des mots et des concepts : ainsi mettre son casque sur sa mobylette, participer à la semaine de la presse à l’école, mettre une capote en cas de relation sexuelle, dire bonjour à la femme de ménage, et ne pas fumer dans les toilettes du collège sont autant de gestes et d’actes citoyens qui pourront faire l’objet d’action éducative menées en synergie avec l’ensemble des membres de la communauté éducative et des partenaires extérieurs de l’établissement...
Cette confusion et ce mélange des genres ont pour effet immédiat de conforter les élèves dans une impression de discours démagogique de l’institution qui les berne, et renforce un sentiment d’impuissance par rapport à toute action collective qui serait vaine et vouée à l’échec.
L’éducation à la citoyenneté procède ainsi d’une véritable dépolitisation de la jeunesse, à qui l’on montre quotidiennement qu’aucun aspect de sa vie n’est maîtrisable, alors qu’on prétend constamment lui accorder et la reconnaissance statutaire et la parole.
L’État et l’Éducation nationale le savent bien et tentent en ce moment même de recentrer la citoyenneté de discours sur l’action et l’engagement. La dernière campagne en cours du Ministère de l’éducation nationale s’appelle « Envie d’agir ? ». Demandez à vos enfants ou à ceux de vos voisins qu’il vous ramène le « Guide de l’engagement » actuellement diffusé dans tous les collèges et lycées de France dans le cadre de cette campagne, et à destination des 11-28 ans. C’est édifiant ! Si le premier chapitre concerne l’engagement et l’envie d’agir dans... l’économie (!) le mot politique est tout simplement absent du guide.
Philippe (OCL Saint-Nazaire)
Durant ces dernières années, la visibilité spectaculaire des manifestations lors des sommets des « grands » de ce monde (Seattle, Prague, Nice, Gênes...) a permis de regrouper divers groupes sociaux prêts à se mobiliser. Ces groupes se sont souvent retrouvés dans des phases d’unité d’action, mais ils ont tous naturellement continué d’évoluer et de déclarer ce que leurs propres stratégies et leurs propres intérêts imposaient. Dans ce contexte, la notion de « citoyenneté » a traversé les débats qui se nouaient lors et autour des grandes messes. Elle stigmatise aujourd’hui une part des affrontements à l’intérieur de ce « mouvement », notamment en France, société de la mère patrie du citoyennisme.
LES CITOYENNETÉS CONTRE LA
RUPTURE AVEC LE CAPITALISME
On constate un large courant se réclamant d’actions et de présences citoyennes lors de ces mouvements. Mais ce courant est très diversifié :
On y trouve les « béni-oui-oui », mélange de clergés chrétiens et de laïcs rattachés à des églises qui voient dans le concept de citoyenneté un moyen d’adoubement envers les États se basant sur la séparation entre l’église et l’État ou un moyen de faire avancer une réforme dans les États affichant un lien constitutionnel avec une église.
On y trouve aussi une frange fondamentalement réactionnaire, voyant dans la citoyenneté, la respectabilité, la responsabilité, l’action de ne rien faire qui pourrait remettre en cause les rapports sociaux et de calmer les brebis égarées. Ces groupes sont souvent très virulents contre les manifestantEs usant de pierres contre l’ordre des puissants. Ils professent avec ardeur le stoïcisme de la non-violence.
A l’instar de la classe politique française, la citoyenneté est reprise avec cœur par l’ensemble des débris de la gauche française. Pour une bonne partie, la partie qui vénère « La » révolution française, le lien entre citoyenneté et République est une filiation historique qui a su s’adapter. De l’antimonarchisme, où la citoyenneté permettait, entre autre, d’engager une union entre la bourgeoisie et le prolétariat contre l’aristocratie, le citoyennisme a évolué durant le XIXe siècle pour être un socle national défendant les intérêts de la nation française. Un tournant a été l’union sacrée de 1914, avec une énorme partie de la gauche révolutionnaire ; elle a permis la première guerre mondiale. Il s’agissait à l’époque de défendre les valeurs de la République française contre le féodalisme allemand. Le citoyen et la citoyenne étaient donc appelé-e-s à la rescousse parce que la patrie était en danger et surtout parce que la citoyenneté liait les intérêts de l’individu avec celui de sa patrie et non plus à la bataille d’un sort meilleur. C’est de cette citoyenneté que des groupes de gauche font appel aujourd’hui lors des manifestations anti-globalisation : allégeance à l’État et défense de celui-ci, réhabilitation de ses prérogatives (exceptions culturelles...), vision de la nation de l’État et de l’État Nation (services publics)... comme si les États étaient détachés des intérêts économiques et sociaux de la bourgeoisie !
Il y a enfin une part non négligeable de groupes politiques radicaux qui font aussi appel à la citoyenneté. Bien qu’étant en rupture avec les autres groupes se réclamant de la citoyenneté d’État, ce professoral-là de la citoyenneté induit la notion vague de « récupération du champ politique » par l’individu isolé, neutre, sans goût et sans saveur ! Ce qui pose problème pour ces groupes. En effet, ce professoral de la citoyenneté exclut du champ historique toute intervention du militantisme, alors que pour ces groupes le citoyennisme devraient mener aux militantismes. Dans cette utilisation de la citoyenneté, il y a celles et ceux qui pensent que c’est une phase transitoire de prise de conscience politique. Donc en gros on commence par raconter des bobards ! Pour d’autres, attachés à s’allier avec la gauche républicaine, c’est une concession qui lui semble ne pas manger de pain. Pour d’autres enfin, c’est une commodité afin d’être dans l’air du temps, de ne pas faire trop radical tout de suite ou tout le temps, bref une légèreté...
Ce qui lie bien entendu l’utilisation de toutes ces citoyennetés, c’est de ne pas poser la rupture avec l’ordre du monde, avec le capitalisme.
LE CITOYENNISME, UNE IDENTITÉ DE CLASSE
Dans ces rassemblements, l’utilisation du citoyennisme est aussi une conception de classe : celle que l’on nomme les classes moyennes. Issue du prolétariat, cette couche sociale composée bien plus de fonctionnaires que d’ouvrier-e-s ou de paysan-ne-s, a été en première ligne des attaques de la bourgeoisie et de ses États les dix dernières années. Taxés de « privilègié-e-s », celles et ceux qui ont cessé de croire en l’ascenseur social et qui se retrouvent dans les manifestations « antiglobalisations » voient dans le « citoyennisme » une manière de concilier leur histoire, alors qu’en réalité ils et elles tentent de concilier des intérêts de classe. En effet, les intérêts ne sont pas les mêmes pour celles et ceux qui n’ont (plus) rien à perdre et celles et ceux qui essayent de conserver ce qui leur reste. Dans les classes moyennes « supérieures », le citoyennisme est aussi utilisé avec une condescendance caritative, « il faut bien faire quelque chose... peut être doucement, même si des fois ça sert à rien ! ». C’est à la fois, sur cette position de défaite, que l’on entend les leaders des groupes qui réclament le 0,01 % de la taxe Tobin (Attac...) et qu’on trouve les discours sur « la mondialisation » des élites de la gauche plurielle ou de la gauche unie. Actuellement, c’est sur cette identité de classe que se réforment les velléités social-démocrates (Porto Allègre, Forum social ...).
LE CITOYENNISME ET LA SOCIÉTÉ CIVILE
Un des problèmes essentiels, presque inavouable, qui colle aux lèvres du citoyennisme est qu’il est une idéologie qui fait marcher les affaires, tentant d’aménager les horreurs du capitalisme les plus criantes et offrant à la défaite la bonne conscience d’avoir essayé. Lors des manifestations et des forums organisés, il est souvent affirmé que c’est « en tant que citoyen-ne » qu’on peut demander des comptes à tel ou telle puissance. En fait, on constate qu’il s’agit là bien plus d’une idéologie de « lobby » que d’une idéologie politique structurée, l’objectif serait de faire passer le message du monde d’en bas aux puissances conciliantes d’en haut. Cette société civile qui est applaudie à se lever partout se révèle de fait tout aussi spectaculaire que le monde de la télévision et du spectacle. Les luttes dont fait référence cette société civile ne sont pas menées par celles et ceux qui s’en proclament. Cette société civile ne peut donc être qu’un relais médiatique. Pendant qu’il paraît important de rappeler que le sort des exploité-e-s ne dépend que des exploité-es, eux-mêmes et elles-mêmes, ce citoyennisme croit au ménage à trois et aux petits arrangements.
Jérôme ch, (OCL Strasbourg)
Il y a belle lurette que l’anti-étatisme ne fait plus recette. Dans les États développés, il faut remonter autour de 1968 (en France, Allemagne,... et surtout en Italie) pour assister au dernier assaut contre cette pieuvre à deux têtes (État/Capital) aux cerveaux complémentaires et inter-dépendants. Et encore, d’autres analystes remontent avant 1939, c’est-à-dire avant la seconde guerre mondiale ! Aujourd’hui, les « anticapitalistes » se ramassent à la pelle, mais cet anti-capitalisme ne montre du doigt que le libéralisme (comme il a évolué au cours du dernier siècle, on ajoute le préfixe « néo » afin de faire plus « branché » !), c’est-à-dire les formes privées prises par le capitalisme en particulier les multinationales qui, soit dit en passant, ont quasiment toutes leurs centres (cerveau et moelle épinière) dans un seul État développé (États-Unis ou États européens ou Japon). Quant aux anti-étatistes, existent-ils encore ?
L’ÉTAT ? QUI LE CONTESTE AUJOURD’HUI ?
Formellement, aujourd’hui, aucun mouvement social ne le conteste puisque quasiment tous ces mouvements s’adressent à l’État en tant que super médiateur dont ils ont intégré la soi-disant indépendance entre le travail et le capital. Ils demandent à l’État, aux « pouvoirs publics » comme aiment l’appeler les syndicats représentatifs (dont la représentativité a été donnée par qui à votre avis ?), de garantir des plans sociaux, de pallier aux « carences » d’un patronat que l’État désignera dans certains cas flagrants de « voyou » alors que c’est un magnifique pléonasme... Ils demandent même à l’État de subventionner le patronat privé afin que celui-ci crée des emplois quitte ensuite à dénoncer ce même patronat subventionné quand celui-ci décide, après en avoir largement profité, de mettre la clé sous la porte, de délocaliser géographiquement la production ou de chasser sous d’autres terres de nouvelles subventions. En répertoriant les entreprises qui se présentent pour reprendre telle ou telle entreprise en difficulté (et ceci au niveau mondial), on s’aperçoit qu’une fraction du patronat est spécialisée dans ce type de sport, comme ce fut hier, en France, le cas d’un certain Bernard Tapie. C’est un créneau comme un autre ! Comme nous allons le voir plus loin, l’État ne peut pas être neutre car c’est déjà à lui seul une entreprise capitaliste en tant que telle, une structure dont la fonction principale est de valoriser le capital, d’accompagner le capital, de le cadrer par un appareil judiciaire afin que celui-ci ne soit pas amené, dans sa logique perpétuelle de croissance et de développement, à détruire fondamentalement toute forme de vie dans notre galaxie et surtout à maintenir sur les rails les conditions de sa propre reproduction.
L’État, ce sont les allocations diverses et multiples qui permettent aux personnes les plus pauvres de nos pays de survivre via les organisations caritatives (secours populaire et catholique, restau du cœur, ...) mais aussi et surtout de consommer car le capital a besoin d’écouler ses marchandises afin de toucher les dividendes de la plus value créée par le travail humain et réalisé par la contribution directe (comme tout le secteur des transports) ou indirecte (formation, éducation, ...) d’un certain nombre de travailleurs qui peuvent avoir le statut public (travailleurs de l’entreprise État, dit « fonctionnaires ») ou privé suivant les intérêts fondamentaux du capitalisme qui sont : FAIRE DU FRIC, POSSÉDER, DOMINER... Cette survie donnée aux plus pauvres a une contrepartie terrible : LE CONTRÔLE SOCIAL qui permet à l’État, pour le bien être du capital, de contrôler cette masse dont la fonction n’était hier que de produire et qui est aujourd’hui « délaissée » au profit d’autres populations exploitées, souvent, mais pas seulement (voir le travail au noir dans nos sociétés dites développées), sous d’autres latitudes. Ce contrôle social pour se faire accepter par les « clients » et les travailleurs sociaux se justifie toujours en référence à la citoyenneté où les « droits » (manger, se vêtir, se loger) ne peuvent exister qu’en contre partie de « devoirs » (chercher et accepter n’importe quel travail, tenue propre de son logis, savoir s’occuper de ses enfants suivant des normes idéologiques prédéterminées,...) dûment contrôlés avec rapports écrits à l’appui ! C’est ainsi que des travailleurs sociaux communaux ont les clés des appartements alloués par la mairie à des familles en difficultés sociales afin de contrôler le contenu de leur frigo, la tenue de leur linge, le ménage, la vaisselle, les lits,...
Que l’État soit sollicité sur des questions liées à la propriété donc à un capital, à des rapports entre individus et institutions étatiques ou para-étatiques, cela se comprend puisqu’il est directement concerné. Le problème est que dans ce cas les dés sont pipés dès le départ puisque c’est l’État qui a fixé les règles même s’il a dû, dans certains cas (non fondamentaux, on élimine ainsi les grandes décisions de l’aménagement du territoire, le nucléaire, les OGM, l’industrie militaire, ...) et dans un temps qui restera limité, tenir compte d’un rapport de force issu d’une lutte collective. Dans nombre de luttes où des individus concernés se sont regroupés dans une collectivité, au niveau social mais aussi au niveau de l’écologie, de la remise en cause du patriarcat,... ces recours à l’État sont bien souvent synonyme de délégation de pouvoir (donné à des élus fantoches qui seront dénoncés plus tard mais trop tard !), de renoncement à l’action directe — c’est à dire à l’affrontement direct —, de capitulation.
L’État c’est aussi et surtout cette supermédiation entre individus ! Dès qu’un problème surgi, la justice est saisie afin « d’arbitrer » tel divorce, garde d’enfants, rapports de voisinage,... Cela concerne tous les rapports privés entre individus ! C’est peut-être là que sa légitimité est le plus reconnue car aucune autre force extérieure aux conflits inter-individuels, médiatrice, a su s’imposer hormis certains pouvoirs comme par exemple le pouvoir médical ou paramédical qui d’ailleurs sont sous contrat, d’une façon ou d’une autre, avec l’État. On ne peut que constater que l’État pallie aux replis d’autres médiations comme la famille, la communauté ethnique, religieuse ou sociale. Ces replis s’expliquent, ici, par l’évolution de l’exploitation capitaliste qui insinue toujours plus profondément sa logique dans tous les aspects de l’existence de l’individu et du collectif mais ces médiations de l’État n’ont jamais été satisfaisantes, c’est le moins que l’on puisse en dire, car liées aux développements des forces productives, au patriarcat, au colonialisme,... soit plus globalement à l’aliénation et à la domination ! Dans une société communiste libertaire, se posera ce problème de gestion des conflits inter-individuels non nécessairement uniquement dépendants du mode de production, de la répartition des richesses, de l’abolition des classes, de l’abolition du patriarcat (ou de leurs avancées !) et les solutions, même avec l’apport de la psycho... quelque chose, ne seront pas évidentes à trouver et à mettre en place même si cela sera plus palpitant que ce que nous vivons actuellement....
L’ÉTAT TOTALITAIRE
Disons le tout de suite, il n’est pas totalitaire seulement parce qu’il assume des fonctions répressives au niveau policier et juridique. l’État n’est d’ailleurs pas le seul à assumer ces fonctions de répression pour le capital quand nous connaissons le nombre de milices privées et leurs rôles dans maintes et maintes luttes ouvrières du 19ème siècle à nos jours !
« État policier » est un pléonasme mais son niveau répressif dépend toujours de plusieurs facteurs :
— De ses gestionnaires à un moment donné qui tiennent à garder le pouvoir politique de gestion des affaires de l’État, des Régions, des Cantons et des Municipalités qui ne l’oublions pas, pour plus de 3.000 d’entre elles en France, ont leur propre police privée. Dans ce cadre la recherche d’un bouc émissaire joue un très grand rôle et dans tous les cas ce sont toujours les exclus directs de la citoyenneté, c’est à dire ceux et celles qui n’ont pas la nationalité, ou indirects pour ceux et celles qui n’ont pas les moyens économiques, sociaux, culturels d’exercer cette citoyenneté formelle au moyen de lobbies influents qui sont utilisés.
— De l’état de délabrement de certaines parties de la société civile par rapport à la situation antérieure.
— Du degré des luttes sociales, de leur intensité, des revendications avancées par celles-ci intégrables ou non, à court terme, par le capitalisme où l’État pourrait servir de médiateur, de financeur, de force paritaire,...
Ces fonctions répressives sont très loin d’être les seules car si l’État est total c’est aussi dans le sens où il est devenu l’agent principal instantané et bien souvent unique de la socialisation des individus.
Comme nous l’avons dit plus haut, il encadre quasiment toute notre vie individuelle ou collective au niveau social, politique et même culturel. Il absorbe toutes nos relations jadis privées pour les institutionnaliser en organes de l’État ou dépendant de celui-ci (syndicats, associations, Organisations Non Gouvernementales). Ce totalitarisme est passé dans les mœurs à tel point que plus les gens sont dépouillés par le système capitaliste plus ils attendent de l’État et font appel à lui.
LES ÉTATISTES
Dans ce cadre on peut se demander pourquoi des mouvements politiques, associatifs, syndicaux,... les plus divers mais toujours globalement de gauche, constatent le désengagement de l’État, en appellent à son renforcement et fondent leur stratégie électorale de lobbying là-dessus alors qu’il est évident que l’État n’est jamais autant intervenu socialement ? Bien sûr, on est passé de prestations sociales d’assurance (assurance chômage, assurance maladie) à des prestations sociales dites universelles (RMI, CMU, etc.), ce qui fait dire à certains que l’État n’est plus ce qu’il était. En fait ce qui a changé ce sont, ICI, les formes d’exploitation non plus seulement liées à la production directe d’objets. On s’aperçoit que l’État n’est plus ce qu’il était que par rapport à la période antérieure où il était surnommé « l’État providence ». Notons que cet « État providence » n’a duré qu’une trentaine d’années maximum (« les trente glorieuses »), une période donc très courte qui ne sera plus bientôt qu’un lointain souvenir pour les anciens. Cette période constituait l’application des méthodes américaines du New Deal et du Keynésianisme (pour sortir les USA de la crise de 29) à l’Europe occidentale de l’après-guerre, pour dégager un marché de consommateurs face à une Europe de l’Est sous la botte stalinienne mais censée représenter le paradis des Prolétaires. Il n’a touché que les États où le capitalisme était développé et n’aurait pas existé sans l’accaparement impérialiste des richesses mondiales, tout particulièrement des matières premières. Dans cette période l’État a développé le capital financier, notamment par la dette publique payée par les impôts. La bureaucratie a enflé et la fiscalité est devenue écrasante. l’État fut très actif par rapport au capital financier au niveau organisationnel mais il n’est jamais maître de la monnaie (voir les taux annuels d’inflation difficilement maîtrisables par les gestionnaires de l’État même s’ils étaient des économistes de renommée mondiale comme un certain Raymond Barre en France), ni d’ailleurs de l’accroissement de la dette publique. l’État providence fut marqué par un élargissement de la consommation dans les métropoles centrales du capitalisme qui est une nécessité pour le capital car l’extension du machinisme décuple la production beaucoup plus vite que le nombre de consommateurs. Cette période peut paraître à certains idyllique mais l’État a organisé, encadré le consensus social minimum afin que se reproduise cette société capitaliste. On oublie bien souvent de dire que même dans les États capitalistes concernés par cette « providence » capitaliste (Europe de l’Ouest, Amérique du Nord) il y a une fraction non négligeable de la population qui en restera toujours exclue ! Cette période, une parenthèse dans l’histoire du capitalisme, ne pouvait pas durer car l’augmentation de la productivité (le machinisme) diminuera sans cesse le travail vivant dans ces métropoles sapant ainsi la base fondamentale de la production de la plus value.
En fait tous ces étatistes de gauche en sont restés à l’idée d’un État indépendant (avec l’avènement du suffrage universel très progressif puisqu’il a duré près d’un siècle, de la moitié du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle pour la plupart des États des métropoles capitalistes) au-dessus des classes, n’ayant plus rien à voir avec son image précédente d’État bourgeois. Il suffit donc d’en prendre « démocratiquement » le pouvoir (comme l’ont théorisé très tôt les sociaux-démocrates allemands) ; Ils y arrivent d’ailleurs périodiquement depuis plus d’un siècle avec les résultats fondamentaux que nous savons. Leur dernière invention aura été de reprendre l’idée d’un économiste américain, un certain Tobin, de taxation des opérations financières effectuées sur le marché des changes proportionnelle au montant de l’opération effectuée. Cette proposition étatique de Tobin avait pour but de limiter la casse en cas de dérive du capital afin de sauver celui-ci. Ce prof d’économie, profondément pro-capitaliste, s’est toujours demandé, de son vivant, pourquoi la gauche française voire européenne s’était emparée de son idée. Cette proposition, qui d’ailleurs sera peut-être adoptée un jour par les États, entre dans le cadre d’une des fonctions des États qui est de limiter les excès du marché car le capital est capable dans sa logique de détruire complètement la société !
Ces étatistes entretiennent l’idée que l’État aurait en charge « l’intérêt général », mais que dépossédé de son pouvoir de décision par ce libéralisme débridé dans le cadre de la « mondialisation » il serait acculé à une course éperdue en faveur des gros investisseurs.
En fait, il y a méprise sur la marchandise depuis l’éclosion des États Nations ! Cette méprise ne peut plus s’expliquer par des choix stratégiques afin d’arriver au communisme intégral, datant de la moitié du 19ème siècle, entre ceux qui pensaient avec Marx qu’on pouvait utiliser l’État qui dépérirait ensuite et ceux qui avec Bakounine pensaient qu’on ne pouvait utiliser un outil dont la fonction primaire était déjà à cette époque la sauvegarde du capital et qui ne pouvait que se renforcer. L’Histoire aura donné raison aux seconds mais cela ne suffit pas !
AU FAIT L’ÉTAT C’EST QUOI ?
C’est au départ un pouvoir extérieur à la société civile constitué d’individus isolés mais propriétaires ou de privilégiés comme les aristocrates de cour en rupture avec les anciens nobles qui guerroyaient mais ne travaillaient pas sous peine de déchoir. Sa fonction primaire fut d’organiser les conditions du marché, l’unité des individus/bourgeois séparés. Cette force politique, au sens premier du terme, a eu pour fonction, dès sa naissance, de créer les conditions afin que le capital puisse se développer sans entraves. Au départ et jusqu’en 1848 au moins il ne peut être aux mains que des bourgeois puisque les « gueux » n’ont pas le droit de vote (suffrage censitaire, réservé aux riches). Jusqu’à la Commune de Paris (1871) l’État n’a qu’un rôle coercitif vis à vis des ouvriers qui œuvrent, non pour en changer son personnel dirigeant, mais pour tout simplement l’abolir. Puis son rôle va se diversifier, il va légiférer des droits comme celui du travail, sociaux, etc. afin de calmer, d’intégrer, de canaliser puis d’assimiler les exploité/e/s. Mais sa principale fonction a été et est toujours la reproduction du capitalisme, la valorisation de celui-ci. Bref, comme le dit si bien Tom Thomas dans son livre l’État et le Capital, l’exemple français43 : « Il n’y a pas deux politiques de l’État, l’une dite libérale en faveur du capital et de la création des richesses, l’autre dite sociale et droit de l’hommiste en faveur du travail et des individus. Mais une seule politique globale de valorisation du capital qui intègre le social, la réforme, comme moyen pacifique de soumission du travail au capital mais tenant bon sur l’essentiel : La division sociale du travail (la propriété), l’argent, le salariat, l’État. ». « ... L’aliénation des individus lui permet de se donner des apparences démocratiques. Démocratie purement formelle puisque le peuple est dépouillé de toute puissance et de tous moyens qui lui soient propres dans sa vie réelle, son double politique, le citoyen, ne peut être alors qu’une vraie potiche ».
l’État moderne est aussi une entreprise capitaliste gérée par une bureaucratie et une technocratie inamovibles sans oublier la classe politique. Tout ce beau monde en retirant des avantages substantiels. Le capital de cette entreprise est essentiellement son territoire qu’il fait fructifier, ses infrastructures de circulation même s’il en donne de plus en plus l’entretien quotidien au secteur privé. Il vend au privé leur utilisation. Quant à ses marchandises ce sont les aides financières, techniques, scientifiques, administratives, que les capitalistes privés lui achètent en payant ces services et bien entendu des impôts.
Le fric investi par l’État revient dans ses caisses multiplié X fois même si ces profits sont longs à apparaître. La privatisation de ses services publics ne change rien à ce processus car l’État reste maître du territoire, des infrastructures de distribution (principaux axes routiers, chemin de fer, de distribution de toute l’énergie...). Ainsi, l’entreprise État a des liens constants d’échange capitaliste avec le privé.44
l’État est lié à la société civile, il en est même indissociable, il en est même un produit, à tel point que sa prise de contrôle par le suffrage universel a été et sera toujours vaine quant à aboutir à un réel changement de société. Si on veut changer ce monde, l’État ne sera jamais un moyen, et l’anticapitalisme n’a de sens que s’il est aussi anti-étatique (la réciproque étant évidemment vraie).
L’ANTI-ÉTATISME A PEUT-ÊTRE UN AVENIR....
La dépendance de l’immense majorité des gens vis à vis de l’État implique de fait une adhésion à l’État qui a rendu caduque pendant des décennies une opposition entre État et « société civile ».
Mais nous assistons aujourd’hui à des phénomènes qui doivent nous faire réfléchir. Au niveau électoral, il y a de plus en plus de candidats, représentant un échiquier de plus en plus large au niveau idéologique et qui ne se cantonnent pas dans ce domaine car on peut y trouver tous les corporatismes que la société engendre. Et pourtant il y a de moins en moins de votants ! Beaucoup d’analystes pensaient que ce phénomène abstentionniste serait limité dans le temps, rien n’indique que cela sera le cas quand on sait qu’aux dernières présidentielles, un pseudo danger fasciste, bien orchestré, manipulé, médiatisé à l’extrême (qui a fait voter pour Chirac nombre de militants au label révolutionnaire, il est toujours bon de le rappeler !) n’a pas fait descendre le taux d’abstention à moins de 20%, un record pour ce type d’élections. Et pourtant il y aurait eu paraît-il un « sursaut républicain » qui a fait plouf quelques semaines plus tard aux législatives ! Décidément, une forte proportion de citoyens formels ne croit plus à cette démocratie représentative car tout simplement ils ne se sentent plus représentés (contrairement à une époque où le PCF faisait 25 % !).
L’immense majorité des gens qui ne votent plus est constituée d’exclus de la « citoyenneté » réelle. Bien sûr l’adhésion à l’État ne se limite pas à la participation aux élections de son personnel gestionnaire. Bien sûr on peut arriver à un système électoral avec seulement 50 % de votants comme aux États-Unis. Mais néanmoins, l’idée que, quels que soient ses gestionnaires, l’État sera toujours du côté des possédants et l’idée que changer le personnel de l’État ne peut changer quoique ce soit, progresse ! Bien sûr on en est à un stade où une masse grandissante de gens ressent l’État comme étant simplement impuissant et le fait que l’État soit l’organisateur du capital est encore loin d’être ressenti. Une majorité, afin de résoudre ses misères, demande encore et toujours un État plus fort, plus répressif sans se rendre compte qu’elle va en être la victime, que l’État va de plus en plus cogner, enfermer,... sans contrepartie sociale hormis le minimum de survie, le tout étant lié aux difficultés croissantes de la valorisation du capital.
Le réel changement de société avec comme moyen la révolution peut devenir ou revenir de plus en plus à l’ordre du jour. En toute modestie, nous devons nous y employer tout en sachant que la masse des prolétaires devra rester maître de son destin tout en prenant en compte tous les aspects de la domination (patriarcal, économique, colonial, ...) si nous voulons nous libérer de toutes les formes de domination et d’aliénation.
Denis (OCL Reims)
Le retour de la citoyenneté dans le paysage politique français ne correspond ni à une simple mode ni à un retour vers une utopie révolutionnaire fondée sur une volonté égalitariste. Il est la manifestation idéologique de l’offensive des classes dominantes pour réunifier l’espace social en laissant indemnes les contradictions du mode de production capitaliste. Une réunification imaginaire basée sur l’unité nationale et représentée par l’État.
L’INTÉGRATION CONTRE LA RUPTURE
Il y a à peine plus de dix ans les mots citoyen ou citoyenne évoquaient les images chocs de films plus ou moins désuets sur la Révolution française ou l’épopée napoléonienne — comme ceux de Sacha Guitry ou d’Abel Gance —, ou sur Danton, que les cinéastes semblent avoir placé au hit parade des révolutionnaires les plus profitables au commerce de l’image (plus que Robespierre, Marat ou Babœuf en tout cas). De ces images nous retenions des tribuns haranguant les foules et ponctuant leurs discours de « citoyens ! », ou de gens se saluant (ou s’étripant) en se donnant du « citoyen-citoyenne ! » à qui mieux mieux, à tel point que le terme semblait devenu, à l’époque, équivalent à « monsieur » ou « madame ». Des clichés souvent infantiles, mais colorés de cocardes et d’écharpes bleu-blanc-rouge, comme dans les images d’Épinal reproduites dans les livres d’Histoire qu’ingurgitèrent des générations d’enfants de la laïque. La geste franchouillarde reprenait ainsi des couleurs grâce aux toutes nouvelles techniques de spectacle/communication dont le cinématographe et la photo couleur étaient alors les fleurons.
Parfois, le mot « citoyen » était utilisé, mais sans grande précision, pour signaler l’appartenance d’un « étranger » à la communauté nationale. Mais il s’agissait davantage d’une évocation juridique équivalente à « nationalité », sans grande épaisseur symbolique. Il y eut bien, après la Seconde guerre mondiale, le mouvement des « citoyens du monde » de Gary Davis, qui enflamma, pour un temps, les grandes salles encore consacrées aux grands meetings populaires. Mais cela fit long feu.
Et puis, sans qu’on y prenne vraiment garde, de manière insidieuse mais assez rapide quand même, le mot est revenu au galop, chargé de significations moins administratives et plus idéologiques, si bien qu’à présent, si on n’interpelle pas encore de cette manière son voisin ou une amie, on ne lui donne plus guère du « camarade ! ». En quelques années, la « citoyenneté » est devenue un des mots clés des lieux communs qu’accompagnent le « prêt-à-penser » et le « politiquement correct » inaugurés par la « génération Mitterrand » et dont la droite se régale à son tour. Jusqu’à la nausée ! Au nom de la modernité on revient ainsi plus de deux siècles en arrière. Pas pour le meilleur mais pour le pire ! Vidée de la dimension rupturiste (celle qui souligne les fractures dans la société) qu’elle avait pu avoir en partie à la fin du XVIIIe siècle, il ne reste plus de la citoyenneté que sa face intégratrice (celle qui veut réunifier le corps social en une unité de façade). C’est que Furet, Fukuyama, Ferry et d’autres encore sont passés par là et qu’il est maintenant admis par toute l’intelligentsia qu’une révolution ne peut être que totalitaire et que, par conséquent, la rupture est un non-sens à combattre et l’intégration la voie à suivre. Le terrain était, depuis quelques années déjà, d’autant plus propice à ces âneries que défunt Mai 68 ne présentait plus, lui non plus, que sa face intégratrice, via quelques ex-mao qui s’en étaient indûment emparés, accompagnant des revendications féministes, écologistes et culturelles du même acabit.
Ce retour de la citoyenneté n’était pas une simple toquade linguistique. C’était un retour chargé d’une fonction politique et culturelle bien précise : combattre ce qui, dans la société française, infirmait les crétineries ci-dessus évoquées et risquait de laisser entrevoir que consensus et intégration étaient du pipeau.
Ce furent les émigrés de la deuxième ou troisième génération dont le PS recycla l’ardeur dans SOS-racisme ; ce furent les chômeurs et les chômeuses qui trouvèrent dans AC ! une orientation leur laissant espérer une considération citoyenne ; ce fut enfin le secteur public qui, en 1995, mit dans la rue des pans entiers de la population salariée avides de respirer un peu d’air frais après plus de dix années d’asphyxie mitterrandienne.
Tout cela faisait tache, il fallait trouver la pâte qui pouvait ressouder ces potentielles dissidences afin de les éloigner de toute tentation anti-consensuelle. La citoyenneté est venue, et avec elle tous les dispositifs intégrateurs mis en place sous Mitterrand et devenus enfin opérationnels sous la droite. Une fois de plus la gauche avait rempli son rôle de chien de garde fournisseur et fourbisseur des armes de basse manœuvre.
UNE SEULE APPARTENANCE : LA NATION !
La République française s’est construite puis consolidée sur la destruction des anciennes appartenances : aux régions et aux pays, avec leurs langues et leurs cultures ; aux corporations et aux métiers ; au village et à la grande famille élargie. Mais l’être humain est ainsi fait qu’il ne peut survivre sans appartenances — en général multiples et variées — et certaines d’entre elles, à certaines époques, sont plus importantes que d’autres. Les mouvements de l’Histoire ont beau en détruire un grand nombre, d’autres se recréent immanquablement sur le terrain des précédentes, telle l’Hydre de Lerne.45
Il est un sentiment d’appartenance qui a toujours existé, mais qui a pris du volume pendant toute la période d’industrialisation et de développement du mouvement ouvrier et qui correspond à la place de l’individu dans le processus de production : l’appartenance de classe.
Le citoyennisme, né avec l’État moderne, a précisément œuvré pour substituer aux anciennes appartenances dont nous parlions un sentiment de fusion avec la communauté étatique, plutôt qu’une appartenance de classe ; il a tenté de donner à l’identification à l’État une consistance et une réalité souvent très faibles sous l’ancien régime, puis mises à mal par la sauvagerie de l’industrialisation et l’acculturation brutale subie par des millions de prolétaires. Il est fils de la IIIe République et de ses hussards. Mais là où les instituteurs offraient, malgré tout, un contenu, des connaissances (certes souvent critiquables et propagandistes) et parfois des éléments de contestation, le citoyennisme moderne n’offre rien que la perpétuation de l’ordre existant dans un monde qui, par ailleurs, change et prend l’eau de toute part.
Dès lors, l’individu-citoyen n’est plus défini par sa place dans la production et dans un espace géographique fini et connu de lui (le village, le “pays”, la région), mais par sa position dans un champ plus vaste, plus abstrait, dans une communauté fictive qu’il ne côtoie pas, avec laquelle il n’a aucune activité collective, qui n’a d’existence que fantasmatique et virtuelle et ne s’extériorise que dans les hola pour soutenir les équipes de France, dans quelques pitreries télévisuelles qui meublent les conversations bistrotières ou, pire encore, en cas de guerre.
Pour développer ce genre d’appartenance décérébrante, l’État a besoin de gommer celles, plus réelles et vivantes, qui développent le collectif et la solidarité, comme la place dans le processus de production, l’appartenance de classe.
Car pour le citoyen, la nation passe avant tout.
Lorsque, en 1789, l’abbé Sieyès dans son fameux Qu’est-ce que la propriété ?46, résume le fondement du nouveau régime par cette phrase : « La nation existe avant tout, elle est l’origine de tout... elle est la loi elle-même... », il indique clairement les limites exactes du changement opéré : un changement de pouvoir. Le roi disparaît, la nation naît. Pour tous les pouvoirs, le peuple, dans ses diversités, représente un danger. Il faut donc que ces diversités se transcendent en une unité. Ce fut le roi, garant de cette unité et unité lui-même, c’est maintenant la nation qui confère, en retour, l’existence même du peuple intronisé ensemble de citoyens.
Et du coup, à l’inverse, comme dans l’Antiquité, les non-citoyens sont pratiquement des sous-êtres humains (dans le monde moderne, les « en-dehors », les classes dangereuses, les révolutionnaires, les « marginaux », etc.). Et finalement, la réhabilitation du citoyennisme aboutira, malgré toutes les bonnes intentions, à la criminalisation de toutes celles et de tous ceux qui contestent et se situent hors du jeu institutionnel ayant pour cadre la nation.
CITOYEN PAR-CI... CITOYEN PAR-LÀ
Dans un paragraphe intitulé « Citoyenneté et lutte de classe » (brochure 1793 : Citoyenneté et révolution, Alternative libertaire, sans date), Laurent Esquerre écrivait récemment : « Le débat sur la citoyenneté a pris ces dernières années une tournure tout à fait spécieuse [...] Même dans son expression la plus radicale, elle contribue à masquer les enjeux de classe et la nécessaire remise en cause des rapports de production. »
On ne saurait être plus clair. On s’aperçoit pourtant que le mot revient comme un leitmotiv obligé, même sous les plumes les plus critiques : une énorme quantité d’articles, écrits par des gens théoriquement en accord avec les constatations qui précèdent, utilisent malgré tout le terme de citoyen, sacrifiant ainsi à une sorte de mode. S’agit-il seulement d’une difficulté à préciser les concepts, d’un manque de mots, d’une croyance que dans ces cas-là il est utilisé avec un autre sens (mais est-il compris autrement ?), d’une figure de style destinée à être comprise plus largement par un milieu trop sensible aux modes linguistiques dominantes intronisées par le « politiquement correct » des médias et de l’intelligentsia ?47 Je ne crois pas.
En effet, ce citoyennisme (dans sa version simplement démocratique comme dans sa version supposée plus radicale), qui colore plus que largement les mouvements antimondialisation, pour les droits de l’homme, contre le chômage, etc., qui envahit les radios et les journaux, qui est devenu le prêt-à-penser des élites françaises, n’est pas une simple idéologie qu’il faudrait critiquer. Il n’est pas une simple opinion qu’il s’agirait de confronter aux nôtres (ou à d’autres) en peaufinant nos arguments (comme si la justesse d’un argument ou d’une critique avait jamais, à elle seule, convaincu qui que ce soit !).
Non, le citoyennisme est bel et bien une réalité matérielle qui, comme force sociale, joue un rôle très précis dans le redéploiement capitaliste actuel. Le citoyennisme n’est pas une simple opinion éthérée qui se promène dans les nuages de la spéculation intellectuelle et que l’on chope d’un habile coup de patte quand elle passe à notre portée (ou que l’on rejette d’un revers de la main), au gré de discussions plus ou moins philosophiques. Il s’incarne, au contraire très matériellement dans des institutions, des partis, des syndicats, dans des médias, dans des « représentants », dans des corps intermédiaires, qui sont à la bonne place et au bon moment dans le contexte actuel de la lutte des classes qui est celui d’une formidable offensive de la bourgeoisie.
Il faut donc critiquer et combattre le citoyennisme pour ce qu’il est présentement, et non en référence à ce qu’il est supposé (souvent à tort) avoir été. S’y référer n’est pas une simple « erreur » commise par des « gens proches » ni une tromperie/trahison exercée par des réformistes masqués ou des néostaliniens, c’est affaiblir la portée critique de tous les mouvements de résistance à l’offensive capitaliste.
FILIATION RÉPUBLICAINE
DU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
Mais pourquoi donc cette bataille, pourtant évidente à mener aux yeux de beaucoup, est-elle si difficile à engager sans retomber dans la toile tissée par ce citoyennisme gobe-mouches ?
Plusieurs raisons à cela :
— crainte de se couper des « gens » et des « mouvements », peur d’être marginalisé, de paraître élitiste et donneur de leçon ? Effectivement, critiquer quelque chose qui fait consensus dans la société, y compris parmi des gens parfois proches sur d’autres terrains, n’est pas une position confortable. La tentation est alors forte de faire profil bas, de tergiverser autour des mots en leur attribuant des sens un peu différents, mais imaginaires ;
— désir d’exister, de reconnaissance... sociale et institutionnelle (ce qui est à rapprocher de certaines tentatives actuelles de faire de l’anarchisme un courant de pensée honorable sinon honoré). Fatigués d’avoir bataillé sur les marges pendant des années, il en est qui veulent terminer — ou simplement poursuivre — leur carrière militante en étant un tant soit peu reconnus au-delà de leur sphère habituelle. Faire « sérieux », « responsable », « construire du solide », « laisser de côté les critiques stériles », se débarrasser du « purisme idéologique » comme du « radicalisme sans perspectives » sont des clichés souvent entendus et avec lesquels on ne peut être en désaccord. Mais en restant à l’état de cliché cette volonté cache parfois un repli frileux et un alignement insidieux sur un conformisme néo social-démocrate relooké qui, au moyen d’une pensée schizophrène, frise une sorte de néo-poujadisme anti-intellectuel.
Cependant, pour réelles qu’elles soient, ces explications ne peuvent fonctionner que parce qu’elles sont liées à une autre cause, plus profonde, et ancrée dans l’histoire du mouvement révolutionnaire en général et anarchiste en particulier : la persistance en son sein d’un certain républicanisme.
Nombre des gens utilisant ce terme de citoyen en pensant égalité des droits entretiennent la fiction selon laquelle l’égalité peut exister dans une société patriarcale et de classe. Il ne s’agit là nullement de chipotage mais bien d’une position fondamentale au sujet de laquelle il convient de se positionner clairement. Car si réellement, en système marchand, capitaliste, en régime de propriété, il pouvait y avoir égalité de fait (et non des droits et des chances), il n’y aurait guère à hésiter à entrer au PS.
L’HÉRITAGE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
DANS LE MOUVEMENT ANARCHISTE
« En tout cas, ce qu’on apprend aujourd’hui en étudiant la grande Révolution, c’est qu’elle fut la source de toutes les conceptions communistes, anarchistes et socialistes de notre époque... L’Humanité marche d’étape en étape, et ses étapes sont marquées depuis plusieurs centaines d’années par de grandes révolutions... » Kropotkine, La Grande Révolution, pp. 408-409, Ed. du Monde libertaire, 1989).
Lors des prémisses des mouvements socialiste et ouvrier, qui émergent progressivement au cours du XIXe siècle (1830, 1848, 1871...), la Révolution française est encore présente dans les mémoires (un père, des grands-parents, une arrière-grand’mère, l’épopée des saignées napoléoniennes qui est racontée au coin du feu comme le sera la guerre de 14 jusque dans les années 60). On a connu l’Empire, puis la Restauration. La République n’est justement plus qu’un souvenir jusqu’en 1848. Elle disparaît de nouveau en 1852 pour ne s’installer plus durablement qu’après la capitulation de Sedan, en 1970.
L’idée socialiste se construit sur l’intuition, simple et complexe à la fois, qu’il faut poursuivre la « Grande Révolution ». Cette dernière, qui a été confisquée, balayée puis vaincue, n’est pas morte, elle anime encore l’idéal des courants se réclamant de la justice et de la liberté. Simple, car c’est une vision un peu mythique et édulcorée qui demeure, qui tend à oublier la Terreur aussi bien que les courants « communistes ». Complexe tout de même, car derrière cette idée de continuation, pointe la prise en considération de la nécessité d’utiliser d’autres méthodes (apparition des analyses « marxistes » et de s’appuyer sur de nouvelles couches sociales, dans un monde dont la bourgeoisie s’est totalement emparée en quelques décennies.
Mais très vite apparaissent des déchirures et des contradictions flagrantes entre la République réelle, celle qui s’installe en 1848, et ce qu’elle est supposée idéalement être. Puis, de la même manière, après 1870. De ce décalage naissent des conceptions plus radicales, révolutionnaires, communistes et anarchistes.
L’anarchisme révolutionnaire en arrive à la conclusion d’un rejet radical de toute forme de pouvoir politique séparé du corps social, de toute forme de gouvernement et d’institutions étatiques. Pourtant, et c’est là une contradiction d’importance, il continue à se référer plus ou moins explicitement à la République (même si c’est une République idéale) et ne parvient souvent pas à se séparer de la tradition politique républicaine, certaines de ses composantes gardant même des liens plus ou moins forts et explicites avec la démocratie républicaine (les franc-maçons, les éducationnistes comme Robin et son orphelinat de Cempuis, etc.).48
Il ne faut pas oublier que l’anarchiste républicain Proudhon fut député de la Seine. Selon lui, la république est avant tout un principe opposé à la royauté et sans grande traduction institutionnelle. De là il considère qu’en cas de menace, elle est à défendre comme on défend un principe. Après 1848, il se pose en véritable soutien des institutions républicaines (la Constitution de 1848 qu’il qualifiait peu avant de « chiffon de papier ») attaquées par les légitimistes, les orléanistes et autres bonapartistes. L’ancien pourfendeur du suffrage universel en devient un farouche partisan dès lors que ces institutions sont menacées. Cette position est expliquée par le désir de préserver les chances de la révolution, ce qui sous-entend que, dans cette conception, le principe républicain devient une étape obligée de la révolution sociale (et l’on retrouve là, encore une fois, ce vieux principe idéaliste qui veut que le sens de l’Histoire accorde une place de plus en plus importante au bien au détriment du mal).
Cependant, on a oublié trop souvent que ce n’est pas la Révolution française dans sa globalité qui a servi de référence et fut à l’origine des mouvements socialistes et révolutionnaires apparus dans les deux siècles suivants, mais les réactions (surtout babouvistes) nées de la constatation que, cinq années après 1789, la révolution n’avait fait qu’installer aux manettes une nouvelle classe dirigeante (supposée être celle du mérite, du travail, donc de l’argent) à la place de l’ancienne, basée sur la tradition et la richesse foncière. C’est bien cette réaction qui introduit l’idée de la suppression radicale de la propriété privée, alors que jusque-là elle était à peine évoquée. Les Enragés eux-mêmes, pourtant si souvent vantés dans les milieux ultraradicaux, n’ont jamais revendiqué l’abolition de la propriété privée mais au contraire son extension à tous les citoyens, y compris les plus pauvres.
LA DÉFENSE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
PAR LE BIAIS DU CITOYENNISME
Les « citoyennistes » de jadis avaient parfaitement compris la charge subversive contenue dans la critique de la propriété privée. Un exemple éclairant nous vient des États-Unis. La déclaration d’indépendance de juillet 1776 précise : « Tous les hommes naissent libres et égaux et sont gratifiés par le Créateur de certains droits inaliénables dont font partie la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Deux ans après, la Constitution américaine remplace « la recherche du bonheur » par... « le droit à la propriété » !
Prise dans son ensemble, la Révolution française est totalement ambiguë vis-à-vis de la propriété. Chacun, ensuite, pourra s’y référer avec des positions très différentes sur cette question.
Mais ce qui est clair, c’est que nos citoyennistes d’aujourd’hui sont plus robespierristes que babouvistes. Comme Robespierre, ils considèrent que l’égalité totale est une chimère qui exigerait le communisme, un état impossible à établir. Comme lui, ils sont attachés à la propriété privée, mais avec l’objectif que ne se forment pas de grandes fortunes volant les pauvres. Et pour y parvenir, tout est affaire de lois destinées à limiter les inégalités. On constate là une parfaite identité de vues entre Robespierre et Attac par exemple. Dans un cas comme dans l’autre, il y a le même aveuglement sur ce qui découle nécessairement d’un système basé sur la propriété privée des moyens de production et de survie. Et surtout, la croyance que le Droit peut échapper au rapport de forces entre les classes sociales.
Même si ce sont surtout les courants qui tentèrent de s’opposer à la confiscation de la Révolution française par la bourgeoisie qui inspirèrent le mouvement ouvrier, les liens avec la révolution prise comme un tout réapparaissaient fortement chaque fois qu’une menace, réelle ou imaginaire, d’un retour à la monarchie se manifestait (la position de Proudhon est donc loin d’être particulière). Liens apparaissant d’autant plus légitimes que ces menaces sont omniprésentes, et qu’ainsi même la fraction la plus révolutionnaire du mouvement anarchiste se range en partie derrière la République lorsqu’elle est jugée menacée.49 Et le choix qu’il importerait de faire entre plusieurs régimes politiques simplement parce que l’un serait moins pire que l’autre, et non meilleur, entraînera bien des divisions, des incompréhensions, et des invectives... jusque de nos jours.
De l’idée de défense de la République naîtra, dans le mouvement ouvrier syndical, celle de la défense des acquis. Et là, comme sur le plan politique, se pose cette contradiction : comment ne pas se ranger derrière une bannière qu’on est supposé combattre ? Ce à quoi on peut répondre : si on défend ce qu’on est supposé combattre c’est que c’est une partie de soi que l’on défend.
Si c’est la menace de rétablissement de la royauté qui a servi d’alibi aux réflexes républicains des révolutionnaires (de toutes tendances), c’est, depuis la Seconde Guerre mondiale, le fascisme qui remplit cette fonction. Et, comme de bien entendu, ces alibis sont des formes de domination datés historiquement, et dont l’évocation rituelle et incessante ne fait que masquer les nouvelles formes de domination qui se mettent en place sous nos yeux.
Or, il me semble que le problème n’est pas celui du choix... qui, finalement, est la plupart du temps assez simple (toute personne normalement constituée préfère vivre dans un régime de merde mou que dans un régime de merde dur), mais celui de l’analyse qui est faite (ou pas faite, le plus souvent) des raisons qui font que tel régime est moins dictatorial qu’un autre. Si l’on en revenait à cette idée qu’un régime politique est d’abord le reflet de l’état du rapport des forces entre les classes, on s’épargnerait bien des tracas (comme celui de se poser la question de savoir si le recours au vote peut empêcher une dictature de s’installer).
Mais ce type d’analyse est trop souvent apparu dans une partie du mouvement anarchiste comme trop marxiste.
La critique faite par Bakounine à la Révolution française, c’est de n’avoir pas abordé la question de la transformation sociale et économique (lieu des inégalités réelles) pour s’en tenir à la transformation politique (lieu d’inégalités fictives). Ou en tout cas de n’avoir pas fait correctement le lien entre les deux. Le républicanisme est essentiellement une notion politique (dans le sens étroit du terme (institutionnel), et qui par conséquent ne s’attache à l’individu que sous son aspect d’appartenance à une supposée collectivité, c’est-à-dire comme citoyen considéré sous son aspect de devoirs et de droits donc lié à une structure étatique faite de lois. L’égalité (ou supposée telle), dans ce cas, n’est que politique et nullement matérielle. La propriété, par exemple, racine des inégalités n’est pas remise en question. Et c’est bien là que naît la grande rupture entre les libéraux et les communistes.
LES DROITS DE L’HOMME
COMME SENS DE LECTURE À L’HISTOIRE
Le citoyennisme est inséparable de la notion de Droits de l’Homme. Essayons de comprendre quelle lecture en fut généralement faite par ses inventeurs ou ses laudateurs.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 affirmait :
« Art. 35 : Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
« Art. 34 : Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé, il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. »
Ce que le législateur de 1793 entrevoyait là et tentait d’esquisser dans ce texte, ce sont les conflits inévitables qui jaillissent entre le pouvoir institué sous forme d’État et la société qu’on appellerait maintenant « civile ». Il s’agit même d’une première approche du caractère antagoniste des classes sociales, avant que les socialistes du XIXe siècle n’en précisent les contours. Dire que lorsqu’il y a oppression contre une seule personne le corps social entier est opprimé, est un aveu sans limites de l’oppression continue que subit ce même corps social. Quelle société peut, en effet, affirmer qu’aucun de ses membres ne l’est, pas même un ? Aucune ! Cet article de 1793 est bien une reconnaissance implicite de l’opposition irréductible entre le gouvernement, l’État et le peuple. On comprend mieux, dès lors, que la bourgeoisie, une fois son pouvoir solidement établi, n’ait eu de cesse de gommer cette référence, non seulement dans les textes, mais aussi dans les têtes, pour conjurer le danger potentiel que représente pour elle l’idée que la légitimation de la révolte ne provient pas d’une loi établie une fois pour toutes, mais de la conscience de chacun vis-à-vis de tous.
Cette notion du droit à la révolte et à l’insurrection contre l’oppression n’existait pas dans la première Constitution, celle de 1789, qui, soit dit en passant, est la plus pauvre, la plus édulcorée de toutes celles qui furent votées ou proposées au cours des dix années révolutionnaires. Et c’est bien entendu celle-ci qui sert de modèle et de référence de nos jours à la bourgeoisie.
Une notion qui disparaîtra ensuite dans la Constitution de 1795, entérinant ainsi le triomphe de la réaction, le début de l’ère bonapartiste, une fois repoussée la vague de révoltes populaires.
Il semble que ce spectre ait encore hanté le monde cent cinquante années après, puisque le législateur, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fait encore une fois référence à ce droit à la révolte et à l’insurrection, mais pour le conjurer, pour bien montrer que ce qui importe le plus c’est de l’empêcher de s’exercer. Ce qui dans l’esprit des législateurs de 1793, était un droit devient maintenant une contrainte, un suprême recours qu’il convient d’empêcher de s’exercer. Dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il est écrit : « Il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit, pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. »
Ce préambule indique donc clairement que l’opposition extra légale n’est pas possible dans un État de droit ; un régime précisément conçu pour empêcher toute opposition extra légale. Il est en effet (ce qui, soit dit en passant est contradictoire avec d’autres articles de la loi) à la fois juge et partie puisque c’est lui qui détermine le droit ou non à la révolte ; et l’accepter revient pour lui à se nier puisque son existence implique qu’il n’y a aucune justification à cette révolte.
Un autre exemple de ces « petits arrangements sémantiques », mais lourds de sens, est celui cité plus haut à propos de la Constitution américaine.
Les droits de l’homme sont devenus l’horizon de ceux qui renoncent à l’émancipation et à la libération. Il s’agit-là d’un projet très « petit bras » qui illustre à merveille la victoire du « moins pire » sur le « meilleur ». Un horizon de boutiquier aurait-on dit à une autre époque. Un horizon de vieillard offert à des enfants.
La lutte pour les droits de l’homme se présente comme un retour réaliste et tangible à une concrétude qui se donne comme objectifs des résultats immédiats contre des périls immédiats. Une lutte qui entend s’opposer à des utopies lointaines et inefficaces qui avaient marqué les périodes antérieures. Une lutte à la mesure de celles et ceux dont nous parlions plus haut, qui rêvent de reconnaissance, de calme mais sans volupté.
Car en fait il s’agit d’un projet totalement impuissant : on oublie que c’est justement au nom de l’efficacité immédiate, du « réalisme », du retour au concret face aux idéologies et aux utopies, du pragmatisme érigé en stratégie que se sont commis les plus grands crimes de l’Histoire et que les structures totalitaires se sont construites (le « bon sens » poujadiste ou lepéniste en est un exemple éclairant).
L’une des fonctions du droit-de-l’hommisme est de masquer les échecs successifs et historiques du réformisme (dont il fait partie), et de ne sélectionner dans l’Histoire que ce qui l’arrange et est finalement conforme à la vision officielle des choses (évolutionnisme). Même si le droit-de-l’hommiste admet que, ces derniers temps, les succès n’ont pas été éclatants sur ce terrain, il se retranche sur une vision plus large de l’Histoire, considérant que « ça va quand même dans le bon sens » et que revers et périodes de recul ne sont que des mini mouvements sur une pente globalement ascendante. Une régression, selon lui, ne saurait être que temporaire.
L’idéologie droit-de-l’hommiste et citoyenniste est inséparable de cette conception « progressiste » qui considère qu’il y a un sens de l’histoire qui, bon an mal an, va du simple au complexe, du mal vers le bien. Une vision que tout infirme à nos yeux !
Ce qui conduit ses adeptes à être toujours du côté de ce qui s’appuie sur le développement (durable ou non), sur un certain scientisme (même critique), sur une confiance dans la « nature de l’homme » (quelle est-elle ?), etc. Bref, ce sont des idéalistes réactionnaires dans le sens où ils défendent des conceptions et des modes de lecture du monde bien archaïques, sans surprise ni aucun risque, bien calés dans l’ordre établi et le conformisme d’une pensée agréée par tous les pouvoirs. De petits bourgeois, tout petits...
JPD (OCL Poitou)
Encart
Il est tout à fait étonnant de voir des gens se considérant comme plus ou moins internationalistes militer à Attac, dont le fondateur, Bernard Cassen n’est qu’un souverainiste, chevènementiste. C’est ce même Cassen qui, dès 1969, ferraillait contre les gauchistes à la nouvelle université expérimentale de Vincennes dont il fut l’un des fondateurs. En 1973, il rejoint Le Monde diplomatique, puis en 1981 entre au ministère de la Recherche et de la Technologie sous la férule de son grand ami Chevènement. Conseiller non officiel du Mouvement des citoyens, lors de la campagne électorale de 1994 il mettra la main à la poche pour aider son pote. C’est encore Cassen qui, en 2001, invitera Chevènement à se relooker politiquement au premier forum social de Porto Alegre. Un bide !
Il est également tout à fait étonnant de voir des militants se revendiquer de la démocratie et, en même temps, militer à Attac, sans doute l’un des mouvements les moins démocratiques de tout l’échiquier politique français.
C’est lors de l’assemblée générale de Saint-Brieuc, en novembre 2000, que cette constatation devint une évidence. L’année précédente, un conseil d’administration de 30 membres avait été élu pour trois ans et comportait... 18 membres fondateurs cooptés entre eux. La base présente à Saint-Brieuc suggéra qu’une commission de travail mette en chantier une « modification des statuts » afin d’« éviter une dérive oligarchique » et d’« améliorer la vie démocratique d’Attac ». Parfaitement contrôlée par les membres fondateurs, la commission décida qu’il n’était pas question de modifier les statuts et elle rédigea une charte des relations entre Attac et... les comités locaux ! Au tollé que suscita cet arrangement, Bernard Cassen riposta par les fameuses invectives : « C’est une perte de temps ! », « indiscutable volonté de nuire », « menées immatures », « dilatation des egos ». Mais de toutes les façons, les statuts d’Attac sont rédigés de telle manière qu’on ne peut les modifier !
Dans leurs activités, les quelque 300 comités locaux d’Attac n’engagent jamais la direction nationale. La conférence des « délégués » des comités (ils n’ont aucun mandat) qui se réunit de temps en temps n’a ni pouvoir ni statut et ne peut qu’enregistrer des décisions prises ailleurs. Toutes les tentatives de discuter les orientations et les choix d’Attac sont systématiquement écartées. Ce qui explique que lors des votes sur ces orientations on compte entre 80 et 90 % d’abstentions parmi les adhérents... ce qui permet à la direction de se prévaloir des 90 à 95 % de votes favorables à ses choix ! Comme l’écrit un groupe de « dissidents » d’Aix-en-Provence, « Le fonctionnement d’Attac manifeste la croyance que la démocratie est pesante et qu’il faut s’en remettre au pouvoir et à la clairvoyance d’un seul ou d’un groupe dirigeant auto-institué ». Et pourtant, les médias, habituellement si prompts à débusquer des pouvoirs occultes dans Lutte ouvrière, à en dénoncer les caractères antidémocratiques et de secte, ne pipent guère sur ce qui s’apparente, dans le cas d’Attac, à un fonctionnement stalinien. Preuve, s’il en était besoin, que ce qui gêne le plus nos démocrates ce n’est pas la dictature en elle-même mais la manière dont un régime ainsi caractérisé se détermine sur l’échiquier mondial. Noriega ça va, Castro c’est trop !
1 Voir sur ce sujet, et bien d’autres traités dans ce texte, Libération des femmes et projet libertaire, OCL, éditions Acratie, 1998.
2 Claire Démar, qui écrira notamment Appel au peuple sur l’affranchissement de la femme en 1833, avant de se suicider, refuse tout pacifisme, préconisant « des boulets dans leurs châteaux... des balles dans leur cervelle ».
3 Une députation de « vésuviennes » — jeunes ouvrières, vivandières ou ambulancières engagées après les Journées de février dans le bataillon militaire que dirige un certain M. Bome — se rend ainsi auprès de Lamartine afin d’obtenir l’ouverture d’un atelier de confection pour jeunes filles démunies dans la prison de Clichy. Ces « citoyennes patriotes » qui vivent en communauté à Belleville ont réalisé un manifeste : Les Vésuviennes, ou la Constitution politique des femmes pour une nouvelle société de Françaises, qui porte en exergue une citation de F. Tristan. Elles veulent l’indépendance des femmes, pas seulement l’égalité, et l’admissibilité à tous les emplois et au service militaire. Très mal vues, elles défendent pourtant la moralité, axant la sexualité sur la reproduction, et considérant tant le mariage obligatoire que le divorce exceptionnel. Originalité, si la femme doit avoir des enfants, l’homme doit se montrer un « bon mari » en accomplissant les tâches domestiques... sauf à être puni par un tribunal. (En 1870, les « amazones » de Félix Belly œuvreront, elles, « pour que les femmes puissent mériter leur émancipation et leur égalité civile ».)
4 De père saint-simonien, républicaine franc-maçonne qui sera communarde, elle créera en 1868 la Société fraternelle de l’ouvrière, organisation féministe et révolutionnaire, fondera divers clubs, et sera notamment membre du parti guesdiste.
5 Église, État et patronat poussent aussi au mariage — moyen, comme le livret de travail ouvrier, de stabiliser la classe ouvrière pour mieux la contrôler.
6 Ce mouvement a pour origine Paul Robin, fondateur en 1896 de la Ligue de régénération humaine, organisation de propagande anticonceptionnelle. Un journal intitulé Le Malthusien paraîtra à la même époque.
7 Aux législatives de 1910, déjà, une dizaine de candidates féministes se présentent ; mais les bulletins portant des noms de femmes (de 4% à 27% selon les circonscriptions) sont considérés nuls.
8 M. Pelletier a évolué entre les courants socialistes, communistes et anarchistes. En 1905, elle prend la tête du groupe la Solidarité des femmes, où C. Kauffmann a succédé à E. Potonié-Pierre. Alors militante guesdiste, elle fait adopter la motion (à 6 voix près) sur le vote des femmes au congrès socialiste de Limoges en 1906... dans une salle qui s’est vidée aux trois quarts juste avant. Elle fonde La Suffragiste en 1907, mais se trouve en décalage avec les membres de ce groupe — selon elle des rentières et bourgeoises mariées qui refusent même de se réunir le soir par crainte de quitter leur domicile. Lorsque les guesdistes veulent assujettir les syndicats aux partis, elle rejoint le courant hervéiste. Gustave Hervé, exclu de l’enseignement pour son antimilitarisme et son antipatriotisme, a créé La Guerre sociale, un hebdomadaire qui attire syndicalistes et anarchistes en marge de la SFIO. M. Pelletier y rencontre des néomalthusien-ne-s. Les méthodes d’action directe des suffragettes anglaises lui plaisent (comme à C. Kauffmann, qui a fondé la Ligue féminine pour l’éducation physique, et mène des actions contre le Code civil : ainsi, à l’occasion de son centenaire, tandis que se déroule un « dîner de contestation » regroupant un millier de femmes, elle organise une manifestation avec autodafé de cet ouvrage). M. Pelletier aspire à la grève générale et à l’insurrection : elle cassera un carreau dans un bureau de vote le 10 mai 1908, accomplissant le second et dernier acte violent de toute la lutte des suffragistes en France (le premier ayant été le renversement d’une urne électorale par H. Auclert, une semaine plus tôt).
9 Une partie du mouvement philanthropique s’est néanmoins rapprochée du monde du travail et de politique pour s’attaquer aux excès du capitalisme industriel, à travers les settlement houses de J. Addams (prix Nobel de la Paix en 1931... et également adepte des dîners avec le Président Wilson) : de 1895 à 1915, des milliers de « féministe sociales » s’apercevant que les bonnes œuvres et la philanthropie ne suffisent pas à résoudre les problèmes de société, ont fait le lien avec syndicalisme, pacifisme ou défense des consommateurs.
10 Mouvements religieux dont le premier pense recevoir directement l’inspiration de l’Esprit-Saint et conteste le dogmatisme de l’Église anglicane au profit d’un sacerdoce universel étendu aux femmes, et le second nie le dogme de la trinité.
11 Christine Delphy, Penser le genre. L’ennemi principal. Tome 2, éd° Syllepse, 2001 — note de lecture de Françoise Armengaud, NQF Nouvelles Questions Féministes, vol 21, n°1/2002.
12 Partisans, nov. 1970 — cité dans « Histoire du féminisme français », tome 2, Maïté Albistur, Daniel Armogathe, Ed° des femmes, 1978.
13 Les femmes sujets d’histoire, à la mémoire de Marie-France Brive, collection Féminin & Masculin, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, déc. 1999.
12 Partisans, nov. 1970 — cité dans « Histoire du féminisme français », tome 2, Maïté Albistur, Daniel Armogathe, Ed° des femmes, 1978.
13 Les femmes sujets d’histoire, à la mémoire de Marie-France Brive, collection Féminin & Masculin, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, déc. 1999.
14 Histoire du féminisme français, tome 2, p. 654, op. cit
15 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe,, 1949, Ed’ Gallimard
16 Elisabeth Badinter, extrait du livre « Fausse route », dans la critique de Josyane Savigneau, Le Monde, 27/28 avril 2003.
17 Joan W. Scott, 1998. La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme. Albin Michel, Paris ; cité dans NQF ( Nouvelles questions féministes), vol 21, n°1/2002.
18 Geneviève Fraysse, La controverse des sexes, Essai, 2001, puf, Quadrige, Paris.
19 Genèse de la démocratie représentative en France, - Les femmes sujets d’histoire, op. cit.
20 Genèse de la démocratie représentative en France, — Les femmes sujets d’histoire, op. cit.
21 Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade ? 1972, Gallimard, Paris.
22 Gisèle Halimi, Parité, je n’écris pas ton nom, - Femmes Rebelles, Manière de Voir, avril/mai 2003
23 Martine Bulard, Des conquêtes inachevées, Femmes Rebelles, op. cit.
24 Mariette Sineau, L’élitisme politique n’est pas mort, Femmes Rebelles, op. cit.
25 Pierre Bourdieu, La domination masculine, Ed Seuil, 1998.
26 Source Eurostat, juin 2002, Femmes Rebelles, op. cit.
27 Alice Schwarzer, La Grande Différence, 2001, Femmes Rebelles, op. cit.
28 Clarisse Fabre, Bilan mitigé de la loi sur la parité, - Le Monde 27/28 avril 2003.
29 Alice Schwarzer, op. cit..
30 Les femmes sujets d’histoire, op. cit.
31 Histoire du féminisme français, tome 2, op. cit.
32 Françoise Collin, Ruptures. Résistance. Utopie. - NQF, Nouvelles questions féministes, vol 22, n°1/2003
33 Françoise Collin, op. cit.
34 Manière de Voir, p.41., Femmes Rebelles, op. cit.
35 C. Delphy citée par Françoise Armengaud, NQF, vol 21, n°1/2002, op. cit.
36 Ochy Curiel, La lutte politique des femmes face aux nouvelles formes de racisme. Février 2002, traduit de l’espagnol par Jules Falquet, NQF, vol 21, n°3/2002.
37 Ce fut (et c’est encore) le parcours du combattant pour l’immigré vivant seul dans une chambre désirant obtenir un logement social pour X personnes alors que celles-ci sont encore dans le pays d’origine. Il est toujours bon de rappeler qu’un étranger ou une étrangère régulièrement résident en France désirant faire venir sa famille (conjoint et enfants mineurs) est soumis pour ce faire à des conditions draconiennes : logement décent (difficilement attribué par les organismes logeurs !) dont la surface dûment contrôlée doit respecter des normes suivant le nombre de personnes désirant y vivre ; salaire dépassant sur un an le SMIC x 12 et contrat de travail permettant au demandeur d’espérer toucher cette rémunération dans l’année qui va suivre sa demande de regroupement familial ou, pour les titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, 3 fiches de paie consécutives au moins égales au SMIC. A noter que cette procédure dite de regroupement familial dure de 3 à 6 mois et qu’à tout moment l’administration peut vérifier si le demandeur a toujours le même emploi ; tout changement d’employeur retardant la procédure, tout chômage la remettant en cause... Dans les prochains mois, il devrait y avoir uniformisation au niveau de l’Europe des procédures de regroupement familial et celle qui existe actuellement en France est loin d’être la plus dure. On peut donc s’attendre à d’autres conditions que celles énoncées plus haut...
38 « J’y suis, j’y reste ! Les luttes de l’immigration en France depuis les années soixante » Éditions Reflex, 2000.
39 Des membres de l’Égrégore de Reims, association du groupe O.C.L. de Reims, acceptée comme étant une association politique de solidarité menant depuis Convergence 84 un travail de terrain qui s’est concrétisé par la constitution d’une permanence juridique ( Solidarité Migrants) sur cette ville (et qui existe toujours...), ont participé à tout ce processus dont des bilans ont été publiés dans différents numéros de Courant Alternatif (de 84 à 88)
40 Jean-Claude Michéa, L’enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes, Climats, 1999.
41 Il existe d’ailleurs un marché de la formation des délégués, disputé par de nombreuses associations de l’éducation populaire qui trouvent là des sources non négligeables de revenus.
42 En 1993, 25% des 18-24 ans n’étaient pas inscrits sur les listes électorales, et l’abstention des 18-25 ans a fait l’émoi des chroniqueurs politiques le 21 avril 2002...
43 Éditions l’ALBATROZ, B.P. 404, 75969 Paris cedex 20. Prix 12 ?, ouvrage disponible en librairie ou sur commande. Ce livre a largement contribué au présent article.
44 Lire à ce propos l’article de Nicolas du cercle social publié dans la revue La Griffe N° 21-2, Automne 2001. La griffe, c/o librairie la Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon.
45 A signaler que, au moment où elles commencent à fonctionner, ces nouvelles appartenances sont rarement prises en compte ni même aperçues. C’est ce qui fait dire aujourd’hui, et beaucoup trop rapidement, qu’à présent le monde s’uniformise. C’est à la fois vrai et faux. Vrai car à l’évidence d’antiques “différences”, d’ancestrales particularités disparaissent sous nos yeux sous les coups de boutoir du développement capitaliste (appelé globalisation en novlangue militante). Faux parce que de nouvelles “différences” se créent, des néoparticularismes apparaissent, simplement parce que c’est vital pour les êtres humains, mais soit on ne les a pas encore remarquées, soit on les minimise.
46 Ne serait-ce pas plutôt : Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Il faut rendre à Sieyès ce qui est à Sieyès, et à Proudhon, ce qui est à Proudhon... (L’Idée Noire).
47 De droite comme de gauche, il n’y a vraiment plus lieu de les distinguer.
48 Les éducationnistes considèrent que l’évolution doit précéder la révolution, et que c’est par l’éducation libertaire que l’on parviendra à former des individus aptes à faire cette révolution et à empêcher qu’elle soit stérile. Il semble qu’il y ait dans cette vision un manque singulier de « dialectique », en ce sens qu’un processus révolutionnaire est en lui-même un acte éducatif et que l’on apprend autant en quelques jours de barricades que dans une école libertaire. Paul Robin se vit confier par le collaborateur de Jules Ferry, Ferdinand Buisson, la gestion d’un orphelinat à Cempuis où, pendant quatorze ans il appliqua des principes d’éducation libertaire avant d’être révoqué par Georges Leygue un ministre de l’éducation nationale qui fut ensuite nommé aux Colonies, à la Guerre et à la Marine !
49 Les appels de “révolutionnaires” à voter Chirac en avril 2002 n’ont pas d’autres sens.
P.-S.
Scan et corrections : L’Idée Noire, 3/12/06
titre documents joints
-
info document (PDF - 860.3 kio)
téléchargez ce n° au format pdf allégé (sans illustration !)
