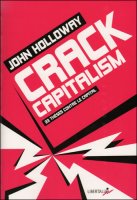
La révolution contre le travail
Entretien avec John Holloway
lundi 1er octobre 2012, par
Autour de son livre Crack Capitalism, 33 thèses contre le capital (éditions Libertalia)
Introduction
Beaucoup de choses peuvent être dites sur les livres de John Holloway. Mais s’il y a un chose dont on peut être sûr à leur propos, c’est qu’ils font parler. Et s’il est vrai que ses œuvres sont publiées depuis déjà un certain temps (depuis les années 70 en anglais et à partir des années 80, également en espagnol et en plusieurs autres langues), il est tout aussi vrai que deux de ses derniers travaux, Changer le monde sans prendre le pouvoir et Crack Capitalism, ont généré des débats passionnés.
Ceux qui ont eu l’occasion d’établir un contact direct avec Holloway ou de participer à la cuisine de son écriture (comme c’est le cas, par exemple, d’un séminaire intensif de troisième cycle tenu à l’Université de Rosario où a été discuté une version préliminaire du Changer le monde…), nous pouvons affirmer que cet auteur est parfaitement à l’aise avec le débat et la critique. Loin de chercher à créer une école (ou fonder une église), pour Holloway, l’essentiel est le faire : faire qui n’implique pas institution mais mouvement, faire qui implique révolution du donné, génération d’une autre réalité possible, faire qui implique le dialogue. Un faire ensemble à partir de la discussion, par exemple, de son travail.
Beaucoup des dialogues initiés à partir Changer le monde… ont trouvé un écho dans Crack Capitalism. Dans ce dernier, nous pouvons trouver des réponses aux questions qui se posaient dans différents domaines du texte précédent. Mais malgré cela, il serait erroné de considérer que cette dernière production vient combler les lacunes ouvertes en 2002 et constituerait un ensemble complet et fini. Au contraire, fidèle à son titre, Crack [fissure, brèche] ouvre de nouveaux fronts de débat, conduit à de nouveaux interstices. Ce sont ces interstices qui sont à l’origine des questions composant l’entretien que nous avons eu avec Holloway, en décembre 2011, et que nous reproduisons ci-dessous.
Marcela Zangaro et Rodrigo Pascual (Buenos Aires)
Interview
Dans Changer le monde sans prendre le pouvoir vous posez le problème de la révolution en dehors d’une vision étatiste et partez de l’affirmation selon laquelle pour faire la révolution il ne faut pas prendre le pouvoir d’Etat. Dans ce nouveau livre, Crack Capitalism, vous placez l’axe dans la critique du travail abstrait et de la nécessité de lutter contre lui pour faire la révolution. Quel est l’apport, selon vous, que réalise la critique du concept de travail abstrait à la compréhension de la révolution ?
Je vois le nouveau livre comme une tentative de revenir sur les questions laissées en suspens dans Changer le monde…, qui dit que nous devons changer le monde sans prendre le pouvoir, mais se conclut en disant que nous ne savons pas comment. Ainsi, le nouveau livre tente de donner une réponse en disant que nous devons fissurer le capitalisme, nous devons ouvrir des brèches dans la domination. Quand j’ai enquêté sur ces brèches, j’ai alors commencé à voir leurs réalisations et leurs difficultés, et de cette manière, j’en suis venu au double caractère du travail, c’est-à-dire le travail comme travail abstrait et comme travail concret.
Je pense que, pour moi, l’important n’est pas tant la question du travail abstrait, mais plutôt le double caractère du travail. En effet, surtout ces dernières années, il y a eu de nombreuses contributions qui mettent l’accent sur la question du travail abstrait mais en ignorant l’autre côté, le travail concret, c’est à dire celui du faire humain qui n’est pas nécessairement contenu dans l’abstraction du travail.
Ce que je veux faire dans Crack Capitalism, c’est ouvrir la catégorie du travail, voir comment, en son sein, il existe une relation antagoniste entre le travail abstrait et le travail concret. Cette relation antagoniste n’est pas seulement un lien de subordination, mais aussi et en même temps, une relation de résistance et de révolte. Tout le temps faisons l’expérience de l’antagonisme entre travail concret et travail abstrait. D’un côté, nous l’expérimentons comme travail imposé, étranger à nous-mêmes, et, d’autre part, comme l’envie de faire des choses que nous pensons utiles, nécessaires, dont nous considérons qu’il vaut la peine de les faire.
En quoi se différencient Changer le monde… et Crack Capitalism ?
Je vais indiquer trois éléments qui, je pense, font que ce dernier livre est différent de Changer le monde… En premier lieu, le contact avec de nombreux groupes et personnes. C’était très agréable cette occasion de discuter un peu partout des idées qui y étaient exprimées, pas seulement dans les universités mais aussi avec de nombreux groupes autonomistes ou des groupes qui tentent de trouver d’autres façons de faire de la politique. Je crois que c’est pour cela que j’ai réfléchi à l’importance qu’a cette idée des brèches.
Ces groupes sont en train d’implanter dans la domination du capital des fissures qui sont non seulement des résistances mais aussi des moyens de créer un autre type de relation sociale, une autre manière de faire les choses. Le contact avec ces groupes m’a permis de connaître leurs réalisations, qui sont impressionnantes, et aussi leurs problèmes. Les unes comme les autres ont tourné dans ma tête, et je pense qu’aussi les mouvements continuent de tourner en rond maintes et maintes fois dans ces tentatives de rompre avec le capitalisme depuis l’intérieur du capitalisme. Cela m’a conduit à me concentrer sur la question des brèches et des activités développées en leur sein, dans ces fissures qui vous font réaliser que, ce qui caractérise ces groupes ou initiatives, c’est la tentative de développer des activités qui ne se laissent pas déterminer par l’argent ou le profit, et qui, grâce à ces activités, construisent une autre logique.
Ce qui m’a conduit ensuite à l’écriture de Crack Capitalism, c’est précisément le contraste entre, d’une part, l’activité ou le faire développé au sein de ces brèches ou initiatives et, d’autre part, la conscience du travail imposé par le système, ainsi que la prise de conscience que la révolte n’est pas la révolte du travail, mais la révolte contre le travail, la révolte d’un autre type d’activité contre le travail capitaliste.
Par ailleurs, je pense que l’autre question centrale de Changer le monde… est le double caractère du pouvoir, ou son caractère antagoniste : le pouvoir-sur en tant que pouvoir du capital, de la domination et le pouvoir-faire, entendu comme notre capacité de créer. Si l’on développe cette idée, nous rencontrons un antagonisme entre deux types d’activité. Le pouvoir-sur est le déploiement du travail comme travail aliéné, comme travail imposé qui suit la logique de l’argent et du profit. Au contraire, le pouvoir-faire est le déploiement de nos forces productives, de nos forces créatrices, de notre capacité ou envie de décider ce que nous voulons faire, ce que nous estimons devoir faire, ce que nous prenons plaisir à faire.
En troisième lieu (le premier a été l’expérience du contact avec des groupes et des initiatives, le second, ce contraste entre le pouvoir-sur et le pouvoir-faire) se trouve la discussion sur le fétichisme, un thème qui a été au centre de Changer le monde… et de tout ce que j’ai écrit sur changer le monde. J’ai d’abord pensé le fétichisme en termes d’argent, d’État, de capital, c’est-à-dire comme catégories fétichisées, comme catégories sociales qui existent sous des formes mystifiées, comme des choses. Mais penser à la critique des formes fétichisées implique que nous devons ouvrir toutes les catégories de la pensée. La critique est le processus d’ouverture des catégories et de compréhension qu’elles occultent un antagonisme. L’argent, par exemple, n’est pas simplement une relation sociale, mais une relation sociale antagonique, une relation sociale qui occulte l’imposition de l’argent comme une relation sociale et la résistance contre cette relation sociale.
Il est donc nécessaire d’ouvrir toutes les catégories, y compris la catégorie de classe, comme je l’ai fait dans Changer le monde…, mais il est aussi nécessaire et crucial d’ouvrir la catégorie travail. Ouvrir la catégorie du travail conduit à voir qu’ici aussi, il y a une relation antagonique, une lutte pour l’imposition du travail (du travail capitaliste, fétichisé, aliéné) et une lutte contre cette imposition. Essayer de comprendre l’antagonisme que dissimule le concept de travail abstrait est donc ce qui différencie les deux livres.
On pourrait dire qu’il y a trois concepts qui sont aujourd’hui largement présents dans la pensée politique de la modernité : État, sujet, domination (cette dernière définie comme toute forme de manifestation de pouvoir). Dans Changer le monde… l’accent est mis sur les deux premiers, et on peut penser que, dans Crack Capitalism, vous placez au centre le concept de domination à partir de la critique du concept de travail abstrait. Quels sont les aspects de la domination qui sont mises en discussion à partir de la critique de cette catégorie ?
Je crois qu’une question importante dans le livre Changer le monde… est la tentative de reprendre l’action révolutionnaire anticapitaliste entre nos mains. C’est-à-dire qu’il n’est pas question de construire un parti, de passer des années à créer un sujet capable de changer le monde. Il ne s’agit pas de passer des années à organiser un parti capable de prendre le pouvoir et de changer le monde, mais que ce sujet et les possibilités de changement doivent être compris à partir de nous-mêmes, en ce moment même. En ce sens, j’essaie de revendiquer la subjectivité de l’ici et maintenant, dans l’espace et le temps présents. Si nous pensons en ces termes, ce qui est central, c’est notre activité, ce que nous faisons tous les jours. Et si nous pensons à ce que nous faisons quotidiennement, nous pouvons voir que cette activité de tous les jours est traversée par un antagonisme qui s’exprime, d’un côté, dans le travail aliéné, le travail que nous devons faire pour gagner de l’argent ; et de l’autre, dans nos élans, nos envies, dans notre faire quotidien qui nous pousse vers l’autodétermination.
De sorte que, si nous regardons dans cette direction, évidemment, l’antagonisme s’exprimera de multiples manières différentes : il se manifestera dans le travail quotidien des employés, mais aussi dans les tentatives conscientes de rompre avec la domination du travail abstrait dans de multiples brèches. En ce sens, je suppose que c’est une tentative d’aborder la question de la domination, mais en comprenant la domination dans les termes de son impact au quotidien, en la comprenant comme travail abstrait.
Qu’est-ce qui différencie votre approche du travail abstrait de l’hypothèse de Negri de la crise de la valeur ? Quelles sont les implications politiques-théoriques des deux hypothèses ?
Je pense exactement le contraire de Negri. Quand Negri parle de la crise de la forme valeur, il dit que la valeur n’a plus d’importance dans le capitalisme d’aujourd’hui. La critique du travail abstrait est tout le contraire, c’est une critique de la domination de la valeur.
Si nous disons qu’il n’est pas question de prendre le pouvoir, nous devons penser la rupture avec le capitalisme d’une autre manière, cela implique un changement d’approche. Évidemment, il est question de dérégler le capitalisme, de le briser, de lui créer des fissures, de voir comment nous pouvons le démanteler. Mais tout cela conduit, nécessairement, à la question de ce qui constitue la cohésion dans le capitalisme, parce qu’en un sens, nous devons connaître ce que nous essayons de briser. Précisément, la cohésion du capitalisme est fournie par l’argent, c’est à dire par la valeur. Cela nous amène à comprendre la cohésion produite dans la domination, non en termes de domination d’un groupe social sur un autre. La cohésion sociale du système capitaliste se produit à travers la domination de la valeur. Nous commençons alors à comprendre que nous ne pouvons pas abandonner la catégorie de la valeur, mais plutôt le contraire. Et cela, parce que c’est exactement la valeur qui constitue le lien social central, la cohésion, c’est là que se trouve ce qui donne de la cohérence au système.
On pourrait penser qu’abandonner la critique de la valeur, dire que la forme valeur entre en crise, conduit Negri à affirmer des stratégies politiques d’autovalorisation, à une stratégie positive (ou affirmative). Cependant, sa critique du travail abstrait semble dériver dans un autre type de stratégie politique. Pourriez-vous préciser quelle est la différence entre la stratégie d’auto-valorisation et celle que vous venez de considérer, de démantèlement du capitalisme ?
Je crois que, pour moi, la distinction est plutôt entre une théorie de la militance (ou de l’activisme) et une théorie de la lutte quotidienne. En ce sens, le concept d’autovalorisation semble être identique à une idée de la brèche, mais il ne l’est pas.
De mon point de vue, il y a deux façons de conceptualiser les brèches, ces révoltes, ces antagonismes ouverts que l’on peut repérer dans les usines récupérées, dans les centres sociaux ou dans des espaces autonomes. L’une se définit avec le concept d’autovalorisation qui se focalise sur ces rébellions comme des moments ou espaces dans lesquels les personnes impliquées s’autovalorisent, en transformant le concept de valeur et de valorisation en autre chose. Cette manière est celle qui est présente dans les travaux de Negri.
Une autre façon de faire, et c’est celle qui se trouve dans Crack Capitalism, est de comprendre ces rébellions ouvertes comme des prolongations ou des extensions de la révolte quotidienne. En effet, ces rébellions ouvertes ne sont pas seulement le produit de l’activisme, ne sont pas seulement l’affaire de groupes de militants dans la société, mais sont enracinées dans l’antagonisme social quotidien, qui est la base de l’activité sociale de tous les jours. C’est pour cela que j’insiste, non pas sur l’autovalorisation comme une activité distincte, mais sur la nature contradictoire du travail qui est présent dans toutes nos activités. Il me semble donc que c’est ici que se trouvent les différences. C’est ainsi que je comprends la théorie de Negri et de Hardt comme une théorie de l’activisme. Au contraire, je veux rompre avec cela et dire que nous devons aller au-delà de cette conception, que nous ne devons pas penser le changement social seulement dans les termes de la militance des activistes, mais en termes de rébellion quotidienne. Si nous ne parvenons pas à voir ces continuités, alors nous reproduisons l’élitisme et l’avant-gardisme léniniste que nous avons rejeté.
Dans ce sens, si nous partons de la caractérisation des différents types de luttes présentes dans votre dernier livre, on pourrait dire que certaines se situent dans les limites du travail abstrait (comme les luttes salariales ou partidaires), et d’autres semblent appartenir au flux social du faire et constituer les fissures dont il est question ici. Pensez-vous que le capitalisme a la même capacité d’affronter et de résoudre les deux types de luttes.
Le capitalisme est un processus continu de canalisation des luttes à l’intérieur de certaines formes. Si les luttes se canalisent d’elles-mêmes vers ces formes, alors pour le capitalisme, c’est relativement facile de les absorber. En revanche, si les luttes se dirigent contre les formes capitalistes et vers la création de nouvelles façons de faire les choses, il lui est plus difficile de les absorber, parce que ces luttes visent à rompre avec les schémas de la domination capitaliste.
On a l’impression qu’il y a une certaine accoutumance à certaines formes d’antagonisme. Cette accoutumance peut provenir de la reconnaissance de ces luttes par le capital et par ses tentatives de les capturer, de les canaliser et de les retourner comme faisant partie de sa propre initiative. Prenez par exemple la promulgation de l’égalité du mariage en Argentine : cela a commencé comme faisant partie d’une lutte contre la forme acceptée d’union entre les personnes et puis, il y a eu une certaine appropriation et la reconnaissance de cette lutte par la promulgation d’une loi. Il semble donc qu’il y ait une sorte de luttes qui sont plus faciles à fagociter. Mais la place des ‟Indignados”, par exemple, n’est pas une lutte facile à digérer, ce qui signifie pour l’Etat (en tant que médiation de la relation entre le capital et le travail) de nouvelles tentatives pour apaiser ces mouvements de lutte. On peut donc dire que le capitalisme n’a pas toujours la même capacité de réponse.
Je suis d’accord : le capital est un mouvement de digestion des révoltes, un mouvement constant de transformation des révoltes en des formes qui lui soient utiles pour sa propre expansion. De sorte qu’il y a certainement des révoltes plus digestibles et d’autres qui le sont moins. Mais si l’on comprend le capital comme le mouvement qui digère les révoltes, on peut penser qu’aucune méthode révolutionnaire n’est sacrée. Nous devons donc tout le temps réfléchir et recréer de nouvelles formes de révolte, d’action. D’une certaine manière, c’est ce que nous avons vu en Argentine en 2001 et 2002 et que nous voyons maintenant en 2011 avec les indignés. Mais je soupçonne qu’il n’y a rien qui ne soit pas digestible.
Il n’y a aucun a priori. Et pourtant, il y a quelque chose que le capital ne peut pas digérer : l’autodétermination.
Oui, bien sûr. L’autodétermination est indigestible. Peut-être, et possiblement qu’il en va de même avec la négation et le rejet de l’argent qui sont aussi indigestibles. L’autodétermination implique la négation de l’argent comme forme de cohésion sociale. Le mouvement du refus constant de l’argent comme forme de lien social est quelque chose que le capital ne peut pas digérer.
Dans ce sens, certaines des critiques adressées aux deux livres soutiennent souvent que votre perspective peut être considérée comme une sorte de socialisme utopique. Être-vous d’accord avec cette idée ?
Non, je ne suis pas d’accord, ce n’est pas ça. Ce n’est pas mon point de vue parce que je pense que le problème du socialisme utopique traditionnel réside en ce qu’il est un concept anhistorique sur la possibilité de la révolution. Je pense le contraire. Ce que nous avons à théoriser est, bien plutôt, le mouvement de la lutte, non pas en termes de simplement suivre son mouvement, mais en termes de saisir ce qui est au bout de la langue du mouvement anticapitaliste.
Je pense que changer le monde sans prendre le pouvoir n’est pas une idée qui vient de nulle part. Le livre et la notion même de changer le monde sans prendre le pouvoir sont une tentative pour exprimer ce qui était déjà en train de surgir du mouvement anticapitaliste lui-même. Si nous regardons ce mouvement au cours des trente ou quarante dernières années, nous remarquons qu’il y a une bifurcation, un changement de direction, dans lequel, à mesure que les mouvements rejetaient effectivement de plus en plus le concept du parti, ils rejetaient également l’idée de centrer la rébellion dans la tentative de prise du pouvoir. Donc, l’idée de ce livre a surgi des luttes elles-mêmes.
La même chose est survenue avec Crack Capitalism. Lorsque l’on prête attention aux luttes actuelles, on voit qu’elles n’envisagent pas la possibilité de prendre le pouvoir. Au contraire, elles rejettent ce concept politique et posent, très contradictoirement, la possibilité de démanteler le capitalisme, de le découper en petits morceaux. Et en ce sens, Crack Capitalism est une tentative de penser et de réfléchir sur les difficultés et les potentialités du mouvement lui-même. C’est pour ces raisons que ma perspective n’est pas celle du socialisme utopique et anhistorique.
Crack Capitalism semble rendre compte des deux niveaux de relation avec le capital qui n’étaient pas présents dans Changer le monde… En d’autres termes, il semble expliquer l’existence de deux niveaux de contradiction dans le rapport capitaliste : le niveau de travail concret-travail abstrait et celui de capital-travail. Cela vous permet de soutenir que cette contradiction n’est pas limitée par la lutte contre l’Etat. Pourrait-on considérer, alors, que la critique du travail abstrait approfondit les approches de l’État que vous aviez réalisé dans vos précédents travaux ? Par ailleurs, de quelle manière cette critique est valide pour rendre compte des processus de changement social que l’on enregistre en Bolivie et au Venezuela ?
Je suppose qu’il y a effectivement un processus d’approfondissement de la critique de l’Etat. En ce sens, l’argument de Crack Capitalism est que nous devons comprendre l’existence même de l’Etat comme un moment ou un aspect de la domination du travail abstrait. C’est quelque chose qui n’était pas dans Changer le monde… De ce point de vue, l’anticapitalisme étatocentrique est une expression du travail abstrait.
En outre, l’argument développé dans Crack Capitalism, c’est l’idée que l’Etat, en tant que forme d’organisation sociale, est le produit de la transformation de l’activité humaine en travail abstrait. Ainsi, centrer la rébellion sur l’État, c’est reproduire la domination du travail abstrait. Si l’on considère l’histoire du mouvement ouvrier, du mouvement anticapitaliste, on voit comment la domination du travail abstrait, du capital, se reproduit à l’intérieur du mouvement anticapitaliste. Et il le fait de multiples manières, mais l’un des moyens par lesquels se reproduit la domination du travail abstrait est présent dans le fait de se concentrer sur l’État et sur la lutte pour la prise du pouvoir d’Etat.
Je vois donc la critique du travail abstrait comme le fondement de la critique de l’Etat. En effet, la conséquence qui découle de tout cela est que le mouvement anticapitaliste est toujours contradictoire, parce que le mouvement du capital se reproduit surtout dans l’acceptation du travail abstrait comme travail unitaire.
Mais je disais, n’est-ce pas, que la domination du travail abstrait est reproduite au sein du mouvement anticapitaliste dans cette focalisation sur l’État. Et même ainsi, le mouvement anticapitaliste est toujours contradictoire. Il est possible de voir en Bolivie et au Venezuela, et ailleurs, comment se reproduisent ces contradictions au sein du mouvement anticapitaliste et en ses formes d’organisation, et comment celles-ci se retournent contre le mouvement anticapitaliste lui-même. Autrement dit, nous pouvons voir comment le fait de canaliser ce mouvement à l’intérieur de l’Etat se retourne contre le mouvement lui-même. C’est très évident en Bolivie et dans les luttes provoquées par le ‟gasolinazo” [hausse brutale du prix du gaz] en 2010.
Certaines critiques faites à Changer le monde… et qui s’étendent à propos de Crack Capitalism proviennent de points de vue qui appellent à explorer les contradictions internes à l’État. La base de ces critiques et de ces appels se justifie par l’hypothèse selon laquelle, en ne procédant pas ainsi, on tombe dans les luttes micropolitiques. Comment répondez-vous à ces critiques ?
Bien sûr, il y a des contradictions internes à l’État. Mais se focaliser dans cette lutte aboutit toujours à sa reformulation en termes étatiques. Cela conduit aussi à entrer sur le terrain du capital et implique, nécessairement, de s’enfoncer dans des formes d’organisation capitalistes. Il me semble que cela est sans issue, car il s’agit toujours de subordonner la lutte au mouvement de l’État.
Par ailleurs, les mouvements ont des racines dans des expériences quotidiennes. Dans Crack Capitalism, je montre que la seule façon de penser la révolution anticapitaliste, c’est de la penser dans la création, l’expansion, la multiplication et la confluence des fissures nées de l’expérience particulière et quotidienne. Cependant, une question qui apparaît maintenant et que je n’ai pas assez développée dans le livre, est celle de la confluence des fissures, celle de penser à la façon dont ces brèches convergent ou comment elles peuvent le faire ainsi que les possibilités de participation active dans ce processus de confluence. Mais il me semble que ces fissures ne doivent pas être considérées comme des micropolitiques mais comme des rébellions qui sont en mouvement tout le temps.
Certes, la question reste de penser le mode par lequel ces rébellions peuvent se réunir, peuvent converger. La manière traditionnelle de penser la confluence est posée en termes institutionnels et, de mon point de vue, les institutions tout simplement ne fonctionnent pas : elles ne réussissent pas ni n’ont jamais réussi à promouvoir la convergence des luttes. Cela doit être pensé en d’autres termes : en termes de résonance, de processus. En réalité, nous ne comprenons pas très bien les processus, car les mouvements de luttes sont imprévisibles.
Je pense que si je devais écrire un nouveau livre, ou si je devais ajouter un épilogue, c’est cela qui en serait le thème : la confluence des brèches et jusqu’à quel point nous pouvons intervenir. En ce sens, j’ai eu un échange de lettres avec Michael Hardt et il parle de la nécessité d’organiser la révolution. C’est exactement le sens de ma question : dans quelle mesure peut-on organiser la révolution ? La révolution ne devrait-elle pas être comprise comme un processus qui s’organise, comme une multiplication des fissures qui se rejoignent, qui convergent, mais que l’on ne peut pas organiser ?
Organiser dans le sens de prévoir ?
Exactement. Dans le sens de prévoir ou de contrôler de l’extérieur.
Cela voudrait dire, alors, que dans votre perspective, ne serait pas présente l’idée que l’on peut avoir une théorie de l’organisation donnant une forme à cette lutte, une théorie de l’organisation préalable, qui sous-tend la lutte et lui donne sens, comme on peut le défendre dans une théorie du parti. Toutefois, dans les deux livres, on peut trouver une théorie de l’organisation plus ou moins implicite, car, à certains égards, vous avancez l’idée d’une organisation situationnelle, c’est à dire une organisation qui dépend de l’endroit où nous nous situons dans la relation avec le capital. La critique qui vous est adressée depuis le point de vue de la théorie générale du parti, soutient que la théorie de l’organisation implicite dans vos travaux est une théorie de la micropolitique : à être situationnels, à ne dépendre que du point d’où nous nous situons dans la confrontation avec le capital, il ne peut y avoir de théorie générale de l’organisation (universelle) ou un organe général qui lui donne forme, mais une perspective depuis le particulier.
Bien sûr que cela implique de se déplacer depuis le particulier. Mais ce n’est pas une perspective micropolitique. C’est une perspective qui signifie de partir de là où nous sommes. Mais c’est un mouvement pour briser la particularité, qui conduit à aller au-delà du caractère particulier, pas dans le sens de créer un universel, mais d’aller se déplacer depuis le particulier. Tandis que la micropolitique implique de rester dans le particulier, dans le micro.
Pour terminer : une observation et une question. Dans certaines parties de Crack Capitalism nous trouvons l’affirmation qu’il est nécessaire de mettre de côté la question de la domination ou les théorisations à ce sujet. Cependant, lorsque ce travail se réfère à la théorie critique, vous affirmez que celle-ci « est une critique des formes qui occultent l’activité humaine et ces formes qui occultent sont les formes de la domination ». Le livre semble suggérer que la reprise d’une théorie critique implique alors la nécessité de théoriser les formes de la domination. Donc, nous vous demandons, est-il vraiment possible de formuler une théorie critique sans théoriser les formes de la domination ?
Non. Ce n’est pas que je pense qu’il ne faille pas réfléchir sur les formes de la domination, mais je pense qu’il est nécessaire de poser la question théorique depuis la rébellion. De cette manière, on comprend que le point de départ est la critique, le rejet des formes de domination. Si nous pensons à partir de la domination, nous restons coincés dans celle-ci. Nous devons commencer par le cri. En effet, la critique du fétichisme est une critique de la domination. La critique du travail abstrait est une critique des formes de la domination.
Cette interview a été réalisée par Marcela Zangaro et Rodrigo Pascual et publiée dans l’édition électronique de la revue de débat et de critique marxiste argentine Herramienta, septembre 2012.
Traduction : J.F. pour OCL/Courant Alternatif
Ouvrages de John Holloway dont il est question ici :
- Change The World Without Taking Power, paru en anglais en 2002, a connu une édition française tardivement, en janvier 2008, en coédition Syllepse (Paris) et Lux (Montréal), sous le titre Changer le monde sans prendre le pouvoir. Le sens de la révolution aujourd’hui.
- Crack capitalism, a été publié en 2010 et vient de connaitre une édition française grâce aux éditions Libertalia, sous le titre, Crack capitalism, 33 thèses contre le capital.
Textes publiés sur le site OCLibertaire de ou à propos d’Holloway :
« Nous sommes la crise du capital et nous en sommes fiers ! »
Présentation du livre par les éditeurs, introduction des traducteurs et premier chapitre accessibles ici :
titre documents joints
-
La révolution contre le travail (PDF - 199.9 kio)
Version téléchargeable de cette interview
